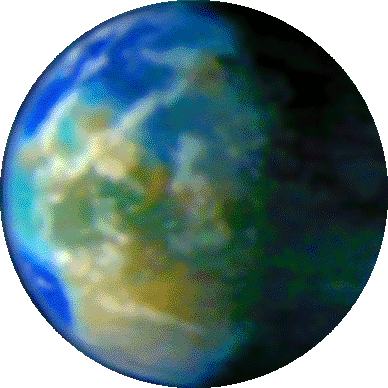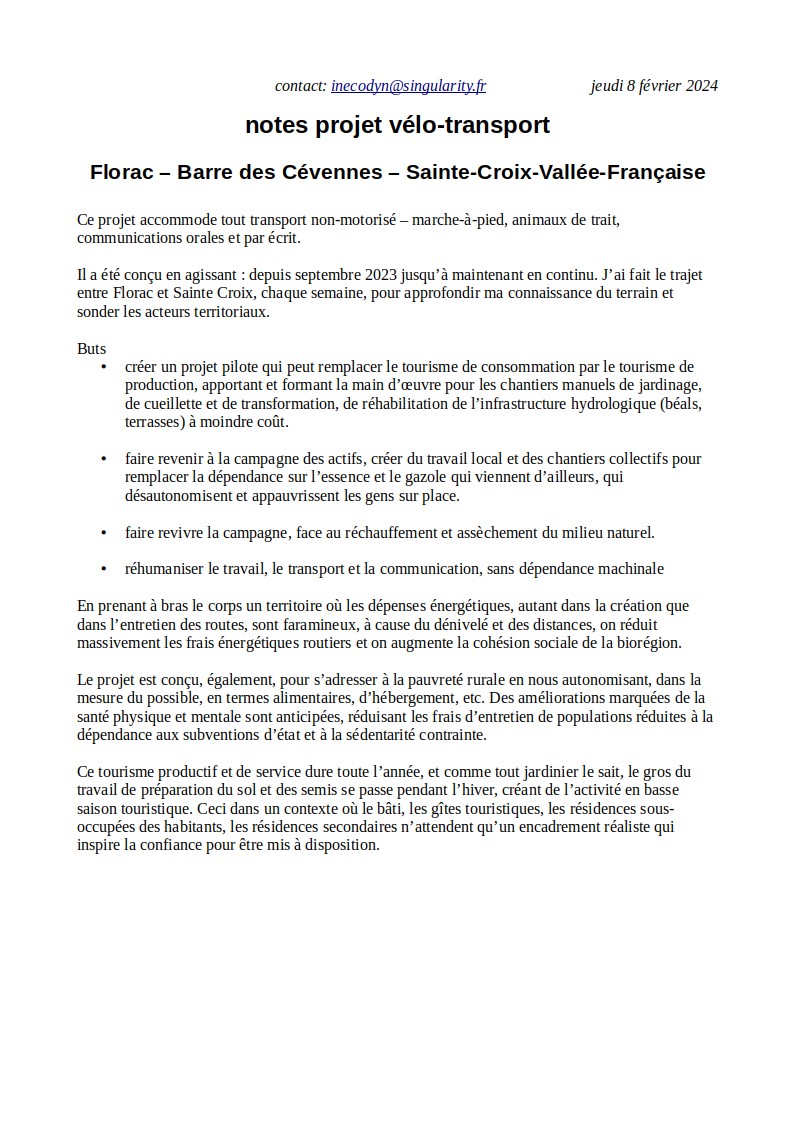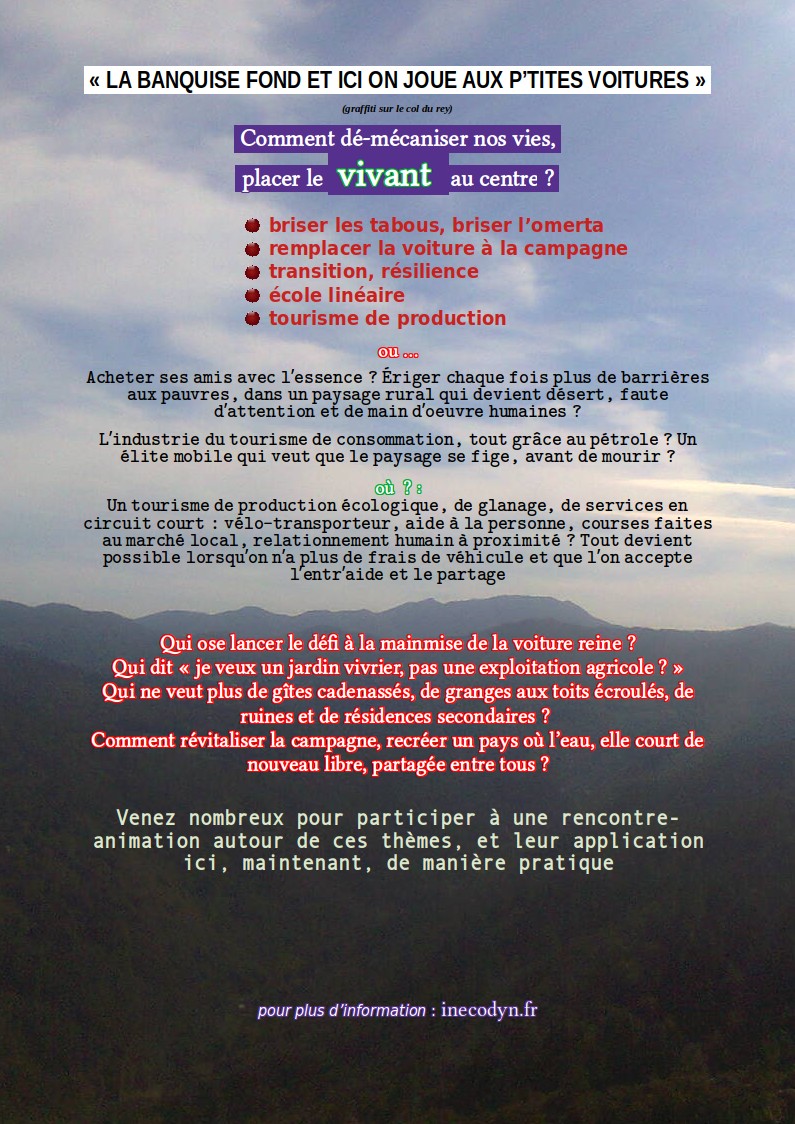courantes
🖶
↑
↓
mardi 31 octobre 2023 / samedi 23 mars 2024
Tournée Cévenole
Ici vous trouverez les liens aux affiches pour la tournée cévenole, printemps 2024. Une tentative pour nous mobiliser ensemble pour créer une petite logistique à bilan carbone positif.
N'hésitez pas à rentrer en contact via le mail inecodyn@singularity.fr
initiative VéloTransport, entre les marchés de Florac et de Sainte-Croix-Vallée-Française (février 2024)
🖶
↑
↓
vendred 13 / samedi 14 octobre 2023
L’auto-ségrégation de l’espace-temps dans une petite ville de la campagne française
Le lecteur attentif saura déjà de quoi on parle : de l’automobile.
C’est à partir de lui que l’auto-ségregation se détermine. Il décide non
seulement de la présence ou l’absence des gens dans des lieux
déterminés, mais aussi de qui déterminera et qui se soumettra à cette
détermination. Les riches en mobilité détermineront. L’autonomie ou
« auto-mobilité » des uns deviendra l’esclavitude
spatio-temporel des autres.
L’erreur que l’on peut faire, dans l’analyse de ces phénomènes, et de
séparer les flux (les automobiles et les routes) des lieux (les
soi-disants « centres »). Tout lieu est un lieu, chaque mètre carré de route aussi. Les
communications vont d’un lieu à autre, en passant par des lieux. On a
maintenant plusieurs lieux qui sont sous-utilisés, surtout
« utilisés » par des membres de l’élite. Il faut analyser flux
et lieux en même temps pour comprendre comment ça marche. Il existe un
outil pour cela : le vecteur.
*nota – les églises et temples – les lieux de culte, restent vides la plupart du temps, actuellement. Ces lieux sont souvent
sujets au pouvoir décisionnaire des communes dans lesquelles ils se
trouvent. Le blocage de ces lieux est un précurseur et révèle le
problème du "sens" - que v-a-t-on faire d'un lieu désigné pour un usage,
pour lequel il n'est plus utilisé?
Vecteur de transmission
On pense ici tout de suite aux virus, des objets tangibles, qui
« se déploient » ou qui sont déplacés à des vitesses et des
distances variables (répansion).
Mais le virus n’est « que » de l’information. Il in-forme, il promeut ou il déclenche de l’activité.
*nota – j’ai entendu un reportage ce matin sur l’assainissement de
l’air extérieur dans une cour d’école moyennant des extracteurs de
particules fines - mais de quelles particules se traîte-il ? Par
exemple, le levain dépend des ferments naturels, des levures qui se
trouvent dans l’air. Comment discriminer les particules que l’on élimine
de celles que l’on retient ? Tenant en compte que les particules
vivantes ont déjà des plans d’action là-dessus ?
string theory (théorie des cordes, nœuds de vipères, singularités)
Entanglement (intrication, emmèlement, enchevêtrement). Pour désemmèler
un nœud complexe dans une corde, nous avons l’habitude de chercher à
tirer des bouts du noeud en extension pour mieux voir celui qui va où,
le faire passer dans l’autre sens, jusqu’à ce que la ou les cordes
soient désemmèlés (unravelled) de nouveau.
Une partie du phénomène de blocage vient du fait qu’un fil (corde,
ficelle) ne paraît pas avoir beaucoup de propriétés à part celle d’être
linéaire et tensile, en extension, mais dans un nœud son épaisseur, sa
flexibilité assument de nouveau une importance critique. Ces propriétés
sont bien physiques, dépendent bien de l’organisation de la matière
physique et peuvent facilement se voir de l’oeil humain. Si je dis ceci,
c’est pour rappeler qu’il y a les métaphores et il y a les phénomènes
réels. La matière physique n’est pas juste une question de quantité,
mais d’organisation, à toute échelle. Pour autant que je sache, la
description d’un filet comme « une quantité de noeuds » manque
de valeur explicative.
Des goulets d’étranglement
Il est étrange et signifiant, pour moi, que l’on peut noter, à partir de
2013, une montée de l’importance et un subtile changement du sens des
mots « facile » et « confort ». Facile devient
l’antonyme de compliqué, pas difficile. Le confort s’associe fortement
avec la facilité. Ce duad est vu non seulement de manière positive, mais
de plus en plus comme essentiel.
Mon hypothèse serait que la surcharge mentale et le manque d’autonomie
de choix n’ont pas été les premières concernes des humains pendant la
plupart de leur histoire sur terre, et ceci, pour une raison assez
simple, la prise en charge de la plupart des problématiques était déjà
déterminée par « le paysage », par nos interactions avec
celui-ci.
Mon hypothèse est que les affres de la vie moderne sont arrivées à un pic
où, comme des nœuds dans le flux informationnel, les problèmes qu’elles
représentent sont à la fois vitales, iressolvables et sans fin - des « flux tendus ». On perd
donc de l’autonomie et du contrôle, dans sa vie réelle. Le
rétablissement de cette auto-détermination et cette
« tranquilité » devient le but central. Le conflit essentiel
est entre la priorité individuelle et celle du collectif. Les plus
fortes associations d’individus sont celles qui ont comme but de
favoriser l’autonomie individuelle de leurs membres.
Chacun décide – c’est l’axiome du marché libre, mais le « goulet
d’étranglement » est devenu l’accès à l’hyperconsommation, plutôt
que l’auto-déterminisme par le transport de son corps soi-même, en
rélation avec d’autres corps, comme dans le cas du virus. L’information
déterminante, par rapport à sa sécurité, sa liberté d’association est
déterminée par l’accès à une panoplie de ressources, un paysage, un
environnement, qui n’a que très peu de relationnement avec son pouvoir
physique, sinon ses pouvoirs extensiles, apportés par des machines
personnelles. Le prix d’entrée dans cette économie de choix devient de
plus en plus élevé.
L’analyse spatio-temporel de cette économie est révélatrice, elle montre
que c’est l’espace-temps qui s’est trouvé asujetti à des flux vectoriels qui
ont de moins en moins de rapport avec les faits sur le terrain. Notre
poursuite de la richesse qui nous achète l’autonomie devient elle-même
la cause de notre déroute. Il faut peut-être mentionner que cette
analyse démontre que l’essentiel, pour nous, reste le même, le cadre
reste l’espace-temps, ce qui est recherché – la motivation, également.
Les instruments d’analyse que j’emploie sont familiers, touchant à
plusieurs disciplines, la mathématique pure, l’urbanisme, le numérique,
les sciences du vivant, la logistique, la physique, le physique, pour commencer. Mais
ce cadre analytique permet d’expliquer dans une trame unique d’analyse
le lien causal direct entre la crise écologique et la crise sociale. Les
résultats sont directement mesurables – la manière d’occuper la terre
des riches crée des espaces désoccupés, par les humains et par le vivant
en général, ensemble. Ce n’est que lorsque l’analyse devient
« vectorielle », traitant de l’espace en fonction des mouvements
dans le temps, que le signal devient clair. La campagne, le silence.
Les hectares de sol nu, pulverisé, occupé par des fines couches d’herbe,
ou par des monocultures. Des réserves, des mégabassines, des lieux
bâtis, tous en attente, … des riches. Pour qu’ils n’y fassent, …
essentiellement rien, ou rien de bon.
Notre campagne est devenue celle-ci.
🖶
↑
↓
dimanche 8 octobre 2023
Essais enfin du monde – carte de l’espace-temps
Memorandum : à usage strictement interne
étude :
L’utilisation de l’Espace-Temps dans une petite ville de campagne-désert dans la ruralité industrielle française
Je vais la décrire, aux cartographes de la réaliser. Je m’excuse pour le
mode constatationnaire de l’écrit, c’est plus court et plus clair comme
ça. C’est juste un effet de style pragmatique pour l’écrivain, pas pour
le lecteur, qui peut le trouver exaspérant, sans doute. Certaines fautes
cardinales ont été commises pour intimer que c’est peut-être une IA
malajustée qui l’a écrit. A vous de juger, si vous voulez bien.
La carte principale consiste en une série de cercles de taille,
remplissage et couleurs divergeants, parfois superposées et représentant
l’occupation réelle humaine des lieux, tout lieu, en fonction des
critères de temps d’occupation, profile des occupants, et ainsi de
suite. Un bureau ne sera utilisé que pendant la journée ouvrable, par
exemple. Un accueil de nuit ne sera ouvert qu’à l’hébergement du
titulaire – autre exemple. La catégorie socio-économique des occupants
de l’espace burotique sera celle de fonctionnaire moyen, etc. Le bureau
aura un taux d’occupation de 20 % du tout-temps, disons, dans le
meilleur des cas. Une salle de fêtes aura, typiquement, un taux
d’occupation de proche de Zéro, même quand on rajoute le co-efficient
Karaoke, ou, encore plus impressionant, Bingo.
On pourrait toujours diviser le temps d’une journée en diurne et
nocturne, suivant l’hypothèse que même un super-riche, endormi, n’a pas
besoin de plus de place que celle qu’il occupe allongé pendant la durée
de son sommeil. Cela pourrait donner des résultats plus productifs et
réalistiques de l’espace occupé par rapport aux besoins. Je pense aux
masures des paysans, à l’ancienne, qui ne s’utilisaient que pour dormir,
puisque on était toute la journée dehors. Qui est dehors ? – autre
question potentiellement fructueuse. Faut pas juger la qualité de ces
habitats d’antan par les mêmes critères que celleux d’un?e troglodyte
moderne nocturne, comme nous le sommes toustes devenu/es. A intégrer au
calcul.
Un café spécialisé « habitués » et ouvert sans pause, lui, aura un taux
d’occupation plutôt respectable, de l’ordre de 50 %. Il y a intérêt à
faire figurer le nombre d’occupants à une période donnée et donc la
densité d’occupation sera représentée aussi, je ne sais pas exactement
comment. La taille du cercle réprésentatif augmentera ou diminuera,
comme sur n’importe quelle carte pulsante qui tente de représenter la
taille rélative des métropoles au niveau mondial, par exemple.
N’oublions pas que chaque carte est orientée autour d’un but défini,
mais que chaque carte dépend aussi des données collatées et disponibles.
Le census national, par exemple, à part le fait qu’il est presque
toujours surannée, d’autant plus en période de fort changement
climatique (fuites des réfugiés, catastrophes naturelles, etc.) fait que
le taux d’occupation, ou de résidence, ou de domiciliation créent la
vision de qui est chez soi, à la campagne – la population rurale
supposée. La carte que je propose montrera que ces mesures sont
caduques, parce qu’elles ne réflètent aucunement la réalité de cette
occupation. C’est important, les revenus disponibles pour desservir les
communautés de communes dépendent de ces chiffres qui sont susceptibles
d’être manipulés, dans un sens ou un autre.
Et puis viennent les co-efficients. On peut correler la richesse – le
revenu par exemple, des occupants de l’espace-temps de la petite ville.
On verra que les bars centraux sont peuplés de personnes rélativements
opulents, par exemple, et que les demeures de ces derniers auront un
taux d’occupation de presque zéro, puisque quand ils ne sont pas au
café, ils occupent plus l’espace-temps de leurs voitures, leurs voisins,
lieux de travail et lieux de visite que leurs domiciles devenus assez
théoriques, finalement. Même à domicile, au travail et en véhicule, ils
ne sont pas strictement là, ils sont au monde connecté. Là, c’est
simple, on a un coéfficient « heures sur écran ».
Leurs véhicules leur permettent de visiter, toujours plus vite, plus
loin – ces véhicules divers faisant, eux aussi, partie des occupations
d’espace-temps représentées sur la carte. L’espace d’une voiture est
relativement petite, elle en dispose, pourtant, d’énormément d’espace,
sur ses trajectoires. Et en fait, cet espace occupé non-occupé, la
chaussée, est maintenue vide pour qu’elle passe, ce n’est pas rien. Une
route a une largeur et une lisière, c’est plus un ruban qu’une ligne,
quelle est sa dimension latérale ? Quelle allocation donner à
l’occupation de cet espace-temps linéaire rubanesque, sur une graphique ?
La grande majorité du temps, la chaussée, c’est de l’espace mort, dédié
à pratiquement un seul type d’usage, le passage voituresque, parfois
qu’une ou deux fois par jour. Comment interpreter cela, sur une carte ?
Est-ce que le vide de cet espace l’occupe, comme le vide d’un parc
régional naturel s’occupe de rien, sauf ses gîtes désoccupés ? Comment
justifier la construction de quelques kilomètres d’autoroute pour
l’usage de quelques voitures ? N’y-a-t-il pas la possibilité que la
vraie utilisation de cet espace, c’est de fournir un prétexte pour
augmenter la consommation, côté production, prétexte récréation, à la
marge : transport ?
Les routes rurales auront donc en général une occupation proche de zéro
aussi. La corrélation de richesse et d’occupation en révèlera, des
choses. L’espace-temps du désert rural, il transparaîtra, est « occupé
», très largement, par des habitants qui ne sont pas là. Curieux. Ils
occupent sans occuper. Où sont-ils ? Peut-on les représenter comme des
étoiles filantes, un peu partout à la fois, au hasard ?
N’est-ce pas qu’une zone inoccupée présente moins de problématiques par
rapport à la liberté d’action estatale et privée qu’une zone saturée de
gens ? Y-a-t-il lieu pour la création d’une carte de liberté relative,
rélative à l’occupation d’espace-temps localisé dans un lieu donné, pour
discerner bien le profile socio-économique des populations qui en
bénéficient le plus de cette liberté ? Comme cela on peut s’attaquer à
la question sensible d’autonomie de choix. Qui a vraiment le choix ?
Une étude rapprochée indiquera que le riches réussissent à relever le
défi, malgré cette abondance de moyens, de l’occupation la plus dense de
petits espaces dans les grands espaces qui leur sont disponibles, pour
établir l’encadrement social qui leur permet d’appliquer un rapport de
force, des points de condensation soudaine comme dans le Blitzkrieg.
Pour cela qu’ils ont l’impression de l’insupportabilité de la foule
pressante, alors que les pauvres ont l’impression inverse, d’être dans
un monde de non-sollicitation de leurs dons. Ce sont des mondes
parallèles, où les pauvres vivent « chez » les riches, « grâce » à leur
générosité, en se taisant, pour ne pas gèner. Qui vit chez qui, comment
cela se définit ?
Là où il y a le moins de taux d’occupation, mesuré sur l’axe de
l’espace-temps, ils y seront, groupés, les riches, mais seulement de
temps en temps. Leur boulot principal ? De construire de plus en plus
d’endroits d’espace-temps, magnifiquement approvisionnés en tout ce
qu’il faut, ateliers, fablabs, bicycleries, cafétières, chaises, tables,
... qui restent résolument vides la plupart du temps, mais qui
témoignent, passivement, de l’influx de riches, venant coïncider
sporadiquement de nulle part en « locale », par la magie des téléphones
portables et des transports inter-city. Là il y a plein de liens
improbables qui se visibiliseront s’ils sont représentés sur la carte.
La sporadicité des mouvements des riches est nécessaire d’abord pour
aligner les forces. Les pauvres sont obligé de les chasser à ce
moment-là. Un bon indice de ce phénomène pourrait être de calculer qui
attend pour combien de temps une visite urgente chez le dentiste, et à
combien de kilomètres de chez lui? L’arrhythmicité des actes
présentielles des riches se fait aussi parce que, sinon, on risquerait
de voir des noyaux durs d’occupation, de libre association et de
communication entre pauvres, sapant le pouvoir rélatif qui définit et
établit le riche en selle.
La dépériodisation ou dérégulation est donc une autre facette de cette
trame de pouvoir nécessaire pour la protection et le renforcement du
pouvoir des riches – et leurs attendants, moyennant la précarisation et
la dérégularisation des activités en commun en général, pour les rendre
ponctuelles et ciblées. On peut aussi appeler ce phénomène
l’événémentialisation progressive de toute rencontre.
Un exemple de ce phénomène en marche que j’ai vu récemment est
l’affichage des horaires de permanence régulière d’une association sur
la porte de leur nouveau lieu d’accueil, extensif et luxurieux, suivi de
cinq jours de non-apparence et de fermeture du dit lieu d’accueil
pendant ces horaires. Explication/décodage : événementiel/ciblage. Les
membres de l’association sont allés chaque jour en visite, ailleurs,
sans signaler que ce ne serait pas ouvert.
Les seuls lieux sur lesquels on peut compter pour en tenir à la
regularité de leurs horaires, ce sont des magasins pour lesquels la
présence d’un clientèle localisé est essentiel, sinon ils ferment. Je ne
sais pas comment on pourrait représenter cela cartographiquement,
peut-être en établissant les lieux où les horaires de permanence sont
mis en valeur, correlées avec la réalité des lignes de force. Le
problème serait qu’il est probable que les lieux d’ouverture stable, les
lieux « fréquentables », n’auront même pas d’horaires affichés et ne
seront que difficilement identifiables. C’est la première loi de
l’information : si vous voulez la vérité, ne demandez jamais au bureau
qui en est responsable de vous en informer. Allez plutôt demander dans
le bureau d'à côté.
Une cartographie qui permet de réfléchir à ce phénomène, croissant, il
me semble, serait également facile à représenter, partiellement,
moyennant la carte générale de l’occupation de l’espace-temps. Il reste
clair qu’un désert rural est la production d’une population riche, qui a
l’objectif de le rendre encore plus désertique, tout en assurant le
maximum de services réservés à leur seule utilisation, ou munificence
d’affichage. La distance parcourue pour obtenir une corbeille de
services est donc un indicateur du profile plutonique d’un lieu donné.
Les riches forment des nœuds, des concentrations sporadiques, dans les
principaux et plus vastes espaces, mais, physiquement, ils provoquent
des clusters, des files d’attente, des embouteillages, là où ils
affluent, un peu comme le faisaient les cours ambulants des monarques
itinérants du temps passé, les Macrons du présent, ou n’importe quel
événement programmé pour les riches, qui crée vite des goulets
d’étranglement (des embouteillages) presque insupérables. Ceci
s’applique indifféremment aux raves, aux festivals en tout genre et aux
actions militantes des Soulèvements de la Terre ou de la CGT. Le
dénominateur commun est qu’ils sont tous plus riches que les vrais
pauvres, sinon il n’y aurait pas embouteillage.
Comme je l’ai dit, le reste du temps, la vacuïté de ces lieux est
assurée par des cadenas, des clés, des patrouilles, des équipes de
sécurité et de surveillance numérique. Le plus simple, c’est que rien ne
bouge, donc, personne. Cela évite de regarder des heures et des heures
de vidéo. Les humains, à ces moments-là – de « temps mort », sont vus
comme des encombrants – des risques sécuritaires – puisqu’ils réquièrent
toute une complexité très cher payée d’organisation et ils ne
contribuent rien à l’organigramme de la possession contrôleuse qui
maintient la structure à flot. Les horaires erratiques et imprédisibles
aident dans ce désencombrement, là où les clés accessibles aux seuls
adhérents cessent de fonctionner comme force dissuasive, mais la clé et
sa possession, ou la combinaison, est en général décisive. Une étude de
géographie rurale comparative pourrait établir la fréquence de cadenas
par kilomètre carré, factorisée par la densité de population de chaque
endroit surfacique.
Ces mosaïques d’espace-temps, reliées par des couloirs de flux, les
routes, également inoccupées et d’autant plus que les voitures roulent
plus vite, paraissent avoir un seul but, celui d’en exclure la plupart
des habitants ou non-habitants, présents ou potentiellement présents.
Non sans raison, les véritables habitants ruraux voient ça plutôt de
mauvais œil, mais ce problème est en grande partie résolu, de manière
pratique et convaincant. Ils n’y sont plus. On peut parler
d’auto-nettoyage éthnique. Typiquement, ils se trouvent en péri-urbain,
ayant revendu ou loué profitablement leurs maisons à des néo-ruraux citadins
(résidences secondaires). La vaste majorité de l’espace-temps campagnard
est géré par des flux tendus de gens pressés, qui n’ont pas le temps
d’occuper les espaces qu’ils ont prévus pour le cas où. C'est pour cela,
d'ailleurs, que les ruines cadastrées sont bien vues - cela représente
l'idéal, des endroits de consommation de l'espace-temps à la retraite,
pleins de latence.
L’exercise paraît être de créer le maximum de brassage, mesuré en
distance parcourue et énergie dépensée par kilomètre de déplacement, pour réaliser le
minimum de résultats en termes d’occupation productive efficiente. Ou,
si l’on veut le voir d’une autre manière, de produire énormément de
latence, de points de chute, de sécurité éventuelle, en prévoyant toutes
les possibles usages qui ne sont presque jamais, en réalité, réalisés.
Pendant quelques années cette révelation m’est venue croissante, devenue
patente pendant les années de ségrégation et de confinement covides. A
ce moment-là, les mots présentiel, distanciel, physico-socialisation, viséo-conference, virtuel, ont vraiment pris leur essor. Il est devenu une nécessité de créer un vocabulaire pour décrire des phénomènes bien manifestes.
Il n’y avait plus personne dans les salles prévues pour leur congrégation, une sorte de silence embarrassé les a remplacé.
où … comment créer un désert rural …
Pour rejoindre les deux bouts, donc, de cette pensée analytique, la
richesse et le statut social se sont combinés pour présenter un signal
fort. L’espace-temps de la libre-association et de la voie publique,
dans son accessibilité, sera dorénavant clos à la plupart des
habitants de la terre, et ceci, par un étroit contrôle de leurs
mouvements. Dans ce monde, en pauvre, on sera obligé de se déclarer
sédentaire, raison : inclusion (insertion) sociale, tandis que le droit
de bouger ne s’accorde qu’à ceux qui se sont déjà déserrés (accès aux
clés). Eux, devenus maîtres de l’espace-temps et de la congrégation, ne
seront pas là où ils « sont », mais accessibles exclusivement à ceux
auxquels ils accordent le droit de la congrégation. Malin.
La croissance du pouvoir des associations, elle, est réservée à l’usage
des « adhérents » (bénévoles, bénéficiaires). Visiblement, les
bénéficiaires ne sont là, quand ils sont là – les horaires autorisés de
présence sont strictement minimales – que pour justifier les frais
énormes de leurs gérants, subventionnés par le gouvernement. Les «
responsables » (salariés) se donnent très largement le temps pour
l’entre-soi, par contre, restreignant les activités du groupe «
clientèle » (patientèle) à des « one-on-one » (accompagnements).
Et tout cela se révèle dans une carte bien ficellée de l’occupation de
l’espace-temps, de manière vectorielle, comme pour n’importe quel
processus de prédation sociale. Notons que cela a toujours été le cas,
on dit depuis l’aube du temps mais moi je dirais plutôt depuis
l’avènement de la civilisation, ou de la sédentarisation, qui permettent
de moduler ou museler la libre-association.
Civilisation, sédentarisation, colonialisation, c’est un peu la même
chose, du point de vue moderniste. Peut-être cela a toujours existé, au
moins en embryon ? Les riches, eux, sont autorisés à bouger, les
pauvres, cloués sur place. Les pauvres n’ont l’autorité de la bougeotte
que dans la retenue et au service des riches, c’est même la seule source
de salut, pour eux. Longtemps j’ai été puzzlé par ces incronguïtés
apparentes. Pourquoi un riche qui n’est jamais là s’acharne-t-il autant à
prétendre qu’il est de souche, et cela depuis toujours ?
Ce qui a changé, entretemps, c’est l’automisation (atomisation,
fragmentation), dite de la révolution numérique, dirons : la révolution
des riches, de l’accaparemment chaque fois plus grand de l’espace-temps.
Ce qui a changé, d’ici en amont, est le grand remplacement, de fonctions
humaines par celles des machines, qui rélève la question : pour qui et pour
quand ? La réponse est clair : pour les riches, toujours !
Ce qui a changé, dorénavant, c’est l’emploi de l’espace-temps. La
principale tâche étant de strier le terrain pour s’assurer de sa
non-occupation. Il n’y a rien à y faire ! Même un état entier peut être
mis hors courant à l’instant même (Gaza Strip, maintenant). La
productivité humaine, mesurée objectivement, a cessé d’exister, celle de
ses machines a augmenté en proportion, jusqu’à ce qu’il vire dans une
autre dimension. La gestion des ressources veut dire leur immobilisation
(sauf en cas d’usage de riche possédant). Et on se demande pourquoi
tout ça à l’air de nous rendre malades, nous qui n’avons plus de
fonction ?!
Entreprise sociale de l’occupation de l’espace-temps
L’idée est relativement simple : je propose d’être payé pour mon
occupation de l’espace-temps des lieux prévus à cet effet, mais qui
seraient sinon fermés et non-accessibles (la plupart du temps) aux
populations desservies (théoriquement). Mon paiement, ce serait mon
occupation, ma récupération de l’espace-temps, ma permanence permettant à
d’autres la co-utilisation de l’espace (grégarienisme). Cette tentative
d’entreprise socialement utile permettrait au moins de faire une sorte
de sondage des raisons affichées pour refuser mes services.
Il y a similitude de cette attitude avec le concept du voyage lent, le
ralentissement du temps augmente l’occupation de l’espace par des êtres
sentients et ainsi les possibilités d’interaction non-léthale avec des
créatures qui ne bougent pas à la vitesse de la lumière (ou de la
voiture). L’affaire est relativement solide en termes de computation.
Cela donne des co-efficients d’efficacité de l’occupation de
l’espace-temps, vectoriellement parlant. L’idée est de ne pas jeter le
bébé avec l’eau du bain. Le mouvement, l’occupation, l’association ont
tous leurs rôles, calculables de surcroît, mais ne sont plus des simples
quantités, sinon des produits factoriels des relations entre plusieurs.
La mesure indexe étant toujours le niveau d’occupation de
l’espace-temps (en "corps humains").
Celui qui dit relation dit auto-organisation. Celui qui dit
auto-organisation dit organisation toute courte. L’organisation des
relations la plus efficace se fait par les organismes eux-mêmes dans les
plus compacts coordinations spatio-temporelles réalisables, minimisant
l’utilisation nécessaire de ressources énergetiques. Il y a donc
urgence à appréhender que la capacité d’allumer ou éteindre un pays
entier, avec un seul bouton, est un critère d’excellence
organisationnelle qui se fourvoie. L’idéal organisatif, entropiquement,
serait que l’individu avec son doigt sur le bouton rouge serait
entièrement impuissant, les événements passant à de toutes autres
échelles et par de tous autres détours et machinations.
Propriété
Nous avons eu, longtemps, l’habitude de voir l’occupation de l’espace en
termes de sa productivité. Les fiefs des seigneurs cumulés, cadastrés,
équivalaient à telle quantité de blé, de bois, de richesse. C’est
d’ailleurs du capital qu’on parle, à l’origine.
Mais une chose quéruleuse s’est passée, entretemps. La marque du riche
est devenue sa capacité d’« occuper » l’espace – le terme est abusif du
sens – pour ne rien y faire. Ou bien, pour y faire quelque chose de
temps en temps, sporadiquement, de nouveau. On ne sait jamais quand
viendra l’homme, avec son tracteur, sa girobroyeuse, sa chevrotine son
chien, on sait juste que c’est une mauvaise nouvelle – tout doit
disparaître, comme dans les soldes.
Sa solde, en effet, c’est la valeur de son bien, cash – ou bien «
plastique », c’est une valeur plastique, un art plastique, la conversion
de biens en stipends (paie).
Tout cela pour dire que si l’objectif premier de cette affaire, la
propriété, était productif, elle est devenue maintenant purement
relative, elle ne peut plus rien produire, en termes physiques, et tant
mieux, elle fait fonctionne de pouvoir, cet avoir, et rien de plus. Elle
est virtuelle – et sa physicité aussi. C’est ce qu’on appelle la
dématérialisation, mais où est partie toute cette matière ? Elle a toute
l’apparence de s’être vaporisée. Si la richesse, c’est le sol, nous
vivons une époque ou l’atmosphère et les fonds des océans prennent tout,
ne nous laissant rien. A quoi bon, donc, la propriété ? C’est peut-être
pour cela que l’axe de mouvement de la civilisation est correlé à
l’existence, purement notionnelle, de la propriété – et ensuite l’accès à
la propriété, notionnellement pré-occupée.
On se prépare pour le pire, le moment où la propriété peut de nouveau
valoir quelque chose, en termes de production concrète (VER - valeur
écologique rajoutée).
Vous pouvez me faire l’observation, avec une part de raison sans
doute, que la propriété, de quelque type qu’elle soit, mais surtout du
type « rapport de force » et non pas usager, vaut déjà notre
alimentation, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que cette propriété vaut
si peu, dans les pays où elle vaut encore quelque chose, les pays
pauvres ? Par rapport aux pays riches, par mêtre carré, elle ne vaut
rien du tout. Elle vaut d’être conquise, et "mise en valeur".
Il est légitime, donc, de dire que la valeur est purement rélative, elle
ne fait que symboliser le rapport de force que l’on tente de créer
entre êtres humains, y inclus l’entretien de peu de valeur où la plupart
de la valeur est produite, et beaucoup de valeur là où le moins de
valeur est réellement produite, y inclus tous les moyens matériels
non-humains qu’on a trouvé, principalement les machines, pour que ce
soit ainsi, les industries tertiaires, les armements, la securité, qui
renforcent ces valeurs tordues, puisque qui mange le pétrole, le petrole
qui fait 70 % pour cent de notre production, mais qui le mange,
vraiment ? C’est dégueulasse, vous avez essayé ? C’est l’un des
principes favoris des écolos, de dire qu’on peut vivre du prana,
tellement peu qu’ils nous faut pour vivre, tandis que pour un
capitaliste pure souche, le monde entier ne suffit plus pour produire le «
nécessaire » (confort, facilité, réalisme).
Cette multiplication de moyens qui ne servent strictement à rien, moins
deux et comptants, qui nous amène gracieusement vers la chute libre pour
l’éternité écourtée. Disons que l’efficience énergétique est devenue
contre-productive, dans l’économie de la production-consommation,
puisque ce qui n’est pas produite ne peut pas être consommée, et ce qui
ne se consomme pas n’a pas de raison d’être produite. Bien entendu que
la production, dans ce cas, c’est la production de survalue, d’intérêts
et de l’or, le reste est immatériel.
Plus le riche produit donc, à sa façon, plus il a de pouvoir, même s’il
n’a pouvoir sur rien de tangible, de telle manière que sa production est
devenue, peu à peu, purement sociale (=anti-sociable).
En cela il ne divague pas du principe de l’organisation de la matière,
qui trouve sa meilleure expression dans le concept « jardin ». Il ne
faut pas oublier que l’inception de l’humanité, version civilisée, a eu
lieu … dans un jardin, selon les rapportages de l’époque.
Dans un jardin, au contraire de l’agriculture, le but est de faire qu’il
se fasse le maximum, sans presque rien faire soi-même, idéalement. Cela
paraît conra-intuitif. N’est-ce pas que le jardinage, c’est du boulot,
du boulot physique, en contact avec la terre, et que les justes
récompenses de cette labour, ce sont les fruits de cette terre, cette
terre « cultivée » ?
Absolument pas. Le meilleur jardinier, c’est celui qui investit la
plupart de son temps à observer (surveillance), assis sur un banc, un
talus ou au milieu de sa parcelle, à mâcher sa paille et regarder le
temps passer. Il observe une limace, en train de dévorer ses jeunes
pousses, il la chope et il la jette, et en ceci il ne fait ni plus ni
moins que le capitaliste qui surveille son royaume pour repousser tout
intrant.
Il enlève les mauvaises herbes pour laisser prospérer les bonnes, bonnes
pour lui, mais par des circuits parfois très indirects. En fait, il
fait un travail surtout intellectuel, plus il a de connaissance des
espèces et de leurs interactions, moins il aura de travail à faire
lui-même. Il lui suffira de leur assurer leur place et de la nier au
nuisibles. S’il fait encore mieux son travail, les plantes auront déjà
trouvé leur place, il n’aura même pas à les planter. Pour cela aussi que
tout ce qui se fait dans le jardin peut être réduit à un processus de
tri : favoriser, défavoriser, mettre à l’ombre, au soleil, protéger du
givre, exposer aux éléments, déssècher, réhumidifier, mais finalement,
si le dessein est bon, cela se fait « tout seul », c’est-à-dire, le vrai
travail n’est fait que par ceux qui ne le considèrent pas un travail,
est qui consiste en …
S’entrebouffer
Vous n’allez pas me dire que manger, c’est un travail, quand même ?
Cependant, notre devoir citoyen paraît de plus en plus être « consommer
». Il est vu comme déloyal de ne pas consommer, dans une économie de
pays riche. On demande les moyens. On nous subventionne. Le vrai travail
d’une vache est de ruminer, ne l’oublions pas. Mangeons les fruits du
jardin, nous aussi, c'est un ordre.
Dans un jardin, donc, le travail n’est pas le travail, la loi du moindre
effort domine et sans manger, il ne se produira rien – un peu comme
dans le désert rural français. Les pauvres agriculteurs prennent le
contre-pied et vivent des vies d’enfer, entourés de machines et
d’insalubriété industrielle, sans jamais sortir de leurs machinosphère, dans
des paradis terrestres qu’ils n’ont pas le temps, ni l’espace
d’apprécier. Ce sont des travailleurs, et par tous les comptes rendus,
des travailleurs malheureux. Le travail qu’ils exécutent est un vrai
travail – c’est de la torture, ce qui explique, sans doute, qu’ils en
veulent terriblement aux fainéants, ceux qui mangent sans travailler et
avec plaisir. Eux, leur boulot, c’est de détruire la terre, ils ne
peuvent même pas s’aimer, pour cela, ce qu’ils aiment, c’est donc le
masochisme et la souffrance productive – le travail.
Comme cela a été dit, l’agriculture est un cas social rural à part et n’a
rien à voir avec le jardinage – les buts ne sont pas les mêmes. En tous
cas, c’est une analyse plutôt historique qui est faite ici. Les
agriculteurs ne font plus partie, sauf en nombre infime, du paysage
fonctionnel rural – ils sont déjà disparus, comme les hobbits et homo
florensis. Bientôt, si les choses continuent comme ça, les machines les
remplaceront entièrement, dans un travail duquel on demande à quoi ça
sert ?
Par exemple, en Ariège, il suffit d’un seul opératif humain, qui passe
la plupart de son temps en voiture, pour desservir plusieurs carrières.
En Lozère, j’ai moi-même vu un ouvrier arriver dans une entreprise
Lafarge, au petit matin, pour accomplir un seul geste. Il a appuyé sur
un bouton et l’usine entière s’est mise en marche. Et oui, cette
opération a bien des parallèles dans la technique « jardin ». Les
carrières « mangent » le paysage, tout le paysage, si on les laisse
faire. Coïncidence ? Par contre, les machines agricoles, plus proche
philologiquement des valeurs du jardinage, ne font que l’aplanir, avant
de procéder à l’élimination de toute végétation et de toute vie.
Ceci donne un mauvais exemple aux jardiniers susceptibles.
Les écologistes qui aiment bien regarder ce paysage sans y toucher (ce
sont principalement des « hors sols ») sont très agités, qu’est-ce
qu’ils feront s’il n’est plus là ? C’est vrai que les grosses machines
des carrières mangent déjà beaucoup de paysages. Mais je pense que ces
écolos voient le monde à l’envers. C’est parce qu’eux, ils prennent tous
des voitures pour aller regarder le paysage que le paysage disparaît.
Aller voir, il faut qu’ils arrêtent ça, déjà. Je suis sûr que c’est
l’argument que déployera, sans hésitation, le seul carriériste restant
en Ariège. Son sale boulot, s’il ne le faisait pas, quelqu’un d’autre le
ferait, et en tous cas, ce n’est pas de sa faute si la demande est là.
L’individualisation des responsabilités et leur démarcation est une
étape importante dans l’étayage d’une philosophie d’exculpation et
résignation individuelles (l’écologie profonde). Dans un monde
industriel, cette stratégie d’irresponsabilisation, des fins du mois,
est presque obligatoire, sinon rien ne va. On la voit partout, cette
philosophie décrite et analysée par Anna Rhendt, notamment, dans les
camps de concentration, dans les hiérarchies gérantes, à chaque échelon
de la société. « J’ai juste fait mon boulot », comme une machine.
Ben, maintenant, c’en est, une machine. Qui le fait ? Il est un peu
normal qu’on ne sait plus qui fait quoi, ni pourquoi. Ca se fait pas, ou
plus, en général. Des mitraillettes qui se tirent dessus toutes seules, des
tronçonneuses qui tronçonnent, des voitures électriques qui se
transportent, des conteneurs qui se transportent et qui se rangent, la
terre est devenue un énorme jardin (parking lot - lots of parking) pour
que les machines se mangent pour nous. Bien sûr que ça ne marche pas,
mais c’est ainsi conçu. En réalité, ça marche, mais pas pour nous. Les
machines ne s’entre-mangent pas – c’était l’erreur délibérée dans la
phrase précédente – ils nous mangent. Le pouvoir vertical humain se
coupe l’herbe sous ses pieds, scie-mment, parce qu’il est fait pour cela
et il ne sait pas faire autrement.
Je pense que les gens pensent qu’il est incroyable d’avoir une vision si
négative, si dépréciative, du monde dans lequel nous vivons, mais dans
mon jardin, tout allait bien, jusqu’à ce qu’on vînt briser l’ensemble,
le collectif, dans son entièreté, pour m’atteindre à moi, pour établir
la « propriété » en le rasant.
C’était le positif, qui me remplissait de joie. Je pense positif, le
négatif que je décris est un effort de description à but de l’évitement
des crimes contre la terre comme des crimes contre l’humanité – il est
important de se ressentir ensemble. J’espère convaincre, en montrant d’un
côté comment ça marche, en mourant, de l’autre comment ça marche bien,
en vivant. Qu’on me dise que je ne suis pas pro-négatif, je le veux
bien, j’en suis flatté, même, de la reconnaissance.
Qu’on me dise qu’on voit le vert plutôt à moitié plein, je crie : « aux
armes ! » Quel vert ? Celui des riches ? Quelle terre, celle des
pauvres ? Si je tente de migrer chez les riches, ils n’en veulent pas de
moi. Si je retourne à la terre, je suis mort. Quel verre à moitié plein
? Quelle terre ? On me la mange sans que j’en mange, comment puis-j’en
être content ? Ma terre, elle n’est pas à moi, elle n'est pas là.
Pauvres et Riches
Quand je dis « riches », ou « pauvres », il faut reconnaître que je ne
suis pas du tout content de cette terminologie et encore moins de mon
usage des concepts. Par exemple, tout-à-l’heure, j’ai du inventer un
lien : « les dépendants des riches », un autre « la retenue des riches
», pour accommoder le fait qu’il y a des gens attachés aux riches, d’une
manière ou autre, susceptibles de soutenir les valeurs des riches et
qui, si l’on votait, feraient le poids électoral qui faisaient gagner
les pro-riches dans les élections. Qui ne sont pas, eux-mêmes, riches,
j’ai hâte de rajouter, s’il y avait un doute - juste coincés.
Les riches eux-mêmes, étant par définition numériquement inférieurs aux
pauvres et ceci d’autant moins qu’ils sont plus riches, ne font même pas
le poids, aux élections, pour gagner, et peuvent même voter contre leur
camp, pour des questions de conviction plutôt que d’intérêt. Il arrive
qu’un riche, il ne s’aime pas, parce qu’il est riche, c’est même assez
fréquent et je le comprends. Ce qui peut expliquer qu’une bonne partie
de leur richesse est investie dans le dupage des pauvres et les pauvres
riches pour qu’ils votent contre leurs propres intérêts. Si les pauvres
ne sont pas dupes, il y a toujours la menace.
Pour les pays riches – les pays dits riches, c’est à peu près le même
scénario vis-à-vis les pays pauvres. Les populations civiles (c’est un
peu comme une guerre en continu), le peuple, quoi, des pays riches sont
plus ou moins clients de la richesse de leurs pays – des dépendants,
assistés, même si la plupart de l’assistance sociale est réservée au
classes médianes, encore des riches. Pour prendre la mesure de ce
phénomène, je dirai au hasard que la probabilité qu’une population
migrante des pays pauvres vote en faveur de politiques qui favorisent
les pauvres est proche de zéro, ils voteront pour la richesse, yeux
rivés vivement vers le haut. En ceci, ils ne feront ni plus ni moins que
ce qu’ils ont fait ou feraient dans leurs pays d’origine, étant donné
qu’ils viennent, majoritairement, des élites et oligarchies de ces pays,
pour lesquels il y a toujours plus haut, plus loin. Et oui, ces effets
se passent à plusieurs échelles fractales à la fois, et de manière
souvent interconnectée.
On pourrait dire qu’ils sont plus conservateurs, en général, que la
population hôte. Que la gauche est soutenue, aujourd’hui, plus par des
personnes d’origine socio-éducative haute que basse, par rapport à la
droite. Que c’est dorénavant l’extrème-droite qui reçoit le vote populaire,
ouvrier et immigré intégral.
Et qui peut donner tort à tous ces gens ? Ce qu’ils font est assez
logique. Les jardiniers de la politique, les Ellen Musks, Présidents
Poutines, etc., essaient d’exacerber ces tendances, en enflammant de
nouveaux fronts, anti-intellectuel, anti-pacifiste, anti-faible,
anti-groupes minoritaires, pour bien pourrir la situation et pour éviter
la création de foyers humanisto-idéologiques qui pourraient leur faire
face. Ils jardinent industriellement, bien sûr, avec tous les nouveaux
gadgets, en sillonant régulièrement les vastes champs de désaccord
pourque aucune mauvaise herbe de décence humaine ne puisse jamais
prendre racine.
Il doit y avoir des analyses beaucoup plus fines, sociologiquement, que
celle que je viens de faire, mais attention, la sociologie industrielle
n’est pas fine, elle broie tout, indifféremment. Comme tout procédé
industriel, la complexité non-ordonné (par soi) est perçue comme une
menace, broyée et réconstituée, pour que l'on puisse en être sûr que « ça marche ». « Ça »,
c’est le processus qu’on a prévu, n’importe lequel, c’est la confiance
dans sa capacité de nuisance qui compte, à ce stade-là. La meilleure
manière de prédire l’avenir est de l’exécuter, d'après tout, selon la
mentalité industrielle. C’est pour cela que dans une situation d’emprise
industrielle, la disruption des plans viendra toujours d’un cumul de marginaux – de « non-prises en compte » qui s’accumulent aux bords du
champs de bataille. Il est rélativement facile de déstabiliser un
processus industriel, c’est pour cela que la plupart de l’effort
industriel est dédié à éliminer la capacité d’auto-organisation de ces
marges, pour prevenir, justement.
La campagne est vaste. Elle est difficilement contrôlable. La meilleure
solution industrielle à ce potentielle menace est de la coloniser avec
des pro-industriels qui défendront les intérêts des riches, qui ne sont
qu’infréquemment là, qui défendent ce qu’ils imaginent être leurs propres
intérêts – leur propriété. Les diasporas, ce sont les coloniaux,
habituellement bien plus socialement conservateurs que ceux qui sont
restés dans le pays d’origine. Et tous ces gens, pour les encapsuler, on
utilise la rubrique « hors sol », dans le contexte industrio-numérique
actuel.
Ou bien les riches et leurs dépendants, même s’ils sont en réalité pauvres. Ils restent les dépendants des riches.
Peut-être la menace idéologique la plus profonde à ces intérêts très
marqués, c’est la menace d’une politique stable « pro-pauvre ». Il faut
cependant établir le sens précis de cette expression, même si le sens
est sans nuance et bien exacte dans la phrase donnée. Une politique
pro-pauvre est une politique qui favorise la pauvreté, pas une politique
qui rend les pauvres plus riches. Il détruit le pouvoir des riches,
jusqu’au point où il n’y a plus aucun intérêt social ou économique à
être riche.
A ce moment-là, certains esprits bien avisés diront « Aah ! Là je sens
des propositions bien révolutionnaires ! » Le pape François, le Saint
François et Jésus lui-même n’ont pourtant pas cessé de promulguer la
doctrine qu’il est plus difficile pour un homme riche de passer au
paradis que pour un chameau de passer par le chas d’une aiguille. Si
c’est révolutionnaire, cela ne date pas d’hier.
La héresie moderne est en effet de suggérer que tout le monde n’a pas son
prix. La tâche des tortureurs de Big Brother en 1984 était, après tout,
de trouver le cauchemar individuel qu’ils allaient administrer sur
chaque détenu, pour le faire parler, pour le soumettre.
Renoncer à la richesse, c’est renoncer à son prix d’achat, se rendre
insoumissible, se refuser au rapport de force. Est-ce vraiment si
révolutionnaire que cela ? Et pourquoi est-ce que cela provoque autant
d’hostilité chez les friands de la liberté ?
A cette dernière question rhétorique il y a une réponse rhétorique.
C’est un chemin envers la liberté qui menace le leur. Un pauvre, selon
cette doctrine, est quelqu’un qui manque la capacité d’être riche. Il
est moins performant et moins apte à la survie. Il est limite fardeau,
il ne porte pas son propre poids, il est probablement parasitaire, sur
les efforts, capacités et performances des bons bosseurs. Il est bon à
rien – il vous sort le pain de la bouche. Il est contre le progrès,
l’inventivité, le développement, tant personnel que civilisationnel. Il
vit dans sa crasse, étant trop fainéant, même, pour se dépasser, ou se
respecter. Un pauvre, en somme, n’a même pas lieu d’être là, là ou un
riche, dans son plein droit, occupe la place qu’il a gagné de par ses
talents, son courage et sa perserverance.
Comme vous pouvez le constater, cette doctrine est non seulement
parlante, étincelante d’expressions et d’idées reçues qui nous sont
toutes familières, mais elle a même l’air de contenir des notes de
vérité. On peut tolérer les pauvres, mais seulement jusqu’à un certain
point. Ce point est celui où ils nous menacent dans notre richesse - et notre aspirtion à la richesse, qu'ils traînent dans la boue.
La tâche intellectuelle et idéologique d’honorer la pauvresse est donc
difficilement lançable. Cette difficulté naît d'une confusion entre deux
états différents. La pauvreté digne et solidaire / la pauvreté précaire
et involontaire. Excusez-moi la pauvreté de mon élocution, je ne suis
pas intellectuellement équipé pour m’exprimer mieux que ça. La
déterioration de mon état mental se démontre par l’appauvrissement de
mon expression. Mes ressources sont maigres. Pour démontrer jusqu'à quel
point la stigmatisation de la pauvreté est imbriquée dans notre langue
de tous les jours.
On dit que personne ne veut vraiment être pauvre, en ciblant la deuxième
catégorie, la pauvreté involontaire, chemin faisant, la servitude
volontaire. On fait l’amalgame des deux, en disant que sans capital,
sans réserves, on manque de résilience (pensée survivaliste). On
remarque que la pauvreté est dans la tête, comme si on était
personnellement responsable pour son état pitoyable, qu’on peut être
riche tout en étant pauvre et l’inverse, que cela dépend de la
définition de ce qu’est un pauvre. Son héritage.
À une époque où le statut des machines, par rapport aux humains, est
si fort, l'humain tout seul sans avoirs, sans biens, a moins de statut
que celui qui est accompagné, par un véhicule, par un portable. Avant,
ses accompagnants, c'étaient des hommes, des femmes, des bêtes.
Qu’est-ce qui se passe si la pyramide socio-économique s’aplanit, si la
différence riche-pauvre commence à diminuer ? Toutes les vociférations
ci-dessus deviennent bien moins importantes, on n’y prête plus beaucoup
d’attention – il y a d’autres choses dans la vie que l’argent. C’est
assez clair et net, nous venons de vivre une époque où c’était le cas,
la pyramide du pouvoir a été la plus plate vers 1973, paraît-il. Les
idées de cette époque, on constate, sont justement associées avec
l’indifférence à l’argent, l’aspiration à l’épanouissement personnel et
social, plutôt qu’à l’enrichissement, jusqu'à la rupture du lien, perçu aujourd’hui
comme nécessaire, entre l’argent et le pouvoir.
pour quoi la pauvreté ?
On commence à entrevoir quelques réponses. La pauvreté, non-stigmatisée,
assumée, permet de penser à d’autres priorités que celle d’assurer,
d’abord, ses propres bases (la charité commence chez soi).
Au contraire, elle permet de s’assurer que les bases des autres sont
aussi solides que les siennes (solidarité). Cette assurance se
mutualise, humainement. Le rapport de force perd du terrain. Toute une
gamme de mesures sécuritaires et préventives deviennent innécessaires.
schéma : comment la pauvreté ?
cadre rapport but définition discours axe
écologie vital.e favoriser la pauvreté adominant.e inconforme ♄
économie social.e sortir les gens de la misère dominant.e orthodoxe ☿
cadre
rapport
but
définition
discours
axe
écologie
vitale
favoriser la
pauvreté
adominant.e
inconforme
♄
économie
sociale
sortir les gens de la
misère
dominant.e
orthodoxe
☿
🖶
↑
↓
?
Circuits Courts – exemples
Exemple 1.
Millau
But: de remplacer le transport de kayaks en plastique – et leurs
occupants « sports pleine-nature » – transportés en camion à
remorque vers les Gorges de la Dourbie ou du Tarn – par un autre
transport, le vélo ou le vélo-transporteur (NVDD?), la fabrication en
ressources locales (bois, résine) des kayaks ... et l'emploi humain.
Étude de Faisabilité
Actuellement, les touristes commencent à être montés en camion vers 9 ou
10h du matin. Des pauses repas à des points médians au bord de l’eau
vers 13h sont planifiés. A ce but, dans les embarcations, des bidons
bleus scéllés.
Pour remplacer ce transport écologiquement coûteux, il y a largement le
temps pour programmer des déplacements plus lents. A disposition - ce
qui reste de la journée, le matin tôt et le soir ou nuit, plus frais,
pour haler les bateaux vers le point de départ en amont.
Le vélo-tourisme peut donc se combiner avec le canoë, dans une synergie
intéressante de ces deux formes de transport, en remplaçant le minibus.
L’impact écologique positif de ce tourisme-là se trouve surtout dans
l’investissement de l’énergie humaine. Sur les points de pause, ceux qui
ont fait le vélo-transport des embarcations peuvent redescendre faire
le repas, avec les denrées tels le fromage de chèvre, les prunes ou les
oignons : les produits du coin. Ces mouvements servent à transporter le
nécessaire, cuisiniers et produits locaux, mais leur potentialité de
transport, de messages et de services pour la population locale est
vaste, aussi.
En évitant l’usage d’un véhicule lourd, on gagne plus de 15 000 euros
par an, aussi bien que les salaires de son chauffeur et celui qui charge
et décharge les kayaks, aussi bien que le coût du transport des repas
picnic.
De quoi payer des vélo-transporteurs pour leur effort, ou réduire les
frais du tourisme vert parce que le vacancier se bouge lui-même, gagne
même de l'argent de par ses efforts. Son tourisme est à la fois
productif et recréatif, dans la cause écologique.
dimanche 18 septembre 2023
Exemple 2
Boucles et Circuits
Ci-dessus un exemple de la conversion d’un tourisme de consommation
pleine nature en kayak - à un tourisme de production
(vélo-transportation des kayak vers l’amont - vélo-tourisme écologique).
On profite de l’effet de la gravité dans le parcours vers le bas.
Dans le cas d’une boucle des marchés locaux, la même logique s’applique.
Par exemple trois marchés, vendredi, samedi, dimanche, un jour de pause
le lundi et trois jours de travail autre que celui du déplacement. Sur
un circuit, on fait un peu l'équivalent de deux marathons ou matches de
foot par semaine, sauf que c'est plus une histoire de performance, le
temps, moins, il y a le temps. Ce qui compte, c’est l’énergie et le
bien-être humains. Les rythmes sont humains, c'est-à-dire, un
déplacement par jour, manger bien, dormir bien, se lever avant l'aube, à
la base.
Dans une zone montagneuse, on profite à maximum, dans la planification
du circuit, des hauts et des bas - du dénivelé. Si l’on prend les
marchés de Mende (vendredi alt.650m), Florac (jeudi alt.550m), Barre des
Cévennes (alt.950m, jour inconnu), et Sainte-Croix Vallée Française
(dimanche alt.350m), on voit l’intérêt de pouvoir déscendre au marché
d’un jour à l’autre, de remonter calmément à partir de lundi, en
profitant des jours où il n’y a pas de marché prévu pour entrer dans
d'autres activités.
Ou bien, on peut juste faire une tronçon ou étape, un bout de chemin,
une réorganisation de sa mobilité, un besoin de renflouer les caisses,
d'information ou d'approvisionnement, avant de repartir sur d'autres
missions. C'est juste un cadre logistique qui facilite, plutôt que
d'entraver une vie mobile ouverte à toustes.
Après le marché matinal, il reste tout l'après-midi et la soirée pour
faire le parcours. Il est intéressant de situer un gîte de passage au
deux tiers du chemin sur un parcours d'une journée (40-50km), et faire
le dernier tronçon, vers l’aval de préférence, le matin même du marché
auquel on va. Un dénivelé vers le bas prend la moitié, ou moins, du
temps du même trajet en montant, et ne coûte presqu'aucun effort - on
arrive au marché en bonne forme, tôt, on aura toute la journée pour
revenir vers le haut, le lendemain, sans marché. On a relevé le défi du
dénivelé par un planning réféchi, la voiture ne fait pas mieux, par
rapport à la mission telle qu'elle est spécifiée. Bien entendu que les
distances des parcours sont correlées aux capacités des transporteurs de
cargaisons.
Des zones montagneuses avec du dénivelé paraissent, d’emblée,
exactementl’inverse d’un bon endroit pour créer des infrastructures de
transport sans essence, mais elles ont l’avantage qu’un transport
multi-modal, regulier, avec plusieurs participants, peut servir pour
chercher les objets et les personnes à transporter là où ils se
trouvent, dans des endroits parfois difficile d’accès véhiculaire. Les
ânes, les piétons et les vélos VTT peuvent être employés à cette fin,
pendant que les vélos-transporteurs ne sont jamais loin, en train
d’avancer plus lentement sur le chemin principal. L’une des propriétés
émergeantes d’un tel système, c’est les avantages que l’on peut tirer
d’un travail coordonné entre plusieurs. Terminé l’isolement du
conducteur en autarcie.
Le remplacement progressif d'une dépendence sur les véhicules motorisés à
une dépendance sur l'énergie motrice humaine a un impact social très
positif - des coopérations humaines et donc du travail humain remplacent
la dépendence exclusive aux machines, et on s'apprécie plus, par
intérêt mutuel et partagé.
On peut dire, bien sûr, que cela contraint la liberté d’action
individuelle, mais la réponse est que cette liberté n’appartient
actuellement qu’aux riches, si le prix d'entrée est un véhicule
motorisé. Lesdeux critères, écologique et social, sont de réduire
l'émission de gaz à effet de serre et despoliation des terres avec le
bitume et le béton – jamais nos routes de campagne n’ont été aussi
larges et bien entretenues – et de redonner aux humains leur
fonctionnalité en partage.
Ces caravanes sans essence sont bonnes là où cela compte, écologiquement
– la largeur et la résistance des routes peut être vastément réduites,
la pollution disparaît, on a le temps de cueillir et de semer au bord du
chemin. On peut ainsi réadapter la campagne d’un usage dédié aux riches
et aux touristes, en terreau fertile pour tous les êtres vivants, avec
ou sans argent, humain ou autre.
C’est même une question vitale, tous les efforts écologiques des
néo-ruraux sont vains, s’ils continuent d’utiliser les voitures et
entretenir les routes à camion, ce qui représente au moins 40 % de
l’empreinte carbone et autre à la campagne.
Le besoin de diminuer cette empreinte est absolu, urgent et vital. Pour
prendre une ou deux analogies, l’empreinte des événements sportifs, tels
les jeux olympiques à Paris dans un an, ou les musées et les galeries
d’art comme Le Louvre ou le musée d’histoire naturelle, cette empreinte
est, très largement, l’empreinte carbone des visiteurs dans leurs
déplacements, de la Chine, des états unis et d’ailleurs. Et oui, il faut
être riche pour se payer des déplacements comme ça.
Le même processus est plus subtilement à l’oeuvre à la campagne
française. Un développeur internet et ses potes peuvent très bien vivre
entre Montpellier et les Cévennes, aller chez biocoop et vivre à 450m de
dénivelé de l’autoroute qui l'amène au métropole. La profile carbone
d'une telle vie peut se lever à des dizaines et des dizaines de tonnes
par an. On peut vivre ce genre de vie, tout en prétendant être
écologiquement investi. C’est cette idée qu’il faut challenger, on est
dans une incohérence sociale profonde, et le désert rural en souffre,
manifestément.
En réduisant ou en éliminant les frais du transport motorisé, on rend la
campagne de nouveau économiquement abordable pour les classes
populaires ouvrières. L’argent épargné par l’absence des frais voiture
ou camion, la rélocalisation et la rédistribution en circuit local, la
rédirection de et argent envers des travailleurs humains, tournent un
mal, une incohérence ou non-sens écologique en bien collectif.
Il est envisagé que ces boucles de marché soient conçues pour provoquer
le maximum de réconciliation des intérêts de l’habitant rural et les
« domiciliés boucle » qui, un peu comme les vendangeurs,
viennent investir leurs énergies contre une rémunération digne. Sachons
qu’actuellement, les us et coutumes des vendanges ont plutôt changé, à
cet égard, dans le mauvais sens. Le vendangeur nourri-logé sur place est
une espèce menacée.
Pour contrarier cette tendance, qui nous engrène dans un cycle vicieux
de plus en plus mécanisé, très consommateur d’énergie fossile et
éléctrique. Pour contrer ce phénomène nocif, il nous faut nous
auto-organiser. Les habitants de la campagne peuvent opérer
l’accueil-orientation de ceux qui viennent faire ce tourisme productif,
des villes, des classes populaires. L’échange peut être très bénéfique
pour les deux contingents, à plusieurs niveaux, c’est un peu comme un
« travail civique écologique » véritable.
La propagation du modèle se fait par émulation et replication, de
circuit court en circuit court. Le concept se situe dans la trame
conceptuelle petite et grande logistique. OLherche à remplacer
progressivement la grande logistique des camions, conteneurs,
mobil-homes voitures et supermarchés, par une petite logistique,
c’est-à-dire une logistique de l’humain, à l’échelle physico-social qui
lui correspond le mieux. Les bénéfices, en termes de qualité de vie
sociale, de bien-être et de plein emploi des facultés humaines,
deviennent mnifestes. La question n’est plus, « ext-ce que les
machines travaillent mieux que les humains ? » sinon
« est-ce que les machines font bien leur travail de nous rendre
notre qualité de vie, sans parler de notre prognosis de survie, plus
réalisable ?
Les enjeux écologiques ont cette particularité de nous toucher à tous,
les riches comme les pauvres. D’autant plus que ce sont les riches qui,
en faisant venir de loin nos approvisionnements,multiplient la dépense
énergétique, mais aussi l’introduction d’espèces exotiques et invasives,
de virus contagieux, de parasites. D’autant plus que, en induisant des
conditions insuportables dans les pays pauvres et dans les couches
sociales dites « précaires » chez nous, nous créons un monde
réfugiés et de guerres pour les peu de ressources qui nous restent. Les
riches peuvent essayer de créer des commautés closes, même de parcs
naturels dans lesquels seuls eux-mêmes ont le droit de vivre et se
déplacer, mais en ce faisant, ils deviennent de plus en plus ménacés, et
c’est en réalité eux qui ont tout intérêt à développer des modus
vivendi, du vivre ensemble, avec la vaste majorité, ceux qui sont bien
moins riches qu’eux.
Si les riches dans les pays riches donnent le bon exemple, de la probité
et de la cohérence, dans leur style de vie, il est probable que les
pauvres suivront cette mode, il est même probable que les valeurs, en
changeant, vont changer les valeurs rélatives des choses, comme le
pétrole et l’eau, si ce n’est pas déjà en cours.
Exemple 3
Circuits urbains et péri-urbains
Exemple 1, la combinaison du vélo-tourisme et sport de pleine nature, le
kayak, suivi de l’exemple des boucles de marché en zone rurale est
dépassé en échelle par la potentialité des circuits urbains et
péri-urbains. Ceci parce que les populations concernées sont plus
grandes et parce que ce circuits servent à faire le pont entre la vie
urbaine et la vie pleine nature.
Les zones autour et dans les grandes métropoles sont paticulièrement
touchées par le changement climatique, la sécheresse et la perte de
biodiversité. En bref, elles deviennent invivables à certaines époques
de l’année, et il y a maintenant urgence à réverdir les villes, les
créer des mares, des zones de verdure, des endroits à l’ombre,
désartificialisés, révégétalisés, il y a énormément de travail à faire,
tout d’un coup. La politique de la ville est en train d’évoluer, très
rapidement.
Les jardins potagers et vivriers autour et dans les villes deviennent de
nouveau un enjeu important. Il existe déjà des fêtes des jardins et des
activités chaque semaine, régulièrement, dans certains cas. L’idée est
donc de harmonisé cette méthode de transport doux avec les besoins réels
et pratiques de la population urbaine, au niveau social, avec la
participation dans des efforts de production de légumes locale,
d’aménagements bios et beaucoup plus.
Cette tentative de créer une concertation lisible s’étend ensuite entre
le périurbain, souvent vaste et anonyme, en gîtes d’étape envers les
villes à une certaine distance de la grande ville, souvent des villes
dortoirs ou balnéaires. Dans le cas de Montpellier, où cette étude
faisabilité a été faite, l’arrière-pays de l’Occitanie à proximité,
souvent très accidenté (causses, gorges, montagnes) , dans les
départements de Bouche-de-Rhône, du Gard, de la Lozère, de l’Aveyron, du
Tarn et des Pyrénées Orientales, devient accessible sns véhicules
motorisés car l’infrastructure permet de payer son voyage, d’exister et
de subsister socio-économiquement en faisant le voyage, en passant par
les circuits, c’est une mode de vie à la fois nouvelle
🖶
↑
↓
jeudi 3 août 2023
à noter : cet écrit est la transcription de l'émission faite à 18h le 2
août sur la radio résistante (le nom donné à radio larzac pendant la
rencontre "résistante" sur le Larzac.)
ici le fichier audio à ré-écouter :
vie de camp
vie decamp
la jauge
Larzackiens et non-mixtes – le grand remplacement
Quelques personnes m’ont encouragé à faire descomptes rendus coup de
poing dans cet atmosphère de conformisme fétide, comme ils savent que je
m’enraffole, du sport national de râlage, d’autres se ferment les
oreilles dès que je parle, les soumis du système. C’est comme ça. Je ne
sais pas exactement pourquoi presque tout le monde s’avère conforme à
l’état hiérarchique mais c’est peut-être un effet de surface.
J’ai pensé à une jauge de statut social sur le camp, c’est le
« droit au burnout » (comme le Droit au Logement – le DAL).
Par exemple, le SDF peut-être en burnout perpetuel, mais il n’a aucune
reconnaissance – il n’a jamais de vacances. C’est comme les tonnes de
carbone pour le climat, c’est grossier, mais cela donne un bon index du
statut social relatif des interlocuteurs.
« Je n’ai pas le temps » étant la réponse la plus classique de ceux occupés de choses plus importantes comme l’accueil ou la vie en
commun. Dans l’après covide ceux qui se trouvent soudés à la hanche aux
réseaux sociaux ne sont pas prêts à abandonner leurs nouveaux privilèges de mixité choisie, obtenu à l’instant par un simple « clic », c’est à dire l’exclusion ou inclusion de ceux qui les interpellent. Le
brassard bleu qui veut dire « je ne parle à personne, ne
m’interpellez pas », est, paraît-il, l’équivalent d’une case cochée pour l’espace social physique. C’est aussi une gradation de ma magnifique théorie du « droit au burnout ».
« On veut tellement me parler que je ne veux plus qu’on me
parle » – quel statut social exalté, quelle popularité
inouïe !
Au média indépendant et au bureau (le nom que l’on donne à la clique
règnante amorphe autour de terre de luttes, le nébuleux qui organise
« résistantes »), si anarchie il y a, il y a une forte
hierarchie déterminante dans cette affaire, et parfois plusieurs – mais
tous s’accordent sur l’importance de ce qu’on appelait dans le folklore
« le jour J », le jour où tout le monde sera jaugé – la
competition pour venir est féroce, l’effet de vortex maximal.
Je fais le petit déj depuis trois semaines et demie, je suis bien placé
pour le savoir. Pendant trois semaines on était entre vingt et quarante, dans les préparatifs pour le déluge de gens et de matos à venir. Il est venu, et il nous à balayé d’un revers de main, dilués subitement par mil venants, ces derniers apparemment réduits à la seule ambition de « se rendre utiles », comme des scouts, en évinçant la force ouvrière ancienne du camp. Ainsi soit-il. J’ai fait la grasse matinée pour la première fois depuis mon arrivée le 12 juillet. Cool !
A mon reveil à 7h30, allez hop, je vais au complexe néo-bureau-média
indépendant pour voir l’état du burnout général, qui a remplacé l’état
de grève générale, imperceptiblement. Je constate le burnout en
poursuivant une politique de lynchage, pardon, cordage impératif,
puisque je vois que le vent va bientôt arracher les structures mêmes
dans lesquels les élites médiatiques et étatiques du lieu bourdonnent.
L’effet pourrait être grave.
L’héro éponyme Francis me déclare d’un œil fixe « c’est dans le
camion », j’attends dix minutes pendant que 5 ou 10 interpelleurs
déterminés lui saccadent l’attention sans quartier, pour en planter de
nouveau une : « Qu’est-ce qui est dans le
camion ? », mais c’est trop tard , il a perdu l’attention.
« Tu sais conduire un camion ?», il me demande, sortie de sa
réverie, « mais tu sais bien que je ne fais pas ces
choses-là », lui dis-je – et il le sait et il se tait.
« Qui a un permis camion ? » demande-t-il subitement, de
sa voix habituelle, qui n’a aucun besoin d’amplification.
« Moi », dit une meuf improbable. « Viens avec
moi », lui dit-il, le chauffeur s’est fait arrêter par la police à
l’entrée ». Juste avant qu’il saute dans la voiture avec elle, je
lui demande « et le cordage ? »
« Il y a des sangles dans le camion ».
En effet, il m’a répondu, tout est dans le camion miracle, bloqué par la police à dix kilomètres – c’est prometteur, et en plus ça va arriver –
c’est quand même Francis. Après deux heures de recherche, plusieurs mots d’oiseaux et de brassard bleutisation, j’ai ma réponse ! Peut-être je vais apporter les bonnes nouvelles au médiélite après ma sieste, s’ils ne sont pas encore sanglés ou emportés par le vent. Je n’ai jamais vu autant d’incompétence physique autour d’un festival, il ne manque plus que la pluie pour en faire une vraie chocolatine de schadenfreude, comme à la FestiZAD de Nantes en février 2013 (2012?).
Cela, c’est l’après, le tout sauf prêt. Mais c’est du pré-pré, la pré-préparation, qu’il faut parler. Pour certains, cela fait six mois qu’ils sont enmurés dans ces châteaux aux cieux, ils montrent des signes de burnout grave, les tics nerveux, les expressions vacantes, les
applications de voltage qui font qu’ils se mettent spontanément en autocombustion pendant trois jours sans fin, avant de retomber dans la catatonie de fond, les yeux rivés sur le néant.
Ils refusent toute délégation, ils n’ont pas le temps. Je l’ai entendu hier, texto. Un intrus a pausé devant le feu-bureau. « Je voulais savoir si je peux vous servir en quelque chose ? » a-t-il dit, d’une voix tremblante, le con. Aucune réponse détectable, il a
recommencé, pensant qu’on ne l’a pas entendu.
Subitement d’une voix enragée mais auto-reprimée, le chef des non-chefs
l’a fixé de ses yeux d’assassin et a énoncé très clairement, d’une voix
glaciale : « J’ai besoin de temps ». Tout était dit.
C’est comme ça ici. Tu ne sais pas nager, fin de l’histoire.
N’interpretez donc pas les yeux fanatiques sous un sourcil froncé comme des signes d’intoxication sévère ou de perte de la raison. C’est du burnout – un état exalté où tu peux insulter tout le monde avec impunité et sans séquel, que seulement le prestige te permet d’atteindre. Sinon tu achètes ta célébrité – et ton nom est gravé sur la liste de
remerciements devant les stands d’hyperconsommation prévues pour cette « grande rencontre del’écologie politique ».
J’ai la vélléité de vouloir faire naître un syndicat de bénévoles – nous sommes, après tout, les seuls ploucs sans partie prise d’office dans un monde d’élites. Sous cette trame d’analyse, on se rend compte jusqu’à quel point le bazar réflète les valeurs corporatistes dela Macronie. Des employés gratuits sans voix, des assemblées générales en simulacre de consultation, des réunions empilées qui remplacent l’action physique qu’elles sont censées gèrer, des signes fortes de panique à peine dissimulées et une installation qui a visiblement deux jours de retard déjà sur le planning, sur un événement de 4 jours. Magnifique !
Comme la consommation du grand maximum de tonnes de carbone par personne paraît être le seul but concret de cette rencontre, à part la récolte par les faucheurs volontaires de nouvelles têtes, comme les headhunters du City écolo, la stratégie prédéterminée paraît réussir. On verra. Il y a des vraies tempêtes annoncées pour vendredi soir, et nous sommes quand même la terre qui se révolte.
L’objet de l’exercise est donc :
1. S’emporter contre les Grands Projets Inutiles (les GPIs, c’est comme
la Boulangerie à 4 fours de bois massifs, qui s’appelle l’IBM, pour
nourrir les 20 000, pardon 5,000, faut pas jauger).
2. Il y a le FFI, c’est fondamental, c’est les non-mixtes, une sorte de bras armé de « dénonce ton porc », allié.e.s aux TdLs (Terres de Luttes, pas Terres de Liens, oui je sais que c’est compliqué, te casses pas la tête, hein). C’est le groupe, après la Conf. (la confédération paysanne) la plus musclée ici, ça se voit, c’est des cas burnouts à l’absolu, iels ne parlent qu’à iels, dans des langages hors la portée de madamoessieur.e.s toustes lea monde, si vous voyez ce que je veux dire, ça a été comme ça depuis le début, aucune explication. La langue est livre, mais les monsieurs sont obligés de porter une chemise. La torse nue a été interdite sur le camp, démontrant à la satisfaction de toustes la puissance pure de ces décisionnairesses.
Nous avons donc déjà eu trois semaines et demie d’apprentissage obligé, de ce que c’est un sysgenre (ce qui est sûr, c’est qu’il n’a aucun droit au burnout, parce qu’on ne tente même pas de lui parler car il n’a non plus droit au chapître).
Comment devenir « non-binaire » sans prendre d’hormones ? La question de l’insertion profonde dans la vie de camp se réduit à cela, bien que beau, jeune et sciences po, ça vaut pas rien non plus.
Il faut rénoncer à toute déclaration de préférence sexuelle pour les femmes, et même comme ça ce n’est pas donné. Je recommande la cultivation d’une voix tendre, presque inaudible, pleine de compassion, jusqu’à l’acceptance. Une fois au sein du sérail, oui, tu peux crier
comme une mule, c’est même obligé, tu peux même le faire devant des milliers de gens qui disent « oui », c’est super ! Après, tu fais ton burnout, tu n’as rien à craindre, t’es non-mixte, c’est grégaire.
Je me sens quand même comme Stéphane Guillon a du se sentir, avant d’être viré de radio France. Il y a des choses qu’on dit et des choses qu’on ne dit pas. Faut être de souche pour les savoir.
J’suis expert en bilan carbone entre 1 et 2 tonnes par an. Je le suis
parce que je le pratique. Il n’y a personne, que je saches, qui fait
autant, dans cette rencontre exclusive de l’élite politique verte, à la
belle campagne française. Comme un seul homme, ils sont tous venus en
voiture. Ils peuvent même senourrir avec ce qu’ils ont amené, si la
cantine fait meltdown.
C’est donc moi l’expert. Au niveau de l’infrastructure nécessaire, pour remplir les critères d’une écologie « réaliste » (j’explique). Cet événement hors sol démontre à perfection jusqu’à quel point le sujet est devenu tabou. Les attaques prévues et encouragées contre les Grands Projets Inutiles sont un magnifique prétexte pour ne pas en parler – des plusieurs petits projets inutiles de l’époque industrielle que nous sommes tous devenus, et comment faire une infrastructure autre que la nôtre.
Toute proposition d’une infrastructure qui remplit les cases est donc strictement censurée, sinon tuée dans l’oeuf. C’est vrai qu’il a fallu bien six mois pour ficeller le résultat des rencontres en fait accompli, mais ce l’est, j’ai pas encore vu de faille dans l’armure. Le feedback que je reçois, c’est que la population locale, étant informés que c’est des « wokes », l’évitent comme la peste, donnant aux non-mixtes un boost massif dans le sens qu’il ne reste qu’eux. On a beau leur dire, aux Larzaquiens friands de liberté « mais si vous êtes la, vous pouvez le changer », rien à faire, y veulent pas venir. L’intelligence collective, de ce fait, devient à peu près une pensée unique.
Même l’altermédia -le « nous » a été pas si subtilement
transformé en une série de comptes rendus, et vous savez, les comptes
rendus ne rendent jamais compte de ce qui a vraiment été dit.
Pas de vrai débat, donc, pas d’opposition, pas de satire, rien du tout, à la fin on s’ennuie d‘avance. Pas de conférence, entre les centaines proposées, sur l’agenda social, mais un mur de conférences sur la violence sexiste, de cela on peut s’assurer.
C’est comme toute discrimination collective, le sexisme positif se justifie par le sexisme supposé être déjà en vigueur, c’est une question de symmétrie équitable. Bye Bye la présomption constitutionnelle d’innocence, faut qu’ils apprennent ! L’ignorance des petits
projets inutiles en faveur de la concentration de la force de frappe sur les grands projets inutiles suit le même pragmatisme discriminatif, comme si on en avait assez d’être juste, qu’on a perdu la patience et que ça suffit comme ça, déjà !!
Le burnout, c’est bon pour tous ces maux de tête. C’est très Macron. Dans le creux de sa main, il nous tient, comme les Men in Black, impassible mais sévèrement agité et prêt à tout, derrière les lunettes de soleil. Cool ! Et il sent le Chanel, bonus !
🖶
↑
↓
dimanche 9 juillet 2023
Auto-organisation
- Auto-organisation
- Sociocratie
- Quakers
- simplicité
- égalitarisme
- pacifisme
- Culte « non-programmé »
- Prise de décision (sociocratie)
- Structure du mouvement
- Organisations Quakers (Amnesty International, Greenpeace, Oxfam)
- Notoriété
Je note ces articles de wikipédie, et les sous-sections particulièrement pertinentes, en pensant, vainement sans doute, donner l'accès à
certaines idées clés de la culture de mes origines. Cela pourrait aider
dans la compréhension de la motivation de mes actes. Mes grandparents
étaient pacifistes et objecteurs de conscience, ont pris refuge dans la
Société des Amis (les Quakers), ma mère y a été et ensuite, bien que
peu, mon père. Oncles, tantes et autres membres de la famille y
prenaient part, aussi, et je suis allé à une école Quaker, pendant une
période de mon adolescence.
L’un des problèmes de base avec les Quakers, c’est que leurs principes
paraissent insaissables, ou trop simples pour être pris au sérieux.
C’est pour une bonne raison : ils sont contre les principes et pas
mal en faveur des actes. De ce fait, ils ont inévitablement une
dimension dynamique et évolutionnaire. En fait, on a du mal à dire qui
ils sont, sauf que si on les connaît, tant soi peu, on connaît pas mal
leur pensée, ceci ayant certaines différences charactéristiques.
Mais cela va bien plus loin. A la base, il n’y a aucune référence
littéraire, aucun service, aucune hiérarchie, une égalité stricte entre
hommes, femmes, et même d’enfants et de toute la création. Pas
d’esclavagisme, donc. Strictement impossible. Ils essaient d’être
modestes, de ne pas avoir des grands égos, de considérer les autres, la
liste humaniste est très longue. Et ce n'est pas par hasard - la logique déployée étant, "puisque la croyance est une affaire privée et qu'en
tous cas l'on ne peut jamais savoir ce qui se passe vraiment dans la
tête de quelqu'un - et s'il le dit, il peut toujours mentir, ...
concentrons-nous sur les actes, pas la profession de foi."
Par conséquence, ils ont pour moi gagné deux choses : avec la
simplicité et la recherche de vérité ou de sincérité, ils ont obtenu une clarté d’esprit qui augmente la capacité de raisonnement, surtout
collectif, et avec l’absence totale d’hierarchie et de dominance,
intégrée, entre autre, au culte, ils ont anticipé, de presque quatre
siécles maintenant, l’état recherché par la gauche, d’un monde sans
dominance coloniale, masculine, etc., etc., et oui, ils étaient les
premières féministes, et les femmes non seulement ont toujours eu le
droit égal à la parole, mais ont eu leurs paroles et leurs actes notés,
comme les autres.
On imagine que je me trouve mal à l’aise d’être un bon respondant à
l’égard de la dominance mâle, alors que je ne l’ai pas connu
personnellement, et que cela ne fait aucunement partie de ma culture.
Pour la violence et l’oppression mâles, je sui également dénué de
réponse – ce n’est pas, du tout, mon expérience personnelle, ni mon
désir, ni en moi, ni en autrui.
Mais si vous voulez prendre la vraie mesure de l’audacité de ce
« culte protestant », d’origine chrétienne, sachez que la plus grande partie de ce que je vous raconte était inconnu de moi jusqu’au
moment, révélateur, à cinquante ans d’écart, que j’ai jeté un coup
d’oeil sur les articles de Wikipédie listées ci-dessus. Je n'en ai
jamais ressenti le moindre besoin, jusqu'à alors. Je sais que mes
prédecesseurs ont eu pas mal de courage, de briser tellement de tabous -
liberté de conscience, refus de participer aux violences d'état et
autres. Ils en ont pas mal souffert, en termes d'ostracisme, d'être vus
comme des gens à part, tout en gagnant, dans leur désobéissance civile,,
dès le 17ième siécle, pas mal de droits pour le peuple anglais. Ceci à
un moment où la France n'était aucunement une république et vivait le
monarchie absolute et absolutiste.
Au moins dans mon expérience, on n’a jamais tenté de me raconter ma foi, ni de m’obliger à croire en quoi que ce soit, ni de me donner les références nécessaires pour ce faire. Les thèmes et activités des jeunes fils et filles de Quaker, ou de simples personnes qui assistent à leurs réunions, n’ont même pas de contenu biblique, pour la plupart. Ce sont
plutôt des activistes. J’ai imbué, littéralement, la culture, sans en
être conscient – c’est une culture que l’on mesure par les actes,
surtout – mais quels actes ! Un acte peut être une expérience de
pensée, une inspiration, une communion, tout est acte, dans un monde où
il n’y a que les actes qui comptent – c’est un peu élastique.
Le positionnement Quaker porte une ressemblance à ce qu’ont cherché
certains beatniks et hippies dans les réligions de l’Est. La méditation
collective est une bonne approximation de ce qui se passe dans le
silence d’une réunion réligieuse Quaker, et je trouve intéressant de
noter qu'après les rares interventions, on doit maintenir le silence un
certain temps avant d'intervenir soi-même. Peut-être cela explique le
mal que j'ai à négotier les coupures de la parole auxquelles je
participe dans les réunions non-Quakers. Disons que toutes les
conditions sont réunies pour la contemplation. Une évolution en
parallèle ou en lien avec les réligions et les mysticismes de
l'Est ? Peut-être quelqu’un va trouver un lien, enfoui quelque part dans l’histoire.
Cela m’intéresse de constater le niveau d’assimilation de cette
culture qui est en moi. Je pense que je serais naturellement attiré
envers la pensée de l’anarchie, si je n’avais pas déjà assimilé une
culture à la fois auto-organisatrice et chaleureuse qui satisfasse les
mêmes critères.
Je trouve l’anarchisme souvent très oppositionnel et réducteur, sans
réponse à plusieurs questions. L’anarcho-syndicalisme retrouve plus ma
sympathie, ce qui est logique, donné l’autoritarisme qu’est devenu le
communisme d'état, le plus visible, mais je dois soustraire les préjugés nationaux contre le communisme pour penser, finalement, que je suis
plus communiste que libertaire, étant donné que nous vivons, ou tentons
de vivre, en société.
Et voilà, justement, les Quakers de nouveau, plutôt que de nier
l’intérêt du relationnement humain, reconnaissent notre essentielle
fraternité, et amitié même, comme éléments constituant le corps social,
tout en ayant une liberté de penseé et d’action individuelle sans
bornes, sauf celle de l’affect en actes, sans aucune profession, ni de
foi ni d'allégéance. On pourrait dire que l'anarchisme, dans ses
diverses formes, fait montre de la même fraternité, le même esprit, mais où est la direction de mouvement ? Vers le but de la liberté
individuelle (la plus grande, optimale dans ce sens), Le corps social
est, à ce moment là, le moyen d'une finalité. D'un point de vue Quaker,
l'être humain est déjà libre (plus libre en prison, parfois, ...),
l'amitié et la fraternité (goodwill - bonne volonté), ce sont les
éléments constituants, jugés plutôt par les actes. Il faut voir qu'à une époque monothéiste chrétienne, admettre la liberté de conscience
réligieuse signifie accepter la liberté de conscience, point barre.
Mais qui, aujourd’hui, tourne l’autre joue?! Je trouve cela d’autant
plus provocateur, intellectuellement, que les premiers écrits de
Voltaire, ses lettres de l’Angleterre, prennent comme sujet dès la
première lettre sur les Quakers (les 4 premières lettres des "Lettres
anglaises" ont comme sujet les Quakers, rien de moins), et que ce
recueil d’écrits n'est pas seulement vendu comme des pains chauds, mais a annoncé le début de la montée de l’Age des Lumières, en France ( 1734
). Si ce n’est pas une pensée universaliste, celle des Quakers, elle a
plus que sa place dans l’universalisme français.
Comme un Quaker sait qu’il n’est pas là pour atteindre la célébrité, ni
l’orgueil de soi, en se concentrant sur les actes purs, habillé sans
ostentation, il a l’habitude de travailler dans l’ombre, ou plutôt de ne pas chercher la lumière de la notoriété, sauf pour des raisons
expéditives. Dans la théorie, c’est clair au moins. Ce qui fait que l’on découvre que les trois ONGs les mieux connues internationalement, sans
doute, et peut-être les plus grandes (?), sont d’origine Quaker – c’est
d’entre eux qu'elles ont été lancées. Greenpeace, Amnesty International, Oxfam. L’autorité morale se trouve, paraît-il, du côté des Quakers.
Et c'est la raison que je n'aime pas les Quakers, pour leur prise de
l'autorité morale, dans une certaine condéscendance de classe moyenne,
la même fausse note que je déteste dans la charité française, à présent. Et ces trois léviathans, Greenpeace etc., peut-être à l'exception
partielle d'Oxfam-France, sont devenus des charités corporates qui font plus de mal à la cause écologique sociale que de bien, dans leur
positionnement et actes généraux. Le "faire" médiatique est devenu une
auto-valédiction, pour faire de l'argent, pour faire des choses (de la
pub), bien loin des origines. Les Quakers sont quand même voués, en
quelque sorte, à la sobriété, pour ne pas dire la pauvreté.
Je pense parfois que c’est comme un diaspore fragmenté, tellement il y
en a peu, mais j’ignore, au fond, je n’ai jamais été Quaker et je ne les fréquente jamais, à partir de mes dix-huit ans. Étant athée, il me
trouble de penser que l’autorité morale pourrait rester tant sur mes
épaules, puisqu’il n’y a pas d’autorité extérieure à moi, que je sache.
Les autres, bien sûr, mais quelles autres ? Cela laisse entrevoir la
facilité et donc l’intérêt de Dieu, ou de l’esprit, ou d’un autre
nébuleux, pour justifier de ses actes. L’ensemble « moi » est
un peu construit sur des « shaky foundations » ( = précaire,
mais qui est aussi un synonyme de quaker, de celui qui
« tremblote » ).
Le "moi" athée et non-pacifiste, bien que dans la lignée anti-violence
de ces gens, ne partage pas non plus plusieurs des valeurs Quaker, qui
deviennent « shaky » dans le sens un peu flous, dans leur
application. Dans ses paradoxes, un secte qui n’est absoument pas
sectaire, avec une inclusion sans bornes basée sur des illuminations
personnelles qui nous réunissent, ce secte pose des conundrums qui
deviennent plutôt explicables, du point de vu moderne, avec la science
des ensembles émergeantes qui expliquent pas mal le fonctionnement
combinatoriel du vivant.
N'est-ce pas assez respectable d'être tombé, intuitivement, sur des
solutions qui ne deviendront claires, mathématiquement, que quatre
siécles après ? La recherche de la vérité, sans préconçus, y inclus le
préconçu qu'elle est à trouver, en essayant de la mesurer, n’est-ce pas
la methode profonde scientifique ? Surtout lorsqu’on voit l’infinie capacité schismatique et plurielle de ce culte, sans la perte de son
fil conducteur et sans tentative de recrutement. C'est en quelque sorte
une preuve de résilience de l'intelligence collective appliquée.
🖶
↑
↓
mercredi 5 juillet 2023
Stratégie
( Discussion stratégique éditée )
Pour répondre aux points soulevés:
"La mission de notre groupe était dans un premier temps de proposer des outils qui soit à peu près sécurisés."
Précisement. C'était le mauvais point de départ. Et c'était pour cela que vous n'avez pas pensé à:
"Face à l'arsenal policier et au renforcement de la répression, les
activistes doivent, selon lui, « désapprendre à se croire en sécurité
sur internet même s'ils pensent avoir de bons outils. On devrait plus
faire attention à ce que l'on se dit, à comment on se le dit et à qui on
parle. »"
"à peu près securisé", cela veut dire garanti a semer la confusion la
plus totale entre nous, sans pour une seule seconde empecher les forces
securitaires de savoir tout sur nous. Au contraire, ...
Notez qu'en citant cette autorité, je démontre que ce n'est pas "moi",
tout seul, qui le pense, je vous apporte des informations, connus de
certains d'entre nous depuis des années. Je rajoute que vos
communications par portable, depuis environ 2012 et encore avant, sont
déjà toutes enmagasinés dans des banques de données et permettent déjà
de savoir avec qui vous vous communiquez et avec qui vous vous associez,
depuis des années, dès que vous attirez l'attention, maintenant, avec
ou sans téléphone.
Cette liste est ouverte, profitons-en - et créons ici, à Montpellier, un
média polémique et informé, pas juste un organe de propagande. Je
transcris et corrige déjà les écrits qui apparaissent sur cette liste,
sur le site inecodyn. Ce qui peut aider à éviter la pression sur les
listes.
"des exemples très concrets de ce à quoi tu aspires en pratique "sans
numérique" pour le comité local, en prenant en compte aussi toute la
diversité des personnes et des niveaux d'investissement possible."
D'abord, permettre à ceux qui sont disposés à faire de ces luttes l'un
des points centraux de leurs vies, la possibilité d'avancer, ensemble,
au pas le plus rapide, sans attendre ceux qui sont moins dispos. En
ayant des points rencontres plus informels mais reguliers, ou plusieurs
groupes sont là en même temps, en marchant ensemble d'un point à autre,
par exemple pour faire la cuisine populaire, on obtient le maximum de
participation structurée - sans aucun besoin de structure
bureaucratique, ou de comités d'urgence non-démocratiques.
Cela n'empêche en rien à d'autres gens de se tenir informés, ou
d'envoyer un représentant qui les représente. Mais il faut arrêter de
faire que la queue branle la tête du chien (the tail wags the dog),
c'est-à-dire que des gens déjà très occupés s'arrangent des réunions à
leur convénience qui varient, ou se lancent dans la planification
d'événements énormes qui occupent toutes les énergies des gens, laissant
plusieurs d'entre nous aux marges.
Pour ma part, par un hasard de naissance, j'ai été beaucoup dans les
luttes écologiques et sociales, en Angleterre, en France et en Amérique
Latine, suffisamment pour pouvoir observer les méthodes qui ont marché
et celles qui ont échoué. Les Road Protests des années 90 en Angleterre
ont été massives, ont complètement pénétré la culture de ce que l'on va
appeler la ZAD, en France, des années 2010, et ont finalement échoué,
manifestement, face à la magnitude du défi climatique et
biodiversifique.
Les méthodes Zapatista se sont montrés plus résilients, mais ont fini
par céder, partiellement, face à un monde qui n'est pas régi par des
normes écologiquement fondés.
Et je veux que l'on gagne. Toutes les mises en cause que je fais, je les ai d'abord appliqué à moi-même, rigoureusement.
Mon premier conseil, ce serait de ne pas devenir sectaire. Deux ou trois
personnes ont déjà essayé de me souhaiter le bienvenu dans le
mouvement, le mouvement dont je fais partie depuis au moins quarante
ans, je n'ai pas été très poli non plus en leur répondant. J'ai vu les
mêmes personnes courir pour être pris en photo devant le drapeau, pour
la postérité.
Comme ancien de la ZAD de Nantes, je sais que ceux qui ont vraiment
montré du courage sont souvent des inconnus qui ne cherchent même pas à
être connus et qui n'ont que faire des mécanismes illisibles des AGs et
de la bureaucratie. Hier soir, on est allé plus loin, on a suggéré que
si j'étais contre les soulèvements de la terre, pourquoi est-ce que
j'étais là? Une autre personne a prétendu que puisqu'elle représentait
un groupe de vingt personnes, elle avait plus de légitimité qu'un simple
individu pour parler. Pour moi, nous n'avons aucune légitimité
démocratique parce que nous ne sommes pas assez nombreux.
Non-sectaire, cela veut dire aussi "essayer de maintenir une atmosphère
de non-conflit politicien". Ces groupes doivent être exemplaires dans le
non-abus du pouvoir relatif. Or, ils ont tendance à regarder beaucoup
vers le haut et pas vers le bas, ils sont de fait discriminatoires
contre les plus démunis.
Et ne nous trompons pas - les décisionnaires savent exactement de quoi
je parle, de la distinction entre un groupe qui consiste en
représentants associatifs et politiques, et un groupe où les individus
sont admis en tant qu'individus. Actuellement, à Montpellier, le groupe
Oulala le lien paraît dominer et impose son agenda sur tout, avec le
même mécanisme de comités d'urgence. Les différentes réunions auxquelles
j'ai assisté ont vu les mêmes gens, à répétition, agir comme
décisionnaires, pour ensuite prétendre que chaque assoc. et chaque
groupement était distinct. Au niveau sécuritaire, cela ne signifie rien
du tout, une association de malfaiteurs ne s'affiche jamais et ne sera
pas, pour autant, moins poursuivi. Dans les réunions, l'ordre de jour
est prédéterminé, sans discussion, et tout sujet additionnel est mis à
la fin, si l'on veut bien.
Lorsqu'on regarde oblectivement le scénario, on voit qu'il est presque
impossible de parler de stratégie générale, sauf à huis clos, entre des
interlocuteurs qui s'auto-choississent et s'auto-confirment. Ce n'est
pas pour dire qu'on n'en parle pas, mais qu'on le fait dans l'entre soi,
sans respecter la démocratie participative qui permettrait que de
nouvelles idées percent la conscience des gens. Les réunions plénières,
jusqu'à là, sont de simples exercices de répétition de ce qu'ont fait et
de ce que vont faire les associations (les quelques personnes) déjà
actives.
Mais il est absolument critique de développer une auto-organisation qui
intègre des dizaines et des centaines d'actifs. La méthode
d'organisation présente cessera d'exister dès qu'il y a un peu de succès
et que les nombres augmentent. Il faut planifier pour ce succès
potentiel.
Bon, pour ceux qui n'ont pas encore cessé de lire, ... je peux dire que,
heureusement, à la ZAD de Nantes, cela n'a pas toujours été le cas, et
que j'ai vu avec étonnement qu'on a commencé immédiatement à mettre en
oeuvre les quelques propositions clés que j'ai avancé.
Exemples: On a Le chemin "Ho Chi Minh" (je lis ses oeuvres en ce moment)
c'est à dire la création d'un sentier non-marqué et dans ce cas
accessible seulement à pied, le long des 27km, indépendant de l'accès
routière, c'en était un. L'utilisation de caillebotis et de caillebotis
inondables en était une autre, pour protéger contre les mares de boue et
la destruction de la nature que notre présence imposait - exactement
comme dans les tranchées. L'abandon total des portables et l'utilisation
de messagers entre les différents points de guet, un autre. Avoir des
"marchés" rotatifs, accueillis chaque semaine par un campement
différent, en était un autre. Aujourd'hui, il paraît que cela s'est
résédentarisé, autour de la vacherie.
Lorsque certains des pouvoirs en place à la ZAD ont tenté de me menacer
de violence, les combattants m'ont protégé, ce qui m'a fait
incroyablement de bien. Le problème avec ce milieu anti-état, c'est
qu'il peut vite tomber dans les mains de démagogues et de personnes
ambitieuses qui font n'importe quoi. Cela n'a pas marché à la ZAD, au
moins pendant la période de la plus grande massification du mouvement
(dans les mois précédant la marche "ZAD Partout" sur Nantes et le
"Festi-ZAD"), parce que les plus "charismatiques" avaient horreur de
l'inéquité et ont mis aux marges les "centriques" qui avaient la
main-mise sur les réunions, et que les "fantassins" du mouvement étaient
contre toute hiérarchie. Ce n'est pas ce que vous entendrez, de ceux
qui sont restés à cette ZAD ou dans le mouvement "constitué". Mais,
démocratiquement, c'est une réalité. La ZAD a été gagnée, en grande
partie, par des "anciens" de 22 ans des émeutes à Paris de 2005.
Actuellement, on est en train de proposer une série de "Road Protests"
autour de la France pour octobre, c'est-à-dire la recette des années
1990 en Angleterre, en partie émulée dans les années 2010 en France.
Soulèvement a déjà signalé un grand convoi qui déscend sur Paris, avec
tracteurs! Les tracteurs, c'est une manière de simplifier la logistique
et de ne pas mettre à dos les "paysans", héritiers du mouvement de
Larzac des années 1970!
A Nimes, je notes avec intérêt, on propose de faire un convoi local, ce
qui commence à me donner de l'espoir. Ici, on a déjà rejeté l'idée, sans
discussion. Il faudrait, pour moi, le faire totalement sans voitures,
sans lithium, sans essence et sans portables, si l'on veut être
crédible, écologiquement et socialement. Pour cela, il faut avoir déjà
une logistique de chemins réguliers de marche - ou pour vélo.
Les implications sont énormes - comme pour la société en générale - la
conversion écologique nécessaire, urgente, implique de remplacer les
routes à voiture par le transport humain. Il serait tout simplement
absurde que nous ne prenions pas le devant, en tant que mouvement
écologique, dans nos pratiques. Les "convois" devraient être sans appui
logistique véhiculaire.
Or, toutes ces luttes contre les "grands projets inutiles" ont, jusqu'à
là, étaient presque totalement dépendants du transport motorisé à grande
distance, pour converger sur un point focal - une ZAD. ZAD Partout a
été la réaction tout-à-fait logique de ceux qui ont expérimenté cette
technique, mais qui n'a pas été adopté. Résultat, ils se sont trouvés
complètement coupés des actions une fois repartis chez eux.
Actuellement, on propose de bouger des militants d'un bout de la France à
l'autre en voiture, pour assurer le nombre de participants. Très
mauvaise idée. Il faut de l'essence - de l'argent, donc, et on est
débordé, logistiquement, dès que l'on a un peu de succès.
Ceux qui ont vraiment fait la différence à la ZAD venaient des banlieues
pauvres de Paris, vivaient dans des conditions épouvantables sur place,
ne pouvaient pas quitter la ZAD, sans voiture, tout en voyant des gens
plus riches entrer et sortir à leur grè. Depuis, ce sont ces gens riches
et bien connectés qui sont restés en contact, sans les classes
populaires qui ont gagné l'affaire.
Pour qu'on ait un mouvement qui dure dans le temps, il faudrait donc une
logistique qui dure dans le temps et qui est socialement équitable. Je
propose de régulariser nos mouvements, au point que ces mouvements
humains physiques constituent l'infrastructure de communication et de
transport durables. A ce moment-là, les pauvres, et pas seulement les
classes moyennes, peuvent s'y investir et peser dans le processus
décisionnaire. Là où ils sont. A la campagne, par exemple.
Ici à Montpellier, je suis persuadé qu'il y a suffisamment d'élus et
d'administratifs de la métropole qui cherchent sincèrement à trouver des
groupes solides pour prendre en charge les diverses terres en friche et
en intercalaire autour de la métropole. Je propose d'en créer des gîtes
de passage - près des marchés, qui permettent d'offrir réfuge et
travail à ceux qui viennent à pied ou à vélo. J'ai déjà eu suffisamment
de contact avec des responsables pour savoir que cela serait faisable.
Je cherche à stimuler la création d'un groupe qui réunira cette
information, qui prendra les contacts et qui passera à l'acte - et vite.
De cette manière, on pourrait relier, regulièrement, le centre de
Montpellier avec les banlieues, les banlieues avec le périurbain, le
périurbain avec le rural - se solidariser.
Dans les road protests, en Angleterre, on a pris comme modèle les
Diggers du 17ième siécle, qui ont occupé des terres agricoles à
l'abandon près de Londres, sans demander à personne, pour pouvoir vivre
de leur travail vital. Dans le contexte actuel, en France, la
destruction des squats et la stigmatisation des ZADs ne donne pas cette
possibilité - et d'ailleurs, je trouve que le gouvernement a réussi à
déstabiliser la gauche en général par sa stigmatisation et
illégalisation de la désobéissance civile, depuis Hollande.
Mon objectif serait de rephysicaliser, relocaliser, ré-intégrer, en
présentiel regulier, les plusieurs acteurs, et de cette manière
accommoder la présence (inévitable) de plusieurs "étrangers", ancrés
dans le tissu local et solidaires avec le peuple. En ce moment, on est
en train de suivre le modèle américain d'isolement des quartiers riches
et bien-séants des milieux populaires. Je parle, bien sûr, de la
métropole, je n'ai que faire des quelques agriculteurs capitalistes qui
ont pris possession de nos campagnes - à moins qu'ils ouvrent leurs
portes, et leurs champs, aux dépossédés, cantonnés jusqu'à ici dans des
quartiers denses et populaires "chauffés à blanc".
Ceci pour attaquer, frontalement, le problème d'une ZAD "hors sol" qui
crée une antipathie viscérale entre "gens du coin" et "ZADistes", comme
cela s'est passé à la ZAD de Nantes et bien d'autres. Avec des militants
d'extrème gauche téléportés de tous les coins de la France et plus loin
en voiture, ce n'est pas étonnant. J'ai été franchement très perturbé
d'entendre parler, hier soir, par des bribes et des brins, du niveau de
confrontement physique entre "la jeunesse du coin" et, par exemple, des
groupes Coord'Eau/Ou la la venus manifester devant des instances
décisionnaires sur la gestion de l'eau, sur les mégabassines, etc., dans
des petites villes de campagne de l'Hérault autour de Montpellier. Je
n'ai "que faire", de nouveau, de ce populisme de riches qui existe à la
campagne et qui risque de nous faire virer à l'extrème droite. Les
agriculteurs de bonne conscience savent déjà de quoi ça traite et sont
avec nous, s'ils peuvent l'être, économiquement. A nous de leur apporter
notre force de travail et soutien.
Pendant que le temps de l'action possible s'écoule, j'observe ce
phénomène de gestion par les plus prédisposés à la violence s'engrèner,
en pensant que cela risque de continuer come ça, sans aucune proposition
par les actes de vivre une autre infrastructure, et que cela favorisera
surtout la droite anti-écologique.
Je dis souvent que "je suis SDF" - pour illustrer cette anomalie - je
pratiques une vie écologiquement cohérente et je suis ainsi condamné à
la plus forte discrimination - pas pour moi les transports en voiture
vers des lieux de lutte contre les mégaprojets - j'irai en vélo ou je
n'irai pas. Comme il n'y a aucune logistique réfléchie pour permettre
que j'assiste aux événéments prévus, je n'y serai pas. Je ne serai pas
aux grandes réunions nationales, ni aux pourparlers entre les groupes,
jusqu'à ce que l'on constate la richesse humaine du lieu où je suis.
Une logistique réfléchie est: des lieux de stockage, des lieux
d'hébergement et de travail utile, sur le chemin. Le transport
écologique ne commence à faire du sens que lorsqu'on fait des
provisions, pour les gens, pour dormir sur place, sur le parcours, sinon
c'est juste la mobilité des riches et oisifs. Actuellement, les seuls
voyageurs qui arrivent à tenir ont des camions. Les cuisines populaires
ont des camions - les festivales sont des vraies fêtes de
l'hyperconsommation, possibles seulement parce que les camions
transportent toute l'infrastructure, laissant rien de durable après,
pire que les Jeux Olympiques. Les services à la personne ont des
véhicules, tout ça coûte un bras. Même pour les véhiculés, les endroits
où ils peuvent se garer sans être importunés se réduisent à peau de
chagrin. C'est un peu évident, lorsqu'on y réfléchit - un camion prend
de la place et nécessite un accès véhiculaire, dès qu'il y en a beaucoup
cela représente un grand problème. Une simple présence humaine
nécessite peut-être cent fois moins d'empreinte au sol, surtout parce
qu'on utilise l'infrastrcture sur place.
La proposition de circuits que je maintiens est une simple évidence générique pour résoudre ces problèmes. Mes écrits, sur https://inecodyn.fr
donnent plusieurs exemples de ces techniques, appliqués à différents
contextes. J'invite cordialement à qui veut, par exemple, à
m'accompagner sur la Dourbie, entre Nant et Millau, avant de nous réunir
le 3-6 août sur le Larzac, vous pouvez le lire sur le site cité,
puisque j'ai déjà fait la reconnaissance, 4 ou 5 fois, l'automne passé.
Si je ne présente pas toujours bonne mine, c'est que j'en ai marre de
l'hostilité répétitive des activistes, vivant à la campagne, qui n'ont
aucune intention de délaisser leurs voitures et tracteurs, leurs
portables ou leur biocoop et qui ne veulent pas de "ZAD" chez eux. Soit.
Mais qu'ils ne se réclament pas du mouvement écolo, dans ce cas. Ce
mouvement est actuellement bourré de groupes d'amateurs de la nature qui
ne parlent même pas des aspects sociaux humains. Qu'ils ne se réclament
pas écolos, dans ce cas: l'écologie est sociale! Ce n'est que lorsque
le peuple possède l'écologie, dans ses pratiques quotidiennes, que l'on
a des chances de s'en sortir. Nous sommes la nature qui s'éveille.
C'est le paradoxe auquel on ne veut pas faire face. L'écologie a déjà
souffert des revers énormes, parce qu'elle s'est associée avec le
Nazisme, via l'eugénisme. Si l'écologie peut de nouveau devenir une
force politique, ce sera parce qu'elle propose des solutions pour
l'ensemble de l'humanité - des modes de vie qui permettent à tous de
vivre, y inclu les autres êtres vivants. La conservation de la nature,
par contre, n'est pas la conservation des humains. Au pire, cela devient
une politique d'exclusion des humains, pas très différent des
politiques d'exclusion des réfugiés, des immigrants, etc. Dans ce cas,
le mouvement écolo sera un mouvement d'élite et plutôt à droite, comme à
présent. On le voit, par exemple, dans le soutien apporté aux indigènes
au Brésil ou dans le Chiapas - si seulement il y avait autant de
soutien pour les pauvres des bidonvilles d'Amérique Latine - qui ont
besoin de terres pour vivre !
Vous pouvez supposer que j'en sais quelque chose. Ici, à Montpellier,
cela a été presque impossible de trouver un lieu stable de travail et de
contact, à travers les réseaux activistes. En été, cela devient à peu
près impossible. Je cherche, tout simplement, à en témoigner - on a
besoin d'utiliser plus efficacement l'infrastructure existante, qui
reste vide une bonne partie du temps. Les problèmes de logement actuels
sont le résultat du non-partage équitable de ces ressources habitables,
plus abondantes que jamais, mais réservés à l'usage ou non-usage
exclusif des classes moyennes-supérieures. Tout endroit occupé par un
humain, d'ailleurs, est, de fait, un lieu de vie. Face à la sécheresse
et la canicule, nous devons tous jouer notre part.
On 04/07/2023 17:17, inecodyn wrote:
Via les liens donnés aux articles, je tombe sur ce paragraphe, dans un article de Reporterre ( https://reporterre.net/Repute-sur-Protonmail-a-livre-a-la-police-des-informations-sur-des-militants-climat ) , citant un responsable de la Quadrature du Net :
L'association de défense des libertés la Quadrature du net juge
l'affaire [Protonmail] révélatrice : « Le milieu militant doit désormais
réfléchir profondément à ses usages du numérique , dit à Reporterre
Arthur Messaud, juriste au sein de l'association. Pendant longtemps, on a
invité les militants à se former au chiffrement, à trouver les
meilleurs hébergements mais aujourd'hui on s'interroge &r aquo; ;.
Face à l'arsenal policier et au renforcement de la répression, les
activistes doivent, selon lui, « désapprendre à se croire en sécurité
sur internet même s'ils pensent avoir de bons outils. On devrait plus
faire attention à ce que l'on se dit, à comment on se le dit et à qui on
parle. »
Je signale que ce propos est celui que j'ai essayé d'avancer à
quelques reprises maintenant. Il faut apprendre à se parler de vive
voix, et être en capacité de se déplacer, physiquement, pour ce faire,
si nécessaire. Sinon, à quoi bon, les groupes locaux?
Le rôle de circuits reguliers est de permettre le regroupement
habituel, le contact avec la population du lieu, l'échange et
l'association libre, sans se trahir, mais au contraire en raffermissant
les liens de proximité.
C'est plutôt un problème à rebours, donc. Dans la mesure que l'on
réussit à retisser un réseau "securisé" basés sur l'échange numérique et
téléphonique, on ne laisse plus passer de l'information à n'importe
qui. Il devient même assez difficile de s'auto-informer. On a en
particulier un problème avec les rencontres en présentiel, qui est une
autre manière de dire que l'on a du mal à concentrer suffisamment de
gens sur chaque chantier physique. On s'envoie plusieurs petits messages
de dernier moment, pour vérifier qui va où, sur les mailing lists!!!
Là où il e st dit que l'"On devrait plus faire attention à ce que
l'on se dit, à comment on se le dit et à qui on parle", c'est de cette
réflexion que je parle - comment fluidifier l'information qui court,
sans téléguider des forces hostiles sur chaque réunion, chaque tentative
de désobéissance civile?
C'est sur ce "comment faire" sans numérique que je me centre, il y a
un vrai hygiène de vie à intégrer. Sans téléphone portable et accès
internet personnel, je me rends compte que suis exclu des réseaux de
communication - c'est-à-dire qu'aucune provision est faite pour des gens
dans mon cas, qui est vu comme exceptionnel et hors normes. Donc on est
bien loin du but, si par ses propres méthodes internet-dépendant, on
marginalise le plus ceux qui pratiquent ce qui est préché. Je note, par
exemple, que le groupement "Changeons le système, pas le climat", n'est
accesible que par ceux qui acceptent les cookies de Facebook!
Beaucoup de ceux qui n'ont pas de téléphone vont quand même vivre
en groupes physiques sociaux où il y a un accès fiable aux réseaux
sociaux numériques, en cas de besoin, ce qui n'est pas le cas pour des
nomades sans téléphone. Les lieux physiques sociaux de rassemblement
sont ouvert très peu, et pour d'autres raisons que pour servir de "café
du coin" - pour l'événémentiel, pour les réunions de chaque assoc., sur
des horaires différents. Les réunions peuvent vite entrer en conflit ou
se dupliquer. La situation devient illisible, obligeant à l'usage, la
dépendance, même, sur l'internet pour s'informer et remplir son emploi
du temps.
Les instruments d'une autre époque, les marchés hebdomadaires et le
journal sur un support non-numérique, localement généré, deviennent de
nouveau pertinents.
La clandestinité et le chiffrement favorisent la constitution de
groupements qui, justement, ne sont pas transparents, ne doivent de
compte à personne et qui, dans le pire des cas, sont pénétrés, pour
assurer leur innocuïté ou créer des contre-exemples, ou des coups
montés. De les utiliser en première ligne de communications est donc de
se tirer une balle dans le pied, au niveau de la transparence du
mouvement.
Pour cela, je fais ma part pour essayer de rendre légitime le débat
général sur de telles problématiques, une tâche nécessaire pour la
confiance de chacun dans les valeurs que sa participation est en train
de faire naître. Le soutien plus général de la population, basé sur la
confiance, est à ce moment-là atteignable.
🖶
↑
↓
dimanche 2 juillet 2023
News Digest 3 – Actions écologiques – Montpellier
Cela a été un weekend assez chargé. Si j’ai hésité à faire un News
Digest le vendredi, c’est qu’avec deux ou trois réunions le vendredi et
samedi, suivi de dimanche à l’Agropolis toute la journée, cela n’aurait
pas eu de sens.
Commençons par cet événement, l’Agropol’eats, de 10-23h ce dimanche.
Cela s’est passé au bord du Lez et autour du Moulin des Canoës.
Il y avait pas mal de confusion sur le thème central de ce festival –
apparemment c’était la crise de l’eau, mais aussi de la bouffe. Un point
de fierté de l’organisation était que le repas (10 euros) venait tout
de pas plus de 80km de Montpellier, … et avec un peu d’hésitation, …
sauf les épices, bien sûr.
Je rajouterais « sauf l’énergie fossile ou électrique » – il paraît que
70 % de ce que l’on mange, c’est de l’essence – à moins qu’ils voulaient
dire que c’étaient des hydrocarbures raffinées localement, et que les
camions étaient naturalisés 34. Et il faut mentionner que l’eau, elle
vient de plus en plus du Rhône, un peu plus loin.
Le maire de Grabels, qui était plutôt astucieux et franc-parleur,
expliquait les complexités et conflits administratifs assez clairement.
Il mentionnait la politique que j’admire, franchement, dans la
métropole, de donner les premiers mètres cubes d’eau avant de pénaliser
la surconsommation par degrès, chapeau. Je l’ai entendu très tôt le
matin sur France Culture, il y a deux ou trois mois, parler dans sa
fonction de gestionnaire de la régie des eaux dans l’Hérault. Il a été
encore plus franc à la radio qu’en personne. Néanmoins, son analyse
restait dans les mètres cubes et la tuyauterie – comme si l’eau était
faite pour être séquestrée. Mais je crois qu’il était trop rôdé dans la
diplomatie du langage intelligible aux vignerons et à la FNSEA pour
faire autrement.
D’ailleurs, rappelons-nous que l’un des tabous maintenus dans cet
événement était celui d’éviter la proposition d’expulser en masse les
quelques viticulteurs qui restent à la campagne, avec leurs machines,
entre les résidences sécondaires et les gîtes de vacances vacants. On
maintient la fiction que l’on pense encore pouvoir les convertir. On dit
aussi penser que les urbains n’ont aucune aspiration à devenir ruraux.
On dit « il faut des idées radicalement nouvelles » … mais non, en fait,
pas celle-là.
Les autres intervenants choisis pour la table ronde étaient des experts
de toilettes sèches, un consultant, une adjointe (maire aussi) de la
métropole, une responsable de la région (Aude), un practicien (Olivier)
de méthodes beaucoup plus consonantes avec la réalité, au niveau
pratique, qui travaille au sud du Maroc, en zone aride. C’était le seul,
à mon avis, qui avait la moindre idée de ce qu’il faut faire, et
pourquoi, sur le terrain - mais au Maroc. Il y avait deux sessions,
j’espère que je n’ai oublié personne.
Selon Reporterre, une ville qui s’est trouvée à sec, dans les P.O., a
commencé à faire des trous dans le béton, pour désartificialiser – on
voit des photos. J’ai noté qu’on fait pareil à Montpellier maintenant.
Ce qui est assez amusant, c’est que ces endroits minuscules ne sont pas
aménagés pour que l’eau s’écoule dedans, puisque on a oublié encore de
créer les canalisations qui y amènent. Ils sont purement cosmétiques,
pour l’affichage, jusqu’à là, des mètres carrés sur un plan. Un contact
architecte-paysagiste sur des grands projets de construction autour de
Montpellier m’a raconté jusqu’à quel point cela lui a été difficile de
faire introduire des surfaces poreuses, capables de faire l’éponge,
entre bâti et route. Ce n’est pas encore dans le lexique des
développeurs, il paraît.
Entre la loi, et ce qui continue de se faire, par ceux censés l’obéir,
il y a un gouffre visible – et contagieuse, d'impunité climatique. On
l’a expliqué dans ces réunions, composées presque exclusivement
d’étudiants, de professeurs et d’organisations locales autour du «
fleuve » Lez, friandes de « la nature », à l’exclusion du peuple
nuisible et incorrigible. Je me demande combien d’entre eux ont vu le
film « De l’Eau jaillit le Feu », qui montre l’assèchement et
l’eutrophication du Marais Poitevin, autre espace Natura 2000, grâce aux
mégabassines de quelques méga-agriculteurs industriels.
De l’autre côté de la rigole (OK, fleuve) Lez, une série de champs
industriels irrigués nous regardent, en rigolant silencieusement. Un
intervenant mentionne que l’on va tenter d’insonoriser la voie express
qui perturbe le silence studieux de l’Agropolis. C’est dans le cadre
d’une consultation publique sur quoi faire du triangle de Bermude,
pardon du Zoo de Lunaret, encore plein de choses que l’on « va faire »,
alors que les bâtisses et les friches restent résolument vacantes. J’ai
noté que les scouts de France (ou les éclaireurs, peu importe) ont une
capacité assez impressionante d’« occuper » des bâtiments sans y être,
la plupart de l’année, presqu’à l’égal des autorités locales. On a parlé
aussi des chiffres pour les terres potentiellement productives autour
de la métropole, fragmentées et non-entretenues, en attendant Godot.
Cela aussi, c’est contre la loi, normalement.
Mais l’un des intervenants a eu la grâce de contraster la perception
d’un décisionnaire qui allait d’un endroit climatisé à un autre toute la
journée, avec l’expérience de celui qui est en train de s’écrouler de
chaleur dans la fournaise des mal-logés à Figuerolles ou des logements
sociaux de la Mosson. Comment se faire entendre ? C’est comme ça depuis
Marie-Antoinette et sa malheureuse phrase. Je sais qu’à cet événement,
au moins, il n’y avait aucune place donnée aux pauvres, qui n’étaient
pas là, en tous cas, sauf moi. Je n’avais qu’à regarder les autres
manger leurs légumes bio et à mendier un gobelet en plastique pour
prendre de l’eau. La serveuse voulait me donner un euro quand je lui ai
redonné le gobelet. « On me l’a donné » je lui ai expliqué, en refusant
la pièce. Elle a eu du mal à comprendre. On ne « donne » pas, sinon les
gens s’en vont avec. J’ai vu un gobelet d’un euro, étiquetté
Agropol’eats, partir comme une cygne sur les eaux – ils n’ont pas pensé à
ce que, pour un riche, surtout bourré, un euro n’est rien.
J’ai pu parler, dans les tables rondes. Ils pensaient que c’était une
question, mais j’ai expliqué que ce ne l’était pas, puisque c'était une
table ronde ! J’ai dit que les décisionnaires étaient devenus
complètement hors sol – comment voulaient-ils créer une politique
consensuelle, avec une société active, si cette société était totalement
habituée à ce que « les experts » s’en occupent sans les importuner ?
J’ai sans doute touché à un nerf un peu sensible, c’est quand même
l’enseignement qui est leur métier. Des hardes d’enfants passent entre
leurs mains chaque trimestre. Mais c’est un enseignement qui échappe à
peu près totalement aux classes populaires – qui votent. Est-ce qu’il y
en a, d’entre ces milliers d’experts affûtés, quelques uns qui ont pensé
sérieusement à comment communiquer leur expertise à tout le monde, et
rapidement, pour qu’ils puissent voter de manière éclairée – et (ne vous
évanouissez pas) peut-être faire quelque chose d'utile eux-mêmes ?
C’est très préoccupant, j’ai eu la forte impression qu’aucun d’entre eux
osait dire « Oui, c’est nous qui avons merdé, grave, pendant les vingt
dernières années, et c’est pour cela que nous vivons dans un
quasi-désert aujourd’hui ». Non, le refrain était plutôt, « moi,
personnellement, j’ai fait de mon mieux, la responsabilité pour cette
catastrophe déferlante, il faut la chercher ailleurs ».
Oui, mais vous, et vos milliers de collègues hydrologues, agraires,
etc., l’ont vécu grassement, pendant ce temps-là – en hâtant notre
suicide collectif avec de nouvelles méthodes industrielles, ce n’est
quand même pas rien.
On peut remarquer que le désavantage des institutions tellement vastes,
c’est que l’on peut passer des décennies dans un laboratoire à écrire
des algorithmes pour mieux analyser des images de microscope, sans
jamais se sentir responable de quoi que ce soit, au niveau des décisions
stratégiques de l’institution. J’envoie ce lien – d’un syndicat du CNRS
qui se plaint d’être contraint à envoyer des gens sur la lune, sans
consultation, une décision sans doute politique qu’il rejète, pour des
raisons écologiques, mais surtout parce qu’il n’a pas été consulté avant
la prise de décision.
https://espacetests.sud-recherche.org/SPIPdev/spip.php?article3270
Sans que cela change quoi que ce soit, le CNRS ayant une hierarchie de
fer, strictement vertical. Les universitaires/académiques ont ceci
d’amusant, en commun avec les organisations « non-gouvernementales »
(les assocs.), ils se parlent en chuchotant en petits groupes, pour ne
pas risquer d’être entendu par des gens de l’extérieur, sur leurs
conditions de travail, leur maltraitement, tout ça, pour ensuite
présenter des fronts à peine désunis pour défendre leurs institutions
(leurs boulots) devant le grand public.
Laissant le fardeau de dire l’indicible (et l’anathème) à des gens comme moi. Merci.
Comme ce feu qui jaillit de l’eau, de telles langues de bois (sec)
risquent d’enflammer la situation, surtout en période d’étiage – elles
ne font plus sens – ne disent absolument pas ce que peuvent FAIRE les
gens, pour eux-mêmes contrer cette crise hydrique. Ce serait même un peu
intelligent, politiquement, de reconnaître publiquement l’existence
d’une opposition écologique – un schisme – au sein de ces institutions,
pour tenter de faire exister un débat raisonné dans le sphère public.
Et pour trouver un moyen de reconnaître ses erreurs, sans perdre la confiance du public. Hypothétiquement.
Il devient absolument nécessaire de présenter des fronts unis, au niveau
local, qui intègrent de plus en plus les populations profondément
touchées. C’est une évidence. Mais pas à Agropolis. Agropolis, qui
s’occupe du sol, est vraiment hors sol, à Montpellier, dans le sens que
sa volonté affichée d’impliquer les populations locales a comme résultat
la consolidation d’une petite élite d’experts, leurs followers,
familles et contacts sociaux, un peu comme dans une « fête de village »
pour l’élite intellectuelle scientifique, ponctué par les décibels
insupportables du mégaphone et des amplis qui tuent toute conversation
d’un bal de village.
Passons outre.
La prochaine réunion à raconter, c’est celle de l’organisation des
hyper-terroristes écolos qui va sous le nom de « Soulèvements
Montpellier ». C’est à peu près les mêmes gens qu’à Agropolis, grosso modo
– pour illustrer la petitesse du mouvement politique écologiste – c’est
vraiment ridiculeusement minuscule, étant donné les enjeux de vie ou de
mort collectives qui nous font face. Je ne vois pas, non plus, pourquoi
nous ne pouvons pas l’avouer. Nous avons échoué, presque totalement, à
mobiliser le soutien populaire autour de notre problématique, qui est
maintenant associée dans la tête des gens avec les ZADs (l’anarchie
chaotique et violente, mais qui n’est plus cantonnée dans le banlieue)
et qui touche donc les intérê ts d’une minorité des riches qui vivent à
la campagne, hors sol.
Il faut quand même reconnaître qu’ils ont plutôt raison dans leur
analyse, sauf pour la violence – on ne sait absolument pas s’organiser.
Les Soulèvements de la Terre a donc eu sa deuxiême réunion le samedi
avant la fête d’Agropolis. J’ai appris, d’une personne qui a rapidement
listé une série d’événements cet été, qu’elle « n’avait pas le temps »
d’en informer le mailing list, je ne suis donc pas en capacité de vous
en dire plus.
En tous cas, ces « événements » étaient plutôt ailleurs qu’à
Montpellier. Le mailing list de Montpellier est maintenant (ou bientôt)
censuré de fait, étant aboli, d’après ce que j’ai compris (‘on’ l’a
proposé à la réunion, et ‘on’ fait plutôt à sa guise, jusqu’à là) et
l’eau de l’information locale rentrera de nouveau dans l’obscurité de sa
tuyauterie souterraine. C’était l’un des sujets qui a pris beaucoup de
temps – comment « sécuriser » les communications. Apparemment la
solution serait de ne plus se communiquer et surtout de ne pas
s’identifier. Etant donné que l’on se connaît à peine, ce n’est pas un
bon début.
Le groupe de travail « gouvernance » a, de manière un peu trop voyante,
trouvé manière de s’imaginer « la Gouvernance » et point, dans les deux
semaines sans AG, un peu à l’instar de Napoléon dans la Ferme des
Animaux, et a même inventé de toutes pièces un groupe (2 personnes
auto-nominées) d’urgence qui allait prendre toutes les décisions, entre
les AGs. Le Groupe de Travail Science a eu droit a quelques mots, en fin
de réunion, au moment où tout le monde ne pensait qu’à se casser. Je ne
sais pas ce qui s’est passé avec les autres groupes de travail.
On a ainsi réalisé le coup de ne pas parler de stratégie, la « stratégie
» actuelle étant de soutenir ce qu’a déjà décidé Ou la la le lien
(contre l’autoroute) et Coord’Eau (coordination de l’eau dans l’Hérault)
qui sont en tous cas à peu près les mêmes gens, à quelques kilomètres
près.
C’est ça, l’essence de l’expérience que j’essaie de capter, un ou
quelques groupes vraiment petits, avec zéro proposition stratégique ou
même politique (juste des obsessions partielles – exemple « toilettes
sèches », ou « un événement par rapport à 7km d’autoroute à six mois de
maintenant ») sur quoi faire, pour remplacer le système qu’ils
attaquent. Je spécifie : le système de transport routier, quelle est la
proposition, avec ou sans voitures, et si sans, comment ?
Et qui sont vénères, en plus – ils ne veulent aucun débat et aucune
proposition concrète, non plus. Si l’on a encore le désir que le
groupement existe, c’est qu’il n’existe aucun autre moyen d’échanger, au
niveau local, et de ne pas se sentir seuls – il faut quand même un
minimum de corps physiques rassemblés, si ce n’est que pour prendre la
photo. Mais je suppose que ceux qui ont les moyens de faire des sauts à
Lyon, Toulouse, Marseille, Paris ou Strasbourg, à Notre Dame des Landes,
le Marais Poitevin ou Clermont l’Hérault, vont progressivement se
détacher des ploucs sans essence, qui seront réduits à les voir passer
comme des étoiles, au-dessus de leurs quartiers chauffés à blanc.
Je ne me suis pas senti seul parce qu’une très vieille dame est venue me
chuchoter, avant de partir, qu’elle était très d’accord avec moi,
qu’elle-même, elle faisait pousser des plantes sur son balcon (on sait
que c’est dans les bidonvilles, sur des surfaces minuscules et sans
aucun expert qu’il y a l’usage le plus efficace de l’eau pour faire
pousser les légumes), et elle m'a dit « pourquoi est-ce qu’ils n’ont pas
répondu à votre question, hein ? » – j’étais super content, en fait, de
ce petit acte d’empathie. Une autre dame a eu la gentillesse de me
remarquer que j’ai mis ma chemise à l’inverse, tout le monde n’est pas
mauvais.
Il m’arrive de penser que dans ce monde de machines, nous sommes
maintenant considérés comme des idiots qu’il faut gérer, idéalement
cloués sur place avec des puces pour tracer tous nos mouvements, des «
rule-based-systems », c’est-à-dire des intelligences artificielles des
années 1980, tandis que les algorithmes numériques ont la liberté de
créer, en libre association d’idées, sans devoir prouver qu’il y a
méthode à leur folie. Moi je pense que celui qui le pense l’est – et que
si la solution technique est de demander à Chat GP machin, bye bye
celui qui pense de lui-même.
Si je n’écris pas de la fiction, c’est parce que les faits sont là et l’on m’a dit qu’il faut absolument un récit.
L’autre événement – auquel je n’ai pas pu assister, c’était sur
l’alimentaire, à la Mosson, il y avait clash d’horaires, à part le fait
que c’est devenu un peu zone de guerre, ces derniers jours. ‘On’ m’a
expliqué que c’est parce que ce sont des groupes exclusifs. Donc, pas de
quoi manger, non plus, on se sent un peu intercalaire.
🖶
↑
↓
mardi 27 juin 2023
Conducteur de l'Ô
pour l'original avec images cliquez ici
Il y a assez d'eau pour tous sur cette planète, même un sur-plein, elle est gorgée d'eau.
quelques images
Aqueduct et pergola du Péyrou.Jean Moulin.sunset
Il y a assez d'eau pour tous sur cette planète, même un sur-plein, elle
est gorgée d'eau. C'est sa rédistribution et sa qualité qui posent
problème. Le capital "eau", il est accaparé par les plus riches,
séquestré et capté comme un trésor dormant par les barons des
mégabassines, barrages et centrales.
Mais, en principe, il y en a largement assez pour tout le monde. Avec la
chaleur montante du climat, l'atmosphère a une capacité d'absorption
d'eau qui augmente, il y a donc un mouvement global d'eau vers
l'atmosphère, des sources liquides - eau salée, eau douce, eau dans le
sol, envers son état gazeux. Il y a plus d'évaporation et plus de
précipitation, pas de problème de pluie donc, globalement, même si son
dynamique, les orages, les cyclones, tornades et épisodes de grèle,
s’intensifient, l'énergie globale contenue dans le système
météorologique ayant augmentée.
C'est la où ça tombe et là où ça ne tombe plus qui posent problème,
surtout. Et encore, ses "qualités", qui se perdent, eau douce, saumâtre,
eau vivante, eau morte, eau liquide, eau libre, eau adaptée et intégrée
à la vie (organismes du sol jusqu'à nous-mêmes, 90% eau).
Comme on le voie, l’eau a sa propre bio-diversité. Elle a toute une
gamme de « manières » d’intégrer les écosystèmes, elle a ses « qualités »
et ses « états ». De la vapeur à la glâce, plus elle est saturée en
sels et minéraux, moins elle est douce. L’osmose est une pratique dont
se sert la vie pour récupérer de l’eau douce à son usage. Cette fabrique
des éléments clés de la vie, elle dépasse l’échelle industrielle, elle a
toujours été globale, elle est notre usine collective à gases, à
oxygène, à dioxide de carbone, à nitrogène, méthane ...
Alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi parlons-nous de sécheresse, de
températures intolérables, de moustiques, de désertification, d'érosion,
de sources et de rivières qui se tarissent, et de bassins et de bassins
versants entiers qui s'assèchent, ...?
Il se peut que les gens ne sont pas encore mis à penser à ce qu'ils
peuvent FAIRE, du bas vers le haut, sur ces problèmes d'eau. Parce que,
tout simplement, on a l'habitude que les autorités publiques et privées
"gèrent" l'eau, pour nous. Eh bin, si c’est une question de gestion, il y
a quelques petites lacunes, vu les résultats.
Tout est à une échelle plus grande, sans détails, sans spécificité. La
raison est simple. On ne s'est pas encore engagé avec le problème et on
ne sait RIEN de comment faire encore, à l'échelle sociale humaine. Nous
avons à réinventer toute une culture, une hygiène de vie, par rapport à
l'eau, et en peu de temps.
Et si l’on essayait nous, de gérer ?
Une situation que l'on va essayer de commencer à rémédier. Parce qu'il y
a plein de choses que nous pouvons faire, dans le détail, qui sont à
l’antithèse du modèle industriel présent. On ne parle plus du tout de la
tuyauterie et des réservoirs. Pourquoi ? Parce que le « partage des
eaux » est le principe même de l’opération. On n’essaie pas de
séquestrer l’eau, la mettre dans des pipelines, enveloppée d’acier, de
plastique, de caoutchou et du béton, en privant le milieu naturel de
tout contact. On la partage. La non-artificialisation des sols est
tout-à-fait basique, dans cette équation.
- Construire et entretenir des mares,
- créer des espaces ombragés et des tunnels de vent rafraichissant
- créer des haies et des accidents de terrain pour éviter le déssèchement causé par le vent
- attraper la rosée, avec des couches de végétation adaptées à ces tâches
- créer des espaces "sous forêt" où les arbres peuvent réguler l'humidité
Le cumul de toutes ces interventions, le résultat, c'est un paysage
moins aride et plus humide. La condensation (rosée) ou la précipitation
(pluie) auront tendance à être localement sensibles à ces « ilôts et
couloirs verts », parce qu’ils créent des différences thermiques plus
fortes, en maillons plus denses, ce sont des changements
microclimatiques qui, cumulés, créent des changements macro-climatiques
et qui favorisent une précipitation et une humidité plus élévées.
- Il faut agir en faveur du vivant. Une mare d’un ou quelques mètres
cubes permet d’établir un écosystème de « prédateurs de moustiques »,
pour faire simple, à toutes les stades du cycle de vie des moustiques,
tels que les larves de libellules, les amphibie. Toute cette biomasse
augmentée contient elle-même plus d’eau, comme la bosse d’un chameau. Le
sol se repeuple d’organismes (c’est le fameux humus) et peut de nouveau
jouer son rôle dans l’accumulation d’eau et le cycle de la vie, ce
qu’on appelle « l’écosystème, une entité avec plusieurs facettes, …
- il y a plusieurs manières de créer des espaces ombragés et frais,
mais la mare profonde ou le puits profitent déjà de la géothermie, pour
maintenir des températures relativement stables, bien plus basses que la
température ambiente en été, bien plus hautes en hiver. En été, la
couche froide reste en bas, dans ces déclivités, il y a un taux réduit
d’échange thermique.
- Pour capter l’eau qui s’évapore d’une mare imbriquée, on encourage
des arbres et des buissons et des graminées autours et au-dessus. Cela
permet aussi d’éviter le rechauffement de l’eau par insolation directe.
C’est ce qu’on peut appeler « des accidents de terrain et des haies ».
S’il y a des rigoles qui alimentent la mare, elles seront également
protégés de l’exposition directe au soleil, l’été, par des herbes et des
arbustes (la ripisylve).
Plus vivant et plus biodiverse que ne peuvent jamais être le paysage de
champs et de vignobles industriels dénués, des véritables passeoirs
hydriques, qui vident nos terres de leur vies, ou de nos routes, des
couloirs d'assèchement, un système tellement hydriquement inefficace que
nous sommes obligés à vider les nappes, vider les sources, pour
compenser notre incompétence grossière collective par rapport à l'usage
de l'eau actuel.
Une autre version de cet écrit se trouve ici:
Conducteur de l'Ô
🖶
↑
↓
?
Apologie ZAD
Je ne suis pas encore assez apologétique, mais cela viendra ...
🖶
↑
↓
vendredi 23 juin 2023
News Digest 2 – Actions écologiques – Montpellier
Polissons contre la Répression
Petite réinformation au collectif qu’il y a un moment de libre-association en présentiel.l.e.s, ...
demain (samedi 23 juin) au Bar ricade, 5 Rue Bonnie (côté Poste), dès 10h, avec *accueil, *intervention d’une avocate et Cantine Populaire, ...
avant de
se déambuler envers la Tendresse, 80 Impasse Flouch*, qui
ouvrira ses portes non-fermées à partir de 14h (en sortant de la ville
sur l’Avenue de Toulouse, c’est sur la gauche, à la fin du bâti, après
le rondpoint du grand M).
*Ateliers : déplacement collectif
*Théâtre forum
et, dès 19h, *Repas + soirée musicale
Persona non grata ? Au nom de qui ?
Ceci en guise de « news digest » cette semaine, puisqu’on n’a pas pensé
le truc ensemble en étant dedans, face à la « menace » de l’« état ».
Ce qui pourrait perturber le doux déroulement des événements envisagés.
Plus de clarté la semaine prochaine, on espère !
🖶
↑
↓
jeudi 22 juin 2023
Oulala
Dans la réunion Oulala contre le lien (8km manquants qui complétera le
périphérique autoroutier de Montpellier), j’ai vu des gens qui étaient
anti-ZAD, il paraît par rapport aux expériences d’une ZAD qui a mal
tourné il y a deux ans. Il me manque les détails. Il n’y a aucune
intention, il paraît, de faire, ou même de proposer, des alternatifs au
modèle industriel, juste le réactionnaire de « pas de lien » et cela me
paraît, en bref, socialement regressif au plus haut niveau.
Politiquement, c’est ce genre d’action qui fait perdre toute crédibilité
populaire à l’activisme écologique. Que dirait un sans-papiers
marocain, qui trouve de l’embauche dans ces chantiers de déstruction de
la nature qui sont en cours partout autour de Montpellier, si les écolos
veulent juste qu’il perde son boulot, à cause d’un petit reptile qui
est un « espèce protégé » ? Pourquoi ne pas lui proposer un travail
horticulturel ?
Je pense que la première chose à réfléchir, c’est comment faire perdurer
et augmenter l’envergure des actions locales, avec une visée sur la
condition des plus démunis. Je propose, pour parler jargon, des circuits
ZAD – des ZADs mobiles et bien sûr, des ZADs partout. Je pense aussi
que les gens en ont marre d’actions purement à visée médiatique ou
symbolique, actes de présence, pétitions, actions légales et
constitutionnelles … au service des riches qui vivent à la campagne, qui
devient un périurbain totalement artificialisé, à l'exclusion des
pauvres qui vivent dans la métropole.
Il faut surtout défaire l’industriel en ville (et autour de la
ville, donc, pas une "ceinture verte" mais plutôt une corde
d'étranglement grise), pour la rendre vivable, et rouvrir la campagne
aux pauvres – qui ne sont plus là. Il y a des pauvres riches à la
campagne, c’est vrai, mais c’est parce que tout leur argent va pour
alimenter la voiture.
Il manque un modèle où les pauvres des villes peuvent, avec leur travail
manuel dans les jardins forestiers, venant à vélo et à pied, réinvestir
la plupart de la surface de la France, « peuplée » par des deuxièmes
résidences, des agriculteurs avec tracteur, sans ouvriers, et une
biodiversité inférieure à celle des villes et des « friches » attendant
le « développement » autour des villes – des déserts ruraux avec des
populations ageissantes.
Le problème pséphologique – que la campagne vote massivement à droite,
avec le « gerrymandering » systémique qui existe depuis De Gaulle, a une
solution immédiate – la repeupler avec des gens qui votent à gauche.
On est en train d’être poussés à penser, à proposer, et à faire vivre
des infrastructures, surtout au niveau transport et communications, qui
sont vraiment écologiques. Par le gouvernement – c’est cela qui est
triste. En illégalisant, en rendant chaque fois plus dangéreuses les
actions réactives, il oblige à penser à ce qu’on peut faire
positivement.
Le monde naturel n’est, après tout, que la réflexion des effets
combinatoriels de la vie. Si nous n’arrivons pas à nous combiner, nous
ne vivrons pas. La décision, à la ZAD de Nantes, un dur hiver de luttes
constantes, juste avant Noël, en 2013 il me semble, en tout cas j’y
étais, était d’envoyer chier tous les bienfaiteurs avec la malbouffe qui
s’amontonnait, et de commencer à labourer la terre, directement. Comme
les Diggers – mes ancêtres, qui au dix-septième siécle ont fait
exactement ça.
Lorsqu’on considère les zones à défendre, tree protests, free festivals,
et autres formes d’activisme, la chose qui marque, c’est l’arrivée sur
place de plusieurs milliers de personnes qui doivent être
nourries-logées et intégrées à l’action. Souvent, leurs mouvements en
voiture et leur manière d’occuper la terre détruit la nature qu’ils sont
là pour protéger. Ce qui est désolant, et qui commence à lancer la
réflexion, sur "comment faire".
Les autres formes de protestation, les manifs qui défilent dans la rue,
incidents créés pour attirer l’attention du média, n’ont pas ces besoins
logistiques. Elles sont éphèmères, et très peu chères.
Elles ne changent rien. Il paraît que les activistes écologiques sont
déterminés à se rendre marginaux, par rapport aux enjeux sociaux. Les
sans-abris ? Ils n’ont que faire. Les mal-logés en canicule ? Non plus.
Cela, c’est l’affaire des autres. Les réfugiés, les réfugiés climatiques
? Ce n’est pas notre business. On fait tout comme si le Rassemblement
National était déjà au pouvoir, en faisant l’amalgame entre localisme et
intérêts de la nature. Il y a une solution – de bouger, mais pas vite,
de laisser des traces positives sur son chemin, d’apporter de l’énergie
et des savoirs humains, de recevoir un bon accueil et orientation. Des
solutions humaines, gagnant-gagnant.
Il y a un entre-deux, une combinaison, qui agit au bénéfice des deux
populations, les sédentaires et propriétaires d’un côté, la main
d’oeuvre qui bouge et qui remplace la dépendance aux voitures des
populations âgées et isolées de l’autre. C’est justement ce système
d’accueil-orientation contre travail sur des circuits réguliers. C’est
un système qui gagne sur le système industriel économiquement. Celui qui
n’a pas de voiture à payer, il empoche ce qu’il gagne.
🖶
↑
↓
mardi 20 juin 2023
Humour
Il y a plein de trucs dans l’air du temps, des avions, des particules, …
On le voit dans les voix des humoristes, on dit un truc assez fort de
jus, mais d’une voix gentille et douce. Ça passe, ça passe pas, c’est de bonne guerre.
Le gouvernement l’a compris, il a interdit l’émission de Charline
Vanhoenacker (téléguidée à travers la direction - "sinon on vous
homogénéise"), 4 jours par semaine partis, il ne lui reste qu’une
misérable émission, contre son gré, ça va se condenser. Trop fort de
jus – le gouvernement a du dire « ça suffit, elle nous prend pour
des cons ». Mais c’est l’ensemble de la radio d’état qui est contre
l’état, elle est devenue le seul contre-pouvoir qui vaille, dans le
domaine public.
Radio locale, radio privée … pitoyables, perdues dans les vapes.
Insaisissables. Mais surtout, pour celles qui ont une audience, de
droite et fièrement connes. C’est donc sur la radio nationale,
monopolistique, qu’on entend la voix de la révolution sociale verte, et
nulle part d’autre, sauf sur Réporterre, Médiapart, Le Monde
Diplomatique et quelques autres « torchons numériques de
gauche » (je surenchéris, à tort, évidemment). Même les activistes
n’osent pas dire ce qu’on dit sur France Inter, pour pure peur d’être
accusés de radicalisme et bannis, bannis. Moi, je répète texto ce que
vient de dire un expert, prix nobel, charismatique à la radio, on me dit que je gâche la fête et que je suis trop critique - mais lui, s'il le
dit, ça va ... Première leçon de la critique, ici, critiques l’ennemi,
jamais l’ami, critiques toi, toi-même, jamais tes alliés.
C’est l’effet « Stop le Front National », les ennemis de mes
ennemis sont mes amis, front républicain, etc., bla bla. Depuis au moins quatre décennies. L’ennemi, c’est qui ? Aliène, elle est en nous,
et en plus, elle nous gère, hormonalement, de l'intérieur. On ne sait
plus ce qu'on pense, tellement on passe du temps à s'auto-censurer.
Juste pour rajouter le grain de sel, il se peut que, épaulé par le
prestige national, invité à maudire nos gérants, on se sent en mesure
d’aller plus loin que dans le débat local, où on marche sur des œufs.
Voilà, c’est dit.
L’humour. Lorsque je pense aux séries anglaises des années soixante,
soixante-dix, Monthy Python, Peter Cooke et Dudley Moore, et bien
d’autres, l’outrage aux moeurs, le rire de soi, c’était le plan de
bataille. Ce bombardement incessant de tous bords préparait le terrain
pour les changements législatifs qui sont devenus le politiquement
correct.
Résultat : aucune de ces émissions ne serait autorisée, aujourd’hui, en
France, elles tomberaient du mauvais côté des incitations à la haine,
stéréotypes raciales, etc. qu'elles contestaient. Mais les français, au
temps moderne, ont toujours eu un peu plus de mal à rire d’eux-mêmes.
C’est peut-être vrai pour l’Angeterre aussi, maintenant, la pomposité
est contagieuse. La manière de faire à l’époque, c’était “tongue in
cheek” (deuxième dégré à la enième). Sauf que les machines ne détectent
ni le tongue-in-cheek, ni l’auto-critique. Pas de risques, donc, pour ne pas se trouver en stigmatisation numérique résiduelle pendant toute une vie. C'est à ce point là. Pas de risques.
La langue de bois est devenue la langue des avatars numériques. J’ai vu
des gens tripoter un son sur des écrans hier soir. Ils y mettaient des
modulations. La voix, elle n’avait plus rien de commun avec nous,
mortels. Et ils étaient en train de chercher « le bon son ».
Ils sentaient, vaguement, qu’il y avait des gens « qui n’aimaient
pas ça ». Mais c’étaient eux, les professionnels. Dans toute leur
ineptitude.
C’était presque une performance en soi, deux grands écrans, des sliders, des desks, des bribes de chanson en boucle, un mélange de termes de
l’avant et de l’après « révolution numérique ».
Et le son, on se noyait dedans, comme des ventriloquistes. Et les
sliders, dans toutes leurs couleurs, bougeaient en synchronie.
Magique ! Mesmerisant. « I’ll put a Spell on
you ! ».
On peut sentir que je suis un peu contre, mais que puis-je, j’essaie,
c’est comme le son blanc, pour moi, toute une houle qui masque le
crépitement du monde réel. « Je monte le son … et je baisse le son
…, Je monte le son … je baisse le son … ». Qui a dit ça, dans une
chanson, maître de cérémonies, magicien léger qui subjugue la foule –
partie prenante enthousiaste, avec un petit bouton, un levier de
pouvoir ? La blague !
Le son tout court, sans nuance, dosé par décibel et par fréquence. Comme si cela pouvait masquer l’autre dimension du son, son sens.
Comme le statique sur la radio analogue. Je l’entends la nuit, c’est
l’autoroute qui vrille. Et subitement il y a un trou et j’entends de
nouveau les petits sons furtifs des animaux autours, nus. Je commence à
écouter de nouveau, alors que mon intelligence auditive s’était mise en
veille. Des trous de lucidité – on les appelle maintenant « le
silence » ! Toujours un mot insulte, pour l’intelligence,
maintenant. Béat, Béate, où es-tu, mon amour ? Reviens, reviens, de derrière ton face mask de mazout vert !
🖶
↑
↓
lundi 19 juin 2023
ZAD Par Tous !
Le paradoxe est ... que ce dont a le plus peur le gouvernement, c'est
qu'une infrastructure écologique de grande envergure commence à
exister. C'est pour cela qu'il fait tout pour envéniner la situation et
mettre tout le monde à dos. Pour ne pas parler de, et surtout ne pas
être obligé à agir sur le fond. Il a peur que c'est comme ça qu'on perd
des élections.
ZAD Par Tous - document de discussion
Pour répondre à la crise écologique, il faut faire vivre les solutions
réelles – c'est la meilleure manière de les proposer et de convaincre.
(Ré-écouter : Notre-Dame-des-Landes : la ZAD après la bataille).
Souvent, c’est l'activisme réactionnaire qui prime. C’est plus “simple”
et cela fait quand même des rassemblements de gens. On réagit contre un
tel projet pharaönique, tel exemplaire particulièrement marquant des
excès industriels, pour marquer des points médiatiques et augmenter la
pression sur le gouvernement.
Cela ne suffit pas et peut même servir de contre-exemple. Au bout d’un
moment, cela se dissipe, si ce n’est que parce que seulement une infime
proportion de ceux qui se massent pour telle manif. ou occupation
peuvent rester sur place. Et on a appris qu'il ne faut pas attendre de
nos gouvernants, ni de nos administrateurs, de prendre le premier pas.
C'est un changement systémique qu'il faut, et le système actuel n'est
pas fait pour cela.
C’est à nous de le faire, chacun à son échelle organisative – ou au moins chaque personne qui participe à ces actions “contre”.
On dira que les gens qui pensent de cette manière sont contre l'autorité
de l'état, même l’autorité tout court. Mais en démocratie, l'état n'est
censé agir que sous l'autorisation du peuple. Et le peuple souverain à
donc affaire au peuple souverain, d'abord.
Il faut convaincre le peuple (nous-mêmes) que le changement radical est
possible, pour que tout un monde meilleur se mette en oeuvre.
Il faut réinsuffler la confiance, là où la confiance manque - et dans le
bon sens. Le peuple uni. Pas les uns contre les autres. Si nous ne
pouvons pas prêter confiance aux solutions techniques, c'est qu'elles
existent déjà, pour les uns, mais pas pour les autres, et cela empire la
situation, avec des conflits sociaux, des conflits armés qui font
éruption partout. A en entendre parler, on croirait que le monde serait
meilleur si nous étions tous riches, alors que c'est l'abus qu’engendre
ce surplus de richesse qui nous a mis dans cette impasse.
Il faut proposer des solutions applicables à tous nos intérêts. C'est
même le plus dur, faire durer nos actions, les étendre géographiquement,
pour que l’impact écologique soit sur toute la surface de la France, et
pas juste dans quelques ilôts.
Aux Soulèvements de la Terre, on projète de faire des convois, avec des
tracteurs, qui, en suivant les confluents des bassins fluviaux,
atteignent Paris. On construit un maillage du territoire où, dans chaque lieu où il y a un comité, on recevra ceux du convoi, en bon ordre.
Pourquoi ne pas faire un pas de plus en avant ? Voyager sans fossile,
construire des circuits d'hospitalité permanents et de longue durée,
permettant à une autre infrastructure, sans voitures, mais avec
convivialité et jardins vivriers, d'émerger, à toutes les échelles
locales ? Comme ça, les convois serviront à créer de l'infrastructure
dans la durée, comme à la ZAD ?
Pourquoi ne pas faire nous-mêmes, pour du vrai, ce que nous reclamons au gouvernement ? Un convoi n'est qu'un début, c'est donc une opportunité. Pour que le peuple puisse vraiment ressentir de nouveau espoir et confiance, il faut lui créer une enveloppe, dès maintenant, un mode de vie vivable, sans hyperconsommation.
Y inclus dans les transports et les communications. On pourrait même
dire, surtout dans les transports et les communications. Les vrais
obstacles sont humains. Ils sont sociaux et économiques. Nos emplois du
temps sont tellement chargés que nous avons de plus en plus de mal à
nous réunir, librement.
Spécificités groupales
note explicatoire : l'analyse réproduite ici a été envoyé à la liste
locale de soulèvements de la terre, mais pas publiée sur la liste.
Si vous me permettez, le premier pas dans la mutualisation des luttes –
leur coordination informationnelle – passe par l’utilisation de cette
liste de mailing pour nous informer. Jusqu’à là, nous pouvons constater
que ce n’est pas vraiment le cas, plein de petits messages qui cherchent
de l’orientation. Très vite, on est dans le management de crise, un
événement “hyper-important” auquel “on” a donné la priorité surgit, un
autre, etc., on ne raisonne plus en termes de donner de la structure et
de la lisibilité à la convergence des luttes.
note: maintenant je comprends mieux sa non-publication - ce que je
prédis vient de se passer! Mot d'ordre: Tous à manifester devant la
Préfecture demain à 19h (j'écris ceci le mardi 20 juin 2023)
Si c’est le cas, c’est probablement lié à ce qu’il y a d’autres listes
de mailing et télégraphes arabes qui servent cette fonction, entre
activistes qui se sentent surchargés. En plus, étant eux-mêmes en
position de discuter longuement de stratégie, ils ne sentent pas le
besoin de présenter des raisonnements à un public plus large. Ou que la
semi-clandestinité figure haut dans la priorité des activistes. Mais la
clandestinité, c’est comme Protonmail, cela permet de cibler ceux qui se
veulent clandestins. Ce n’est pas une méthode “ZAD”, qui est plutôt de
perdre les clandestins dans la masse.
Pareil pour les réunions en présentiel. Pour les personnes clés, ils
peuvent juste consulter leurs emplois de temps et dire s’ils peuvent
être là, ou non. Très vite, ces réunions sont accordées selon la
disponibilité et la motivation personnelle des personnes déjà en
immersion dans la problématique de tous les jours. Et les autres … ?
Ces modèles sont connus. Ils n’ont pas réussi à mobiliser une grande
partie de la population, ce qui, étant donnée la sévérité de la crise
écologique, démontre plutôt leur inefficacité à générer des mouvements
forts et qui croissent. En plus, les gens de la ZAD ont massivement et
clairement exprimé leur volonté de voir la ZAD PARTOUT, c’était notre
slogan, après avoir gagné les batailles clés. Mais pour cela il faut une
véritable infrastructure et modèle socio-économique, des transports
doux, des lieux d’hébergement et de travail vivrier reliés …
Alors que, actuellement, l’adéquation s’adresse aux activistes et
organisations déjà actives – logiquement, tant que l’on est dans une
attitude défaitiste – mais il faut toujours planifier la potentielle
réussite, pour cela on est là, non ?
De nouveau, dans l’interview après le film “Du feu jaillit l’Eau” sur
les mégabassines, on a spécifiquement identifé la difficulté de gérer 10
ou 20 000 nouveaux participants avec une orga de 60 personnes. Il faut
des méthodes où la logistique croît, gracieusement, avec le nombre. On
peut observer qu’une population déjà active aura peu de temps disponible
pour des activités en plus. Alors que d’habitude, l’emploi de temps
collectif s’adapte aux exigences d’une population pour laquelle ce ne
sont que des activités sporadiques, à la péripherie de leur quotidien.
Ce n’est pas la recette pour augmenter l’envergure de ces mouvements.
Non, il faut une organigramme qui prévoit d’être pour et avec les actifs sur le terrain, à temps complet, qui en font leur vie.
J’ai proposé, dès la première réunion aux gradins de Montcalm, d’en
faire un rdv, un point de rassemblement hebdomadaire, qui permette à
plusieurs groupes de travail de travailler et communiquer en présentiel
et à plusieurs. Comme cela, on sait au moins que ceux qui ne sont pas
dispos ne sont pas dispos et que ceux qui sont là, le sont …
J’ai bien peur – à moins que les membres des groupes clés à Montpellier
donnent l’exemple de mettre la cause générale devant l’aggrandissement
de chaque groupe, et de son pouvoir relatif – que l’on sera dans un
scénario comme avant, avec très peu d’accessibilité réelle et beaucoup
de questionnements sur la forme politique que cela peut assumer.
note: multiples formes génériques de mouvement et d'infrastructure écologique doux sont discutés sur www.inecodyn.fr
🖶
↑
↓
vendredi 16 juin 2023
Programmation et références
mercredi 31 mai 2023 a eu lieu une conférence sur l'eau et un film sur les soulèvements de la terre contre les mégabassines
https://s-eau-s-herault.sciencesconf.org/
S-EAU-S : alerte sécheresse Hérault - L'eau en crises : état des lieux, enjeux, solutions
Canicule précoce en Espagne, niveaux des nappes phréatiques historiquement bas, 28 départements français, dont l'Hérault, en risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été, arrêté préfectoral de crise sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, affrontements à Sainte-Soline autour de « méga-bassines » ... l'actualité nous rappelle que le changement climatique n'est pas juste un concept, que la ressource en eau n'est pas infinie et qu'elle commence déjà à manquer. Pour éclairer ces sujets, le collectif UMenLutte, dans le cadre de ses « amphis alternatifs », vous propose une après-midi de sensibilisation sur le thème de l'eau, de sa gestion, de ses enjeux, avec un focus sur notre département.
et
https://www.cinemas-utopia.org/montpellier/index.php?id=4059&mode=film
De L’Eau Jaillit le Feu – film documentaire qui met les expériences, tant historiques que toutes récentes, du collectif les soulèvements de la terre, qui s’oppose
à la mégabassine de Sainte-Soline (dépt. des Deux Sèvres) pour attirer l’attention sur la perte de tout un écosystème dans le marais Poitevin à cause des déprédations en eau de l’agriculture industrielle. Viséoconférence après le film avec l’un des initiateurs du mouvement
- à midi, samedi 10 juin 2023 au gradins du Parc Montcalm, a eu lieu la première réunion de Soulèvements de la Terre Montpellier
Pour être sur le mailing list ➙
https://framalistes.org/sympa/subscribe/soulevements-montpellier
Prochainement pour les Soulèvements Montpellier, nous avons convenu d'une nouvelle grande réunion, le samedi 1er juillet 2023, toujours au parc Montcalm (gradins), durant laquelle seront partagées notamment : les premières réflexions des Groupes de Travail nouvellement constitués sur la gouvernance, les outils numérique, les actions, la communication, l'anti- répression, les ressources scientifiques…
- Le GT (groupe de travail) "scientifique" se retrouve le mercredi 21/06 à 19h au Gazette café
- Le GT "action" est le jeudi 22/06 à La Base à 19h (c'est une réunion SOS Oulala). Il y a déjà eu une première réunion GT Action le 12 juin 2023 - voir CR GT Actions 12 juin 23.docx
- Le GT "Gouvernance et fonctionnement" se retrouve le samedi 24/06 à 11h au Dôme !
- mercredi 14 juin 2023 à 18h30 à la Carmagnole, a eu lieu la réunion de la "coordination eau 34", appel inter-organisations pour s'organiser en particulier face au schéma irrigation porté par le département de l'Hérault. Un « Appel » cosigné par plusieurs associations et individus, est programmé pour bientôt.
Compte Rendu de la Réunion de la Coord'EAU 34 du mercredi 14 juin 2023 à La Carmagnole, avec le texte de l'Appel, en format imprimable pdf
le texte de l'Appel, imprimable, A5
- Le 21 Juin à 19h « Transportons-nous » à la Carmagnole. Question des mobilités en Hérault.
rencontres de luttes globales et locales, sur le Plateau de Larzac ( La Couvertoirade, 3-6 août 2023)
18 au 27 août : Convoi de l’eau de Sainte-Soline à Paris
de l’information en plus
Coordination Eau 34 - Sources et argumentaires (brouillon participatif, GT-science)
greniers des soulèvements
Avis sécheresse de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon
Schéma irrigation de l’Hérault 2018-2030 : analyse et argumentaire
Newsletter 1 Vive-Garrigue (mai 2023, Lunel et alentours) format pdf – imprimable
une copie est placée ici :
http://www.cv09.toile-libre.org/intxt/sdlt-digest/Bulletin%20Vive%20Garrigue%20N1%20Mai%202023.pdf
Contacts : Vive garrigues Lunel
- François : 06 80 12 41 26 ; mail : fcl52@me.com
Benedicte : benedite.alexandra@gmail.com
Programmation et références
mercredi 31 mai 2023 a eu lieu une conférence sur l'eau et un film sur les soulèvements de la terre contre les mégabassines
https://s-eau-s-herault.sciencesconf.org/
S-EAU-S : alerte sécheresse Hérault - L'eau en crises : état des lieux, enjeux, solutions
Canicule précoce en Espagne, niveaux des nappes phréatiques historiquement bas, 28 départements français, dont l'Hérault, en risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été, arrêté préfectoral de crise sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, affrontements à Sainte-Soline autour de « méga-bassines » ... l'actualité nous rappelle que le changement climatique n'est pas juste un concept, que la ressource en eau n'est pas infinie et qu'elle commence déjà à manquer. Pour éclairer ces sujets, le collectif UMenLutte, dans le cadre de ses « amphis alternatifs », vous propose une après-midi de sensibilisation sur le thème de l'eau, de sa gestion, de ses enjeux, avec un focus sur notre département.
et
https://www.cinemas-utopia.org/montpellier/index.php?id=4059&mode=film
De L’Eau Jaillit le Feu – film documentaire qui met les expériences, tant historiques que toutes récentes, du collectif les soulèvements de la terre, qui s’oppose à la mégabassine de Sainte-Soline (dépt. des Deux Sèvres) pour attirer l’attention sur la perte de tout un écosystème dans le marais Poitevin à cause des déprédations en eau de l’agriculture industrielle. Viséoconférence après le film avec l’un des initiateurs du mouvement
- à midi, samedi 10 juin 2023 au gradins du Parc Montcalm, a eu lieu la première réunion de Soulèvements de la Terre Montpellier
Pour être sur le mailing list ➙ https://framalistes.org/sympa/subscribe/soulevements-montpellier
Prochainement pour les Soulèvements Montpellier, nous avons convenu d'une nouvelle grande réunion, le samedi 1er juillet 2023, toujours au parc Montcalm (gradins), durant laquelle seront partagées notamment : les premières réflexions des Groupes de Travail nouvellement constitués sur la gouvernance, les outils numérique, les actions, la communication, l'anti- répression, les ressources scientifiques…
- Le GT (groupe de travail) "scientifique" se retrouve le mercredi 21/06 à 19h au Gazette café
- Le GT "action" est le jeudi 22/06 à La Base à 19h (c'est une réunion SOS Oulala). Il y a déjà eu une première réunion GT Action le 12 juin 2023 - voir CR GT Actions 12 juin 23.docx
- Le GT "Gouvernance et fonctionnement" se retrouve le samedi 24/06 à 11h au Dôme !
- mercredi 14 juin 2023 à 18h30 à la Carmagnole, a eu lieu la réunion de la "coordination eau 34", appel inter-organisations pour s'organiser en particulier face au schéma irrigation porté par le département de l'Hérault. Un « Appel » cosigné par plusieurs associations et individus, est programmé pour bientôt.
Compte Rendu de la Réunion de la Coord'EAU 34 du mercredi 14 juin 2023 à La Carmagnole, avec le texte de l'Appel, en format imprimable pdf
le texte de l'Appel, imprimable, A5
- Le 21 Juin à 19h « Transportons-nous » à la Carmagnole. Question des mobilités en Hérault.
rencontres de luttes globales et locales, sur le Plateau de Larzac ( La Couvertoirade, 3-6 août 2023)
18 au 27 août : Convoi de l’eau de Sainte-Soline à Paris
de l’information en plus
Coordination Eau 34 - Sources et argumentaires (brouillon participatif, GT-science)
greniers des soulèvements
Avis sécheresse de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon
Schéma irrigation de l’Hérault 2018-2030 : analyse et argumentaire
Newsletter 1 Vive-Garrigue (mai 2023, Lunel et alentours) format pdf – imprimable
une copie est placée ici :
http://www.cv09.toile-libre.org/intxt/sdlt-digest/Bulletin%20Vive%20Garrigue%20N1%20Mai%202023.pdf
Contacts : Vive garrigues Lunel
- François : 06 80 12 41 26 ; mail : fcl52@me.com
- Benedicte : benedite.alexandra@gmail.com
thèmes
vendredi 26 juillet 2024

vendredi 26 juillet 2024

samedi 13 juillet 2024

jeudi 22 février 2024
Utile
Est-ce que l’utilité est un concept utile ?
Est-ce que la valeur travail, productif de l’argent, est par définition utile ?
Ceux qui cherchent à ôter la notion d’utilité pratique des relations
sociales ne rendent peut-être pas service à notre terre nourricière.
D’ailleurs, la socialisation excessive et exclusivement
humano-mécano-centré de chaque position polémique masque notre réalité
symbiotique, dans le sens large.
Notre dépendance sur les machines motorisées occulte nos relations
d’interdépendance avec nous-mêmes et avec le reste du vivant. Ces
relations sont « intersubjectives », ne sont pas de nature de
l’application d’une force sur un objet.
Nous redécouvrons, au bout du rouleau, les vertus de cette
intersubjectivité, mais dans un carcan de pensée mécaniste devenu
camisole – témoigne notre mal à déterminer ce qui « ne va
pas » dans nos relations avec les machines. En réalité, ce qui ne
va pas, c’est l’établissement de la subjectivité et de là
l’intersubjectivité, avec les machines et, delà, entre nous.
On peut suivre le parcours de l’évolution de cette pensée, du
Skinnerisme / comportementalisme (agir sur et conditionner un
« objet pensant », années 1910-20) au nécessité de dominion
(les trois lois de la robotique d’Isaac Asimov, années 1960s) aux
« rule-based-systems » (l’idéologie des machines pensantes des
années 1980) suivis des « neural networks » rebrevetés
« algorithmes », 1990-2020. Il faut dire que depuis Turing
(années 1930-50) la compréhension métaphysique du sujet, au moins par la
généralité des gens, n’a guère évoluée, mettant en cause l’existence
même d’une « métaphysique », d’une « intelligence du
monde ».
Dans chaque domaine des sciences humaines, l’assimilation conceptuelle
de ces éléments de base est variable. Par exemple, dans le domaine de la
psychologie, la psychanalyse et de toutes les autres manières
d’individualiser les procédés sociopsychologiques humaines, on est
encore à l’époque de Skinner, des années 1920. On objectivise et ainsi
on atomise l’individu, le rendant proie prostrée devant la bande, on a
du mal à considérer des flux qui « conditionnent » la
condition individuelle comme faisant partie de cet être et par extension
tous les êtres individuels. Les services sociaux se nourrissent des
« victimes du système », sans système.
Dans d’autres sciences humaines, plus en contact avec la matière, telles
la génétique et l’évolution, de telles pensées non-individualistes mais
systémiques sont banales et même mathématiquement formalisées dans des
modèles, sans que l’on sorte du carcan mécaniste et actuariel. On arrive
aux années 1950, les années Turing. NVidia est Turing. Sans NVidia,
sans puissance de calcul, pas de soi-disante « intelligence
artificielle », pas de décodage du génome ou du protéome. Mais il
faudrait un soleil pour fournir l’énergie nécessaire à tous.
L’intelligence s’enfouit dans les fentes béantes de l’absence
d’information. Le modèle de surconsommation de l’énergie numérique est
aussi irrémédiablement inefficace et destructrice que le modèle de la
surconsommation croissantiste.
Irlande eire
Quels sont les parallèles entre le génocide irlandais de 1846-51 et celui, écologique, en cours aujourd’hui ?
La question est sociologiquement importante. Le nationalisme
égocentrique est, dans l’état actuel des choses, mortifère pour notre
monde à tous. Le rapport de raison, de raison mutuel intéressé, sans
nation, devient essentiel. Le rapport de force, la tension perpétuelle,
maintenue par le pouvoir colonial avec son comptoir, que ce soit
l’Irlande du Nord pour l’Angleterre ou l’Israël ou l’Irlande du Sud, des
comptoirs pour l’Amérique du nord, créent cet atavisme nationaliste,
comme l’ombre de leurs lumières.
L’une des réponses est que les deux cas de génocide sont perçus comme
lointains par les peuples de ceux qui les infligent. Ces deux génocides,
d’une cruauté expérientielle inouïe, sont administrés, de loin, par des
philanthropes et des « faiseurs de bien », sur des
« objets humains ».
Souvent, ce sont les « prédateurs » humains, avec les objets
les plus éloignés de la philanthropie imaginable, qui font le plus grand
bien, comme c’est le cas avec les prédateurs qui occupent le niveau
trophique le plus élevé dans d’autres schémas du vivant. Chemin faisant,
ces « rapports de force » et non de raison prennent
l’ascendant, continuent sur leur parcours ancestral, avec les outils de
bord, d’un pouvoir brutalisant sans borne.
Là ou le guépard ne devait qu’excéder par cinq kilomètres heure la
vitesse de sa proie, l’antilope ou la gazelle, l’état de l’art dans le
monde industriel est d’avoir un rapport de force tellement excessive que
toute résistance est inutile, une équation un peu rustique, et
inécessairement dépensière en énergie. Là où Cromwell se limitait à une
centaine de milliers de morts, dans le monde moderne, l’usage de la
bombe atomique à fusion reste prégnant, exige des sacrifices magnifiques
de chair humaine, pour préserver le système de terreur mutuellement
assuré.
Disons que, au niveau de l’élégance de la solution, un 4x4 manque de
finesse et de grâce, par rapport au guépard, ou au cheval. Péniblement,
en excédant de quelques dizaines de kilomètres par heure seulement le
guépard, (170 contre 110kmh), il a multiplié l’effort requis de 1 cheval
à 200-400 chevaux – toute guerre devient attritionnelle, de punition.
Ceci indique à la fois la difficulté non pas théorique mais pratique de
la tâche, et les raisons pour lesquelles « la nature » a pensé
bien de ne pas l’entreprendre. Le jeu ne valait pas la chandelle.
Manger quatre cents chevaux au lieu de moins d’un était une besogne peu
attractif, même pour le guépard le plus charnel.
Les plus grands criminels étatiques, dans cette triste affaire, sont par
excellence les américains, vecteurs de la culture industrielle
britannique. Ils basent leur pouvoir sur un rapport de force
disproportionnel, élu en vertu, le monde de l’hyper-consommation qui
nous tue tous.
Or, il est difficile de maintenir cette fiction. Une ébauche de
justification de génocide, entendue à la radio : « il se peut
que, les surfaces habitables de la terre se réduisant, il y aura une
évolution de la démographie, le monde ne pouvant plus soutenir une
population de 8 milliards, plus tard dans le siècle », notre
siècle, ou des mots à cet effet.
La résignation. C’est à peu près ce qui s’est passé avec l’Irlande. La
résignation des non-souffrants et des profiteus, malgré eux, comme le
Walrus and the Carpenter (le Morse et le Charpentier de Louis Carroll,
qui écrit cette poésie charmante pour enfants à l’époque des génocides
coloniaux anglais). Cette adaptation surprenante, flippante, à
l’horreur. Les plus grandes pertes de vie ont eu lieu suite à des
tentatives de rationaliser la production agricole irlandaise par
l’élimination de le classe de petits métayers, en défaut de paiement sur
leurs baux, à cause d’une succession de mauvaises récoltes. Comme le
dit la feu chanteuse Sinnead O’Connor, « the thing about the famine
is that there never really was one », (ce qu’il faut savoir sur la
famine est qu’en toute vérité, il n’y en a pas eu ». Non, c’était
un génocide, pur et simple. Les légumes et le blé continuaient de
s’exporter vers l’Angleterre. L’inhumanité se totalisait.
Le génocide présent mondial est une recette de solution démographique du
milieu du dix-neuvième siècle, à l’anglaise. Les anglais l’ont répété
avec les Boers et toute autre nation qui s’est montré récalcitrante, ont
systématisé l’usage des camps de concentration, des mitraillettes, de
l’attrition et la terreur, comme les dignes héritiers de Genghis Kahn.
Il est inévitable qu’en exploitant les pays pauvres pour fournir les
nôtres en surconsommation, nous créons les préconditions du génocide. Le
problème est un problème d’échelle – notre surpuissance fait que nous
nous tuons ainsi aussi, c’était l’impensée.
Sans montrer du doigt définitivement le dieu argent comme le coupable
final, il est cependant permis d’observer que ce sont les priorités
systémiques de stabilité du moyen d’échange (d’assurance de
l’inévitabilité de l’extraction du bien) qui prennent précédence sur la
décence humaine, que la qualité objective de la machine
« civilisationnelle » britannique prend tout, y inclus la vie
de ses serviteurs. Nous, de courte mémoire, attribuons ces qualités
plutôt aux grands états totalitaires comme l’Allemagne sous Hitler, la
Russie sous Staline ou la Chine sous Mao, alors que la recette de base
est et continue d’être anglaise, les responsables des bons sous-chefs
d’état comme Disraeli ou Lloyd George.
Les États Unis acceptent avec alacrité ce modèle, se trouvant dans un
« pays » où les possibilités d’expansion apparaissent sans
limites pour une population qui encore aujourd’hui est d’une densité par
km carré minuscule par rapport aux autres grands pays, sauf la Russie.
L’aspect insulaire des Îles Britanniques trouve sa continuité sur
l’échelle du continent semi-isolé nord-américain, dans la pensée de ses
gestionnaires. « Home is where the heart is » (Le cœur est
chez soi). Les étrangers sont des sous-humains, des retardataires,
dignes de commisération et de partage de munificence. On s’immisce à
contre-cœur dans les affaires du grand monde, comme si c’était une
responsabilité, un fardeau, nous, les grands condescendants.
Le paysage s’effondre devant nos yeux. Nous nous adaptons en devenant
effondristes, des spécialistes de l’adaptation au génocide collectif des
autres. Ceux qui proposent d’y remédier sont traités comme des fous et
des marginaux, il faut noyer l’espoir pour mieux vivre, la perspective
d’avenir devenant une valeur dépréciée.
Des habitudes, la distance fait l’affaire. On peut se distancier de
l’horreur en regardant son petit écran, dans sa cellule scellée contre
les intempéries du grand monde. La surenchère sur les horreurs de la
guerre perd son punch. Le gouvernement parallèle des irlandais fait du
renoncement au pouvoir colonial la clé du succès. Comment faire bloc,
dans un pays de collabos ? D’autant plus qu’on n’a plus le
temps ? La désolation d’un pays dépeuplé et le renouvellement de sa
diaspora ne réussissent pas à cacher les balafres qui strient le
paysage du génocide, immiscé dans la nostalgie d’un passé rêvé, non pas
achronique mais plurichronique, on vit avec ses fantômes. Les victimes
du génocide s’éteignent, sans histoire, nos ancêtres, notre histoire
blanche.
Ce que ne peut le pouvoir régnant, c’est accepter d’être redevable. Des
empires construits sur les os cassés de leurs victimes ne peuvent les
honorer. Les peuples écrasés font du passé leur avenir. Les vivants font
bloc, contre eux. Chaque pouvoir ex-colonial, l’Australie, le Canada,
les États Unis, fait son mea culpa en ne cherchant qu’à passer outre. Le
paysage encaisse, pour nous.
Mais un génocide est beaucoup plus présent, pressant et immédiat, ne
permet pas à ces devises de détournement de se monter, lentement, comme
le levain.
Le choc, interloqué, est absolu. Il est avec nous. De plus en plus.
Les guerres génocidaires ont toujours été des guerres écologiques,
d’attrition, de destruction du vivant. Ce sont des guerres d’une
sauvagerie elliptique, on tue le substrat de vie, on tue ainsi l’espoir
de l’ennemi. Nous avons toutes les clés de compréhension à portée de
main, mais nous avons aussi l’omerta collusioniste des survivants – nous
nous aimons dans le vide du sens, sans le courage d’en faire un sens –
il faut s’aimer sans cause, paraît-il.
C’est quoi, notre utilité ?
🖶
↑
↓
dimanche 12 novembre 2023
Gigantisme
C’est une question de rapport à l’autre. L’écologie. Avant, on parlait
de l’environnement, et puis on s’est mis à parler de l’écologie, parce
que parler de l’environnement menait à confusion. Le sujet a toujours
été : nous. Je parle de l’écologie sociale maintenant, pour qu’il
n’y ait pas question là-dessus, bien que je ne l’ai jamais pensé
autrement. Les questions subsistent. Il faut peut-être se demander
pourquoi ?
La raison est peut-être qu’il y a une vraie culture industrielle,
maintenant, une sorte de religion industrielle. On la voit de plus en
plus claire, elle paraît impossiblement ringarde, pour plusieurs d’entre
nous, elle est tellement à côté de la plaque. Ceux qui y croient encore
se retranchent derrière des idéologies négationnistes de plus en plus
absurdes.
Mais c’est parce que nous passons d’une culture à autre. Les historiens,
ils diront, peut-être, que la transition de l’époque industrielle, où
l’énergie, la puissance était reine, à l’époque de la culture
écologique, où l’ensemble du vivant devenait le centre de toutes nos
préoccupations, a déjà eu lieu.
Que la toute puissance et le rapport de force, c’est déjà du passé. Mais
non, pas encore. Et l’empire peut toujours renaître de ses cendres.
Et puis, il y a eu désaccord, parce qu’on en avait marre des gens qui
parlaient de la fin du monde, alors qu’on s’occupait de la fin du mois.
Tous ces mots. On les utilise plus pour délégitimer l’autre que pour
vouloir dire quelque chose. J’utilise les mots écologie sociale pour
être clair que l’on parle bien de notre avenir, forcément collectif. Je
suis content que l’on comprend de mieux en mieux que nous sommes des
êtres vivants, ensemble avec les autres. En voiture, entouré de sa bulle
informatique, il est difficile de le comprendre, sauf de manière très
abstraite. On écrase le vivant, sans même le savoir. Et puis on donne de
l’argent, « pour compenser ».
Je les ai appelé les époques de l’ingénierie mécanique, qui a commencé
dans les années 1800, et de la bio-ingénierie, commençant dans les
années 2000 – deux cents ans d’accommodation du monde industriel, avec
l’éruption des mouvements sociaux dans les usines, la création de
syndicats et de partis politiques travaillistes, Luddites, socialistes,
communistes. Pour terminer avec des ouvriers de l’automobile qui
protestent contre la perte de leurs boulots, industriels jusqu’au
dernier souffle.
Ce n’est que maintenant que l’on se retourne pour constater que le monde
que nous connaissions est devenu méconnaissable. On oublie souvent de
le dire. On parle du monde virtuel, du monde de demain (ou des
lendemains d’hier). On oublie de séparer ce discours, qui vaut ce qu’il
vaut, du discours du nous. Nous, le monde. Le monde virtuel ne remplace
pas le vrai monde, il en fait partie. Le monde minéral fait partie de
nous aussi. C’est l’échelle qui a changé. Mordor se répand partout.
C’est dans le Seigneur des Anneaux, qui a été écrit par quelqu’un qui a
servi dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale. Il sait ce que
c’est, Mordor. Il sait que Mordor, cela peut vouloir dire Mort d’Or.
Il y a donc eu enchevêtrement entre le discours de la puissance
industrielle et d’autres discours de la puissance de l’un ou de l’autre
des groupes sociaux. Nos petites sociétés humaines, à l’échelle
mondiale, se sont battues et se sont fait mal. Elles s’y appliquent
encore, malgré l’évidence devant nos yeux. Elles ont réussi à créer des
rapports de force chaque fois plus titanesques, jusqu’à reconnaître que
même la guerre se doit de décroître, pour des raisons purement
pragmatiques.
La guerre est devenue une sorte de rage mal contenue. Elle ne fait plus
aucun sens, sauf pour punir. Elle est devenue industrielle. Une histoire
d’attrition, de destruction mutuellement assurée. Les titans, ce sont
nos sociétés, transformées en énormes unités verticalisées, qui
s’autodétruisent mutuellement, comme avant, mais à l’échelle du monde.
Nous nous devons de trouver une autre manière de vivre.
Il y a eu confusion entre le métaphore « guerre » et
« guerre écologique », mais je pense à une manière de
contourner ce problème. Nous sommes dans l’après guerre, l’époque des
réparations. Nous vivons dans un monde très usé maintenant, par toutes
ces guerres et toutes ces préparations à la guerre, tous ces rapports de
force indignes, toujours indignes.
Il y a plusieurs zones qui ont été tellement maltraitées qu’elles sont
devenues des nomanslands, des déserts, sans vie, sans eau potable. A
peine qu’elles répondent aux injections de fertilisant minéral, de
phosphate et d’insecticide, tellement elles ont été maltraité. Mais pour
les rapports de force industriels, c’est essentiel. La politique de la
Terre brûlée.
Je pense à un truc, nous ne bougeons plus s’il n’y a pas un stimulus de
rapport de force, tellement c’est devenu banal. L’argent, ça sert à ça,
il fait que l’on soit « pris en considération ». Pour les gens
qui aspirent à la liberté, la définition de rapport de force, c’est que
c’est eux les plus forts. Ils sont devenus néolibéraux, addicts à
l’argent, le rapport de force social. Lorsque je les interpelle, ils
disent que je veux une dictature écologique. Non. C’est bien eux qui
font tout pour que l’écologie gouverne leurs vie, d’un poing de fer.
Non, le métaphore à utiliser maintenant, c’est l’après-guerre, faire
face à la désolation que nous avons créée, commencer à la soigner,
l’aider à regagner sa confiance, à se remettre en état de viabilité,
nous inclus. Si l’on veut, l’évolution, la sélection par la survie de
l’espèce, c’est la guerre la plus dure imaginable et elle est
instoppable. C’est cela, la vraie dictature écologique, l’écoréalisme.
L’ennemi, c’est nous.
C’est pour cela qu’il est important d’atteindre un peu d’objectivité
collective, face à ces défis, notre survie en dépend. Il faut bien aller
à la racine des choses, pour y voir clair. L’argent n’est pas à la
racine des choses, il est un moyen d’échange comme d’autres. Mais dans
une petite ville de campagne, celui qui rafle presque tout l’argent
disponible, après les achats contraints, c’est le café du coin. Juste le
fait d’être sociable s’achète.
Il y a une ville qui s’asphyxie. 25 fois trop de fumées nocives, 30
millions d’habitants, plus. C’est à cause de la pollution des voitures
et d’autres gaz industrielles, et du temps qu’il fait en novembre,
anormalement chaud. Chaque année maintenant, normal. Il y a soixante
ans, il y avait le smog, à Londres. On a mis en œuvre des mesures
draconiennes, dictatoriales, s’il vous voulez, pour que plus jamais cela
ne se passe comme ça. C’était devenu invivable. Dictature
écologique ? Londres ? C’est peu probable.
A New Delhi, en 2023, les enjeux sont les mêmes, c’est la ville malade
que je décris plus haut. L’Inde est aussi aux postes avancées dans la
révolution verte. On comprend pourquoi, cela devient une question de vie
ou de mort. A Pékin – Beijing, pareil, des énormes problèmes de smog.
Une tension absolue entre le besoin de produire, de produire des
produits industriels, et les besoins de la santé et de la survie
humaine.
Comment en est-on arrivé là ? En faisant de l’industrie mécanisée
une valeur culturelle. Et le symbole de cette culture, c’est la bagnole.
Elle est devenue plus qu’une symbole, elle est devenue
« nécessaire », dans l’esprit des gens. Les écolos les
premiers, ils n’osent plus s’y opposer, surtout à la campagne. Ils
parlent de covoiturage, de la pure hypocrisie. La voiture, le véhicule,
reste le symbole, une symbole d’une culture, l’industriel. Par rapport
au vivant, ce sont les routes, faites pour supporter les voitures, les
camions et tout le reste, qui s’adaptent aux exigences de la voiture.
C’est le comble d’être accusé de dictature par ceux qui exigent que la
voiture commande. L’article première de cette foi, c’est que les routes
sont nécessaires parce que les voitures sont nécessaires. Le
raisonnement est circulaire.
Heureusement, pour la culture industrielle, que les routes s’éparpillent
dans l’espace. La pollution aussi. Il suffit d’aller à la campagne pour
éviter de s’empoisonner. Mais la campagne, en Inde, est déjà bourrée de
gens, et beaucoup d’entre ces gens sont déjà dans la révolution de
l’agriculture verte, bien plus qu’ici en Europe, où on a quasi-éliminé
la paysannerie, préférant la mécanisation.
Je pense ici à un phénomène que j’ai souvent observé, perché à 2500
mètres sur la chaîne des Pyrénées, en Ariège (Port d’Urets). De ce
mirador exceptionnel, on voit facilement Toulouse, qui est à peu près à
cent kilomètres. Et on voit un dôme violacé dans l’atmosphère au-dessus –
c’est la bulle de chaleur-pollution que crée la métropole. C’est comme
dans un film de science fiction.
Et l’air à Toulouse est plutôt respirable, malgré la circulation – au
moins dans les quartiers les moins pauvres, stratégiquement placées au
dessus et loin des axes routières principales. Le Mirail, quartier et
université près des principales axes routières, est pauvre, est bien
pollué. Si l’université est particulièrement connue pour être de gauche,
il y a résonance, ses étudiants partagent le sort du quartier.
Bien sûr que jusqu’à là, je n’ai parlé que des échelles assez petites,
mais au niveau mondial, nous émettons suffisamment de gaz à effet de
serre pour hausser la température, pour faire que le climat, surchauffé,
se déchaîne, pour nous polluer tous. Les responsables ? Surtout,
ceux qui font des longues distances, à la campagne. Tout processus
industriel compris. C’est la puissance, l’énergie sur-utilisée, qui est
le problème. Cela coûte très cher, de gagner 20 minutes sur un tronçon
d’autoroute de cinquante kilomètres.
Nous ne pouvons plus nier, à la campagne, que nos habitudes énergivores
font une partie majeure du problème social, surtout si nous n’acceptons
plus de densifier la population rurale, ou pas de manière significatif.
Négligé, délaissé par l’humain, « pris en charge » par les
machines. Tout le monde devrait être en train de se poser cette
question : « comment ré-intégrer de manière positive la
culture de l’humain à celle de la biodiversité ? » La voiture
ne fait pas partie des solutions réalistes, vue sous cette angle. La
FNSEA se plaint du mauvais entretien des cours d’eau, par rapport aux
inondations du Pas de Calais en cours. Quelle est la part joué par la
compaction du sol, la disparition de la terre éponge, la construction
dans les lits majeurs des rivières ?
Beaucoup de gens choisissent de vivre loin de la ville et de faire la
navette au boulot, ou quand il est nécessaire. Sinon, ils s’attendent à
ce que d’autres moyens de transport fassent le boulot de déposer aux
supermarchés plus locaux, ou à leurs portes, les denrées qui leur
manquent.
Peu importe, le mal écologique est fait. C’est justement ces gens qui
vivent à la fois à la campagne, et à la fois en ville, ou tout comme si,
… qui ont les taux de production de carbone les plus néfastes.
Les gens qui produisent le moins de CO2, ils vivent et ils travaillent
dans et autour des grands centres urbains, les endroits les plus
pollués. Ils sont très écologiquement conscients. A l’échelle globale,
ce sont les gens qui vivent dans les pays pauvres qui souffrent –
sécheresse, canicule. Ils vivent. En France, on maintient la fiction que
la vie de pauvre est indésirable.
Il faut savoir ce qu’on veut, vivre ou mourir, collectivement. Cela a
été un choc de constater que le climat change le plus rapidement en
Europe, la température moyenne monte en flèche. Peut-être on fera le
lien entre ces steppes d’agriculture industrielle, le manque de
résilience de nos paysages et notre propre souffrance, comme les
citadins ont déjà du faire, face aux dépradations.
Notre culture collective évoluera, cela veut dire qu’elle s’adaptera aux
circonstances, bon gré, mal gré. C’est en train de se faire.
Si je suis activiste écologique à la campagne d’un pays riche, c’est
bien que, dans ma vision des choses, c’est ici que cela se passe, malgré
les apparences. La culture industrielle « la campagne ». La
marque « campagne », l’« industrie du tourisme ». La
culture de la campagne est de dépendre de l’industriel. Dans un pays
riche, cela veut dire dépendre du tourisme des riches – en voiture de
nouveau, d’importer la richesse que l’on ne produit plus. Le bio, c’est
pour l’affichage, il est peu subventionné par rapport à l’industriel, il
est, dans sa vaste majorité, industriel.
A la campagne d’un pays riche de l’Europe de l’Ouest, on exploite
l’hyper-consommation des riches, venus en voiture. C’est la principale
source de revenu, pour la plupart des gens qui bossent à la campagne. Et
il y en a de moins en moins – la « population sur place » est
numériquement « touriste » - il ne vit pas d’un travail sur
place, il vit et il travaille ailleurs. Entre campagnes, les gens
utilisent des voitures pour faire des kilomètres de dénivelé, pour aller
travailler, la population de nuit est dénué d’actifs.
Actuellement cela réduit la campagne à une sorte de « fonction
paysage ». La campagne est paysagère, adaptée à être vue et
utilisée par des gens qui « se bougent » en voiture, des
« touristes », d’abord et avant tout. Des gens qui se pensent
des plus « orientés nature », qui empruntent des GRs avec leur
GPS, arrivent et partent en voiture. Ils vont marcher, à la campagne,
en voiture.
On se demande quand naîtra un tourisme vraiment utile à la campagne, qui
n’est autre que la nature, ou le vivant, appelez-le comme vous voulez, à
perte de vu. Mais actuellement, les marchés locaux sont là pour vendre
des objets de consommation destinés aux touristes et aux habitués à la
poche profonde. L’argent, il vient d’ailleurs.
La campagne devient une zone accommodée aux désirs des plus performants,
au niveau de la poche, au niveau de la consommation, qui distribue,
presque partout, le pire de la logique anti-écologique de l’époque
industrielle que nous essayons de dépasser. On a mis les riches, par la
définition d’aujourd’hui, comme des cochons, en plein milieu du jardin.
Ils sont en train de tout bouffer.
Les producteurs de nature à manger, les agriculteurs, sont
subventionnés, les riches qui viennent aussi. Puisqu’il n’y a qu’eux qui
sont utiles. Un vrai paradoxe, le seuil d’entrée à la vie rurale est
relativement haute, elle vaut une voiture ( les Celtes calculaient leur
richesse en têtes de vache, mais ici, maintenant, c’est l’achat
d’énergie – pétrole, qui compte). On a la voiture « cheval de
courses », bien sûr, mais aussi le mobilhome, la voiture
électrique. D’habitude, ce sont des bagnoles de fonction, comme les
chevaux et les ânes l’étaient avant.
Presque tous les intrants pour ce modèle sont très énergétiques. C’est
le même calcul que celui que l’on fait pour l’empreinte carbone d’un
musée, comme Le Louvre. Plus il y a de visiteurs qui viennent de loin,
plus l’empreinte du seul transport et hébergement des visiteurs est
grande. Cela représente 60 pour cent et plus du bilan carbone du musée.
Ce n’est même pas dans les mains des curateurs de musée. Tout ce qu’ils
font dans leur quotidien de bien, niveau frugalité, ne fera pas
l’affaire. On ne fait pas venir un visiteur chinois à pied. En fait, on a
abandonné toute réflexion sur l’utilité d’un voyage, pour
l’environnement, l’environnement humain et du vivant. Certains musées
ont compris, ils visent une population « locale ». Peut-être
on pourrait avancer d’un cran, faire venir les touristes
« locaux » à pied ou à vélo ?
Si les touristes actuellement véhiculées viennent de plus loin, ou
voyagent plus fréquemment, comme presque tous ceux qui trouvent un
boulot à la campagne, la campagne fonctionne exactement comme un musée.
Avec tous les efforts du monde, le gros de son bilan négatif écologique,
c’est les frais de transport, en carbone émis, routes comprises.
Pareil pour les paysans, les maraîchers et les agriculteurs. Le gros de
leur consommation d’énergie, c’est de l’énergie qui est transporté de
très très loin. Leurs pratiques, leurs champs grands et simplifiés, leur
fil électrique, ce sont aussi des « routes », pour que le
tracteur roule. Tout est calculé pour simplifier la « vie » de
la machine. Les panneaux solaires, qui ont le mérite d’être statiques
une fois arrivées, viennent de Chine. Les minerais qui sont employés
dans leur confection viennent de partout dans le monde.
Je trouve que l’on n’est pas en position de nier ces vérités. On cumule
l’évidence que cela doit être vrai. Insecticides, oui. FNSEA, oui.
Chasseurs, oui. Agriculture industrielle non-bio, oui. Dépendance
massive sur le transport véhiculaire mécanisé, oui. Nous savons aussi
que statistiquement, la population présente à la campagne est de plus en
plus riche, ces dernières années. C’est-à-dire, elle est riche en
hydrocarbures, essentiellement. Le temps est bien venu de parler de la
place de la voiture, à la campagne.
L’industriel est associé avec la puissance et la richesse, le rapport de
force. Mais objectivement, l’industriel ne fait pas le poids, face à
l’évolution. L’évolution se moque de qui est le plus fort,
concurrentiellement, entre mammouths industriels, elle ne cherche que le
plus apte. Nos petites querelles de ce que cela veut dire
« croissance » ou « décroissance », elle s’en moque.
Beaucoup plus important, pour l’évolution, ce sont des questions comme
« est-ce que cela peut se reproduire ? » Ou « est-ce
que cela peut s’auto-organiser ? »
Pour l’industriel, la réponse est, manifestement, non. La plupart des
organismes industriels sont tellement inadaptés à la survie autonome
qu’ils cessent de fonctionner dans des délais très réduits, sans un
apport constant d’énergie de l’extérieur et des décisionnaires humains.
Le transport d’énergie à longue distance devient le pilier central de la
culture industrielle. Le poids d’une batterie à lithium, fois des
millions, par exemple.
N’est-ce pas que lorsque nous parlons de colonialisme et de
néocolonialisme, nous parlons de cela, l’apport, d’ailleurs, des forces
nécessaires ? Comparons-le avec le monde biologique, la logique
biotique. Les végétaux convertissent l’énergie solaire qu’ils reçoivent
sur place en matière. Les vents, l’atmosphère, font le transport de la
matière que les êtres vivants convertissent en énergie.
Et tout cela, sans aucun apport industriel. Les transferts d’énergie
sont massifs. Notre culture industrielle dépend du dépens du cumul,
pendant des milliers de millions d’années, de l’accumulation de cette
énergie, à origine solaire. Nous parvenons à épuiser ces gisements, et
malgré nos gains en efficacité énergétique, de dépenser de plus en plus
d’effort à récupérer de moins en moins de matière première.
Les énergies renouvelables deviennent nécessaires, pas optatives. Mais
l’énergie renouvelable le plus idéal, c’est, par exemple, le vent. Pas
l’éolienne, ni l’électricité qu’il produit, mais juste le vent. Et
pourquoi choisir un panneau photovoltaïque, si le gros de l’usage
énergétique est pour chauffer, ou refroidir ? La méthode
industrielle, de détruire la nature, d’accommoder la production végétale
à une mission de « rentabilité immédiate », alors que le
végétal est le plus grand capteur et convertisseur d’énergie solaire qui
soit, de « réduire » la mission à la production
d’électricité, qui ensuite alimentera la machine, c’est d’ignorer les
« machines » naturelles déjà opérantes.
La culture industrielle est une culture très primitive, à vrai dire,
elle ne renouvelle rien. C’est ce que l’on veut dire quand on parle
d’autonomie. Renouvellement. Reproduction. Auto-organisation.
Tout être vivant sait le faire, pas tout seul, c’est la règle. On peut
imaginer que notre bio-ingénierie terminera par produire des organismes
qui savent se reproduire et s’auto-organiser, c’est la prochaine étape
logique dans l’affaire, ça commence déjà avec les drones. Mais c’est une
course contre le montre, notre survie peut en dépendre. Pouvons-nous
créer des machines vivantes, qui s’auto-organisent ?
Elles sont déjà là. Il faut plutôt apprendre à mieux s’intégrer à ces
mécanismes dits « naturels », mieux les cultiver. On en parle,
avec les inondations dans le Pas de Calais, on en fait déjà beaucoup,
de réouverture de marais, de zones inondables qui servent d’éponges. La
culture industrielle est aux antipodes de cette réalité, c’est même elle
qui crée le ruissellement. La science, non. La science comprend que
l’auto-organisation existe déjà, si on la permet d’exister, de
« fructifier », c’est cela le sens du mot
« écologie ».
Notre puissance brute, l’énergie que nous produisons par l’industrie,
elle est infiniment moins intelligente, comme processus, que ce qui
existe déjà, dans le biosphère. Notre monde purifie l’eau et l’air, pour
nous. Elle recycle nos déchets, organiques. Chaque substance produite,
reproduite, trouve son usage. Le déchet de l’un est l’intrant de
l’autre. Chacun est le mieux placé pour décider de l’intrant/déchet
qu’il produit.
Le comble, c’est que cela a l’apparence d’une vaste concaténation
d’erreurs. Je ne décris pas ici une horloge parfaite, comme l’univers de
Newton, sinon un système qui s’auto-entretient par des erreurs
constantes. Ce n’est pas le plus puissant, le plus énergivore, qui
gagne, loin de là. Moins il consomme, plus l’organisme a des chances de
survivre, lorsque les ressources manquent. Ce sont les « goulots
écologiques ».
On ne parle donc pas de décroissance – puisque les organismes qui
survivent peuvent croître, parfois exponentiellement. Et ces organismes
sont à toutes les échelles, du virus à la baleine bleue. L’échelle
uniquement industrielle représente un non-sens, un cul-de-sac
évolutionnaire. Nous ligoter au béton de l’industriel, c’est nous
couler, du point de vu évolutionnaire.
On peut faire un parallèle avec les dinosaures. On sait aujourd’hui que
les oiseaux sont des dinosaures. On sait aussi que, dans leur vaste
majorité, les oiseaux contemporains sont bien plus petits que leurs
ancêtres. On pourrait même dire que le principe industriel de l’économie
de taille, version biotique, a déjà été tenté, et ceci à maintes
reprises. Il y a le potentiel d’un industriel biologique, cela a déjà
existé, il s’est presque éteint, là où il ne s’est pas rapetissé.
L’environnement, c’est l’environnement social, c’est ceux qui sont
autour de nous, n’est-ce pas ? Moi, j’ai passé tellement de temps
avec d’autres bestioles que je vous jure qu’ils se font des blagues. On a
sévèrement sous-estimé l’intelligence des autres êtres vivants, comme
par principe, il y a eu beaucoup trop d’objectivisation. Le vivant, il
est subjectif et souvent proactif. On a sévèrement sur-estimé
l’intelligence relative humaine – de certains d’entre nous. Mais il y a
partage de l’intelligence entre tous les êtres vivants, bien plus qu’on a
voulu le croire, en prenant ce cul de sac intellectuel. On continue
d’avancer, c’est une science toute neuve, celle de l’intelligence
biologique.
Ici, je suis dans une partie du monde qui s’appelle les Cévennes, ou
tout le monde ou presque a une voiture. C’est ici, à coup sûr, qu’on est
en train de tuer le monde. Et tout le monde ici avance des raisons
qu’il pense bonnes pour continuer dans son usage de la voiture,
évidemment. On aime la liberté, la liberté de choix ici. On ne voit pas,
ou l’on ne veut pas voir, jusqu’à quel point nos choix, ici, condamnent
d’autres, ailleurs, qui n’ont pas le choix. Nos choix s’imposent sur
d’autres. C’est déjà la dictature, pour eux.
Pour nous, c’est de plus en plus difficile de maintenir le niveau de
confort et d’aisance de vie auxquelles nous aspirons. La voiture nous
assure ces possibilités, mais elle coûte « trop cher ». La
liberté, elle s’achète, mais elle est hors de prix, pour la plupart
d’entre nous.
Je suggère une autre voie envers la liberté. Nous libérer de notre
dépendance sur la voiture. Nous remettre en synthèse avec la nature,
notre nature, plus directement, de biote en biote. C’est logique. La
technologie moderne est en train de nous tuer. Il ne faut pas en être
dépendant, en faire le transmetteur-récepteur exclusif. Le moins que
l’on puisse faire, c’est de nous libérer de cette dépendance et voir si
c’est vraiment si nécessaire, si c’est vraiment le moins pire. Il y a
plus moins pire que cela, je vis sans voiture, à vélo, à la marche. Cela
me plaît plus, je n’aime pas ce que les voitures et les portables font
de nous.
Notre dépendance est systémique, certains avancent l’idée que cela veut
dire « à toutes les échelles à la fois », mais je préfère dire
que c’est d’abord une question d’infrastructure, de ce qui est entre
nous. C’est pour cela que la voiture est absolument centrale au débat.
C’est pour cela qu’il nous faut tenter d’inventer un autre système qui
marche.
Les Cévennes, c’est un très bon endroit pour faire cela, tout le monde
croit dur comme fer que c’est impossible. Si on le faisait ici, personne
ne pourrait s’obstiner à prétendre que c’est impossible. Le bruit
court, les Cévennes, c’est très bien connecté.
Je pense, en toute justice, qu’avant de prononcer le mot
« impossible », on devrait essayer. S’il existe une
infrastructure sans bagnole, si on voit comment ça marche, on sera mieux
placé pour juger, non ? La société des voitures nous a déjà
désenclavé, les gens se mélangent à distance maintenant. Des circuits
réguliers sans voiture peuvent recentrer ces groupes sociaux, distance,
avec le « slow transit ».
Je me sens un peu con de me trouver là, à parler d’un sujet tabou à
plein jour, même à la nuit des temps. Nous sommes dans l’entre nous – on
est combien … ? Les touristes sont partis, c’est peut-être
cela, la motivation, on a encore le temps de faire quelque chose, ou
pas, cet hiver.
Le temps, on a le temps, bon, manière de parler. La Banquise, elle fond,
visiblement. Et ici ? Il fait un peu plus chaud. En fait, ce qu’il
faut craindre ici, c’est l’arrivée de réfugiés climatiques d’ailleurs,
je veux vous effrayer ! Ne faudrait-il pas y penser, avant qu’ils
n’arrivent ici ? Les circuits réguliers, à pied, à vélo, que je
propose, c’est une vraie solution à cette problématique.
Historiquement, les Cévennes, comme d’autres renforts montagnards, ont
eu des hauts et des bas démographiques. Actuellement, on est autour du
plus bas depuis 800 ans, peut-être. Il y a des ruines, des habitats
désoccupés partout, suite à une hémorragie démographique datant de la
première époque industrielle – un genre d’écroulement écologique partant
du milieu du 19ième siècle, reprenant après les Grandes Guerres. Le
repeuplement de la campagne n’a guère commencé. C’est une époque
pionnière.
Pour le moment, on s’y est habitué, à ce désert rural. On a pris goût à
un paysage vide, où tous les trajets se font en voiture. Vous avez vu le
nombre de voitures électriques, les quatre quatre, les camions et
camping cars de luxe, les motos, les buggies ? C’est un vrai
paradis pour la société mécanisée libre, la campagne, bien plus que la
ville. Vous ne l’avez pas noté ?
A quoi sert une grosse voiture, si elle ne peut jamais montrer ses
capacités ? J’ai l’impression que les touristes pensent que la
campagne, c’est leur endroit de liberté. Leurs voitures, leurs motos,
leurs chiens, ils veulent les laisser courir libres.
C’est un vrai point aveugle. Ils veulent être libres, sans dictature,
mais je ne sais pas ce qu’en pensent les bêtes qui rencontrent ces
chiens ? Ils veulent rouler à 90kmh, mais je ne sais pas ce qu’en
pensent tous les autres usagers de la route ? Sans parler des
agriculteurs, qui veulent également imposer leur sceau sur la
biodiversité.
C’est quoi cette liberté de détruire et remplacer le monde du vivant ?
Cette « mobilité » va bien avec la liberté d’association, si
on ne parle que de ceux qui sont dans les parages. On peut s’associer,
librement, avec des gens de Mende à Saint Jean du Gard, d’Anduze au
Vigan, de Millau à Alès, si l’on a la bagnole et l’essence. Toute
l’apparence de l’association libre, ce qui va bien avec la culture
rebelle cévenole. Et puis, comme avec les touristes, ceux qui ont des
véhicules, ils ont des véhicules, ils ne laissent pas d’empreinte au
sol, ils n’envahissent pas, ou peu, n’est-ce pas … ? Ils viennent
avec de l’argent à la poche, ils contribuent. Ils achètent les maisons
qu’ils occupent de temps en temps, avec leurs invités, au passage. Ils
sont très bien connectés.
C’est quand que l’on va déclarer la fin de la récré ?
Si l’on adaptait les méthodes que je préconise, jamais. C’est le
paradoxe. Je propose des méthodes d’adapter nos libertés à la réalité
des autres. Pour nous laisser libres, à l’égalité de nos pairs.
Et ce n’est pas du tout ce que les gens croient – ils croient que les
écolos comme moi, nous proposons de les priver de leurs libertés
(voitures, portables). Ce n’est pas moi, ce n’est pas des gens comme moi
qui sommes en train de les priver de leurs libertés. C’est eux-mêmes,
c’est là où le bat blesse. Tout « bon » manager en Lozère,
bouge en voiture, autour de son département.
On est en train de consommer le monde. Bientôt, dans les Cévennes, on
aura des réfugiés de L’Hérault – pas des touristes, des réfugiés, sans
argent. Qu’est-ce que l’on va en faire – est-ce qu’on a la moindre idée
de ce que l’on va en faire ? On est tellement dans le monde des
machines que l’on ne sait plus employer les gens. On est configuré pour
n’accepter que les gens qui achètent et consomment, pour justifier leur
existence.
Je propose déjà de mettre à disposition des jardins vivriers à cultiver
et des gîtes de passage pour ceux qui peuvent offrir leur valeur de
travail humain, qui serait plutôt prisée.
D’office. En fait, la fameuse générosité, l’esprit tellement accueillant
des Cévenols, c’est typique de la campagne française. Vous aurez raison
si vous avez noté le deuxième degré. Je parle d’aujourd’hui, en fait.
Hier c’était mieux, on avait besoin de main d’œuvre. Et c’est pour cela
qu’il nous faut ressusciter les éléments de base de cet accueil, non pas
pour renforcer les liens d’affect entre de petits groupes de gens qui
sympathisent, sinon pour accommoder, en termes d’égalité, tout venant.
J’insiste là-dessus. La meilleure manière d’induire le conflit, c’est le
mépris. Le moins qu’on puisse faire, pour les gens qui viennent ici
sans argent, à pied, à vélo, en mouvement, c’est leur fournir les moyens
d’être là et de contribuer.
Ce n’est pas en acceptant, de manière presque symbolique, quelques
réfugiés de pays en guerre, que l’on fera face aux réfugiés climatiques.
C’est en multipliant, par deux, par trois, par quatre, la population
rurale ouvrière, écologiquement productive. Sans voiture, donc.
La voiture est elle-même devenue une impossibilité en campagne. On peut
supporter une grande population à la campagne, seulement si elle est
utile sur place et elle n’a pas de voiture, électrique, diesel, ou
autre. Il est vrai que les paysans du tiers monde, tout comme les gilets
jaunes chez nous, nous donnent un signal clair, ils ne veulent pas ça,
ils veulent le beurre et l’argent du beurre.
Il faut contester cette vision. Un paysan au tiers monde n’a pas besoin
de tout cet argent s’il n’a pas à payer le prix pour nos biens
technologiques, nos salaires super-gonflés, nous, faisant partie aussi
d’une élite rurale qui insiste sur son droit d’utiliser des véhicules
motorisés. L’élite rurale, elle n’est plus rurale, elle est partout,
grâce à la voiture, l’avion, le train, … elle est à la fois touriste,
habitant de résidence secondaire, artisan, citadin, grâce à ces modes de
transport.
Ce n’est pas devenir décroissant de proposer un mode de vie qui nous
permet de vivre encore. Si l’on regarde les progrès que nous avons déjà
fait, technologiquement, on voit que l’efficacité de nos machines a
augmenté, de manière astronomique. On voit bien l’axe de mouvement, de
machines statiques, lourdes, hyper-polluantes, à vapeur, à charbon, à
des machines mobiles, chaque fois plus légères et économes en carburant.
La prochaine étape est le vivant, le vivant super-économe, qui n’avait
pas de prix dans les lois du marché humain , qui commence à être
critique pour notre survie. On commence à payer le prix, en négativités.
Ignorer le sort de ceux qui n’ont pas le privilège de vivre dans des
endroits paradisiaques, à la ruralité française, c’est une folie, cela
ne peut que nous revenir dans la gueule. Si nous ne savons pas ouvrir
nos portes et nos cœurs, la nature les éclatera.
Le vivant n’est pas d’une élasticité à l’infini. Au delà d’un certain
seuil, il s’éteint. Même les lois du marché ne sont plus nos amis. Avec
l’épuisement des ressources, l’une après l’autre, les valeurs relatives
changent. L’eau devient payante. On observe déjà que la valeur des
humains diminue – sans voiture, sans machines, ils valent de moins en
moins. C’est l’une des choses qui s’approche du point de rupture, on le
sait – on ne peut pas donner une voiture à tout le monde, ou une
tronçonneuse, ou une débroussailleuse, ou un tracteur – ou toutes à la
fois.
Il faut percer la bulle dans laquelle nous vivons, ici. Nous le devons à tous les autres.
🖶
↑
↓
dimanche 29 octobre 2023 rev. mardi 14 novembre 2023
« La Banquise fond et ici on joue aux p’tites voitures »
De retord
Pendant le retour j’étais saisi d’une sorte d’irritation prononcée que
j’avais du mal à m’expliquer, au premier abord. Pourquoi les en
voulais-je autant, à ces gens de la ruralité française ? Qu’est-ce
qu’ils m’avaient fait ?
Mais en réfléchissant, j’ai compris que mes sentiments étaient plutôt
bien fondés, ou au moins fondés dans un certain vécu. Je viens de la
campagne.
Comme beaucoup de ces choses – les sentiments – on dit que chacun
d’entre nous s’est vu mouler par ses expériences (c’est une variante de
« on ne peut échapper à son destin »). Si j’ai un destin,
c’est d’être l’un des premiers fils de néoruraux de l’époque présente,
jamais à sa place, placé partout, comme un fils de la DAS dans la
Creuse, version diaspora celte. Premier paradoxe, donc, dans ce chemin
de vie semé d’embûches, d’être des premières nations, honni par les
colons qui se croient « chez eux », là où je suis, moi aussi.
Sur la montée, sept cents mètres de dénivelé à 5 % moyenne, mon
état furibond m’a permis le plaisir Nietzschéen de pédaler sans arrêt,
ou presque. J’ai fait le gros du trajet entre 13h et 15h30. Avec une
pause à la Magnanerie, édifice Parc Nationalisée d’une mornitude
cadenassée sans fin, dans un paysage sonore moutonnesque. Un seul mûrier
chétif patrimonial devant elle, entourée de chênes verts, avec
plusieurs magnifiques châtaigners du passé semant les cinq cents mètres
de chemin, à 700 mètres d’altitude, de leurs bogues. Ce qui est bizarre,
c’est qu’elles restent là, éparpillées. Apparemment, même la faune
locale n’en voulait pas, peut-être parce qu’ils ont été tout simplement
éthiquement nettoyés par les chasseurs du coin ?
La descente fut encore plus rapide, aidé dans mon élan par la pluie
latente et les nuages bourgeonnantes. Ma roue voilée s’est
mystérieusement dévoilée, au moins en partie, et les conditions ont été
optimales pour prendre de la vitesse sans crainte.
Arrival avant cinq heures à Florac, pour témoigner des dernières spasmes
de ce que j’ai fui, la Fête de la Soupe, une sorte de Harvest Festival à
la dérive, où une fête ancestrale conçue pour célébrer la bonnté de
dieu nature s’est transmutée en gros festin de sur-consommation, avec
beaucoup de bière, dans un effort manifeste de renflouer les caisses en
plumant les touristes avant de fermer pour l’hiver. On est en période
hivernale maintenant. L’hôtel du coin a fermé « jusqu’à
Pâcques ».
Un parc automobile de vingt millions d’euros qui se déplace pour se
bourrer la gueule, sans autre finalité que de fraterniser et de
consommer jusqu’à l’hébétude. C’est la musique amplifiée qui est le plus
insupportable dans cet enfer. J’ai appris une astuce ce midi, à
Sainte-Croix, je prétends à l’acouphène, j’ai ainsi dissuadé à un
soixante-huitard pas encore crevé d’installer son sono à 50 centimètres
de mes oreilles.
Si ce n’est le petit attroupement de camions de vie auprès du parc, avec
leurs babas propriétaires+chiens, se faisant passer pour une tribu
néandertalienne, alors qu’ils sont de l’évidence même fumés de fric.
La colère est non-feinte. Elle est saine. Un commentateur à la radio,
qui a écrit un livre tout dernièrement, a eu du mal à préciser les
grandes lignes de ce monde post-moderne, en attente de l’apocalypse.
Serait-il bipolaire – l’Occident contre la Chine ? Ou totalitaire
contre démocrate, autoritaire contre humaniste, pauvre contre
riche ? « Un peu tout ça à la fois », c’est tout ce qu’il
pouvait sortir, laissant entendre que son livre n’en faisait pas mieux,
une balade autour du sujet, une œuvre éphémère.
Bref, ce sont sûrement les riches qui sont en train de tuer le monde,
peu importe la variante. A la campagne, on a l’impression d’être dans
une terre où le fric, il commande du respect.
Ma fureur chaque fois plus malcontenue à la vue de ces habitants ruraux
avec lesquels je n’ai rien en commun, mais rien, et tout à la fois, est
basée sur le même ordre de constat. La maladie est fractale dans le
temps, et dans l’espace, et elle commence « chez nous », cette
maladie du monde.
Elle est tout et son contraire, à la fois. Une campagne préservée pour
l’usage exclusif des riches, les colons, qui se croient, ou qui font
semblant de se croire chez eux. Qui font des liens chaque fois plus
alambiqués entre leur droit d’être là et leur bienséance. Ne
comprennent-ils pas que leur monde est terminé, que le sursis est déjà
suranné ?
Methinks thee protest too much (Shakespeare)
J’ai compris, sur la montée, que si les petites villes de la campagne
par lesquelles je suis passé ces dernières années ont une vie
associative éblouissante, avec un affichage sans honte du
« care » et de la « solidarité » qu’ils portent dans
leurs cœurs avec les réfugiés et chaque groupe affligé du monde, c’est
une manière de racheter l’indulgence, non pas de Dieu, mais de ceux dont
ils ont peur (bien que à l’origine c’était « la peur de
dieu », Catho, protestante ou autre), jusqu’à ce que ce système de
valeurs soit également portée par des « Communistes » [ou
athées].
Les « humanistes de gauche » ont chaud en ce moment. Ils vivent leurs contradictions.
Il faut agir en accord avec ses croyances, plutôt que de conniver dans
le mal. Il y a des gens qui se disent anti capitalistes, mais il faut
vivre et proposer d’autres systèmes, moins gouvernés par le capital, il
ne suffit pas d’être anti-capital dans la parole, pro dans les actes
quotidiens.
Il ne suffit pas de se prétendre humaniste de gauche si tout cela masque
une réalité, que ta vie d’opulence est bâtie sur la misère,
l’oppression et l’exclusion – le mépris – de la multitude. Et qui peut
mieux remplir cette case qu’un travailleur humanitaire envoyé sur place
dans un pays pauvre avec un salaire de 30 000, 40 000, 60 000
euros ? Ou un cadre du Parc National des Cévennes qui fait la soupe
pour « aider les réfugiés » alors qu’il lui suffirait de
sortir le centième de son salaire pour tripler la mise ?
C’est bien ici, à la campagne française, qu’on tue le monde du vivant,
principalement par la surconsommation de combustibles. Le tourisme de
consommation est notre seule véritable industrie, si ce n’est le
touriste-fermier, également véhiculé, qui fait le tour de ses champs en
tracteur. Qu’est-ce qu’on fera lorsque les touristes, ce sont les
réfugiés climatiques des départements avoisinants ? Leur parler de
nos droits de propriété ?
La Beauté
J’ai été saisi, la semaine avant-dernière, à partir de la crête qui
surplombe la vallée de Saint Martin de Lansuscle, par la beauté, il n’y a
pas d’autre mot, du paysage qui s’étalait devant moi. La beauté de la
munificence. La châtaigneraie qui s’étale de tous bords, les montagnes
qui se succèdent jusqu’aux horizons, l’accidentation, les petits hameaux
imbriqués dans ce velours vert profond, châtaigne, escarpé, à tout
niveau des vallées d’une éternelle profondeur.
Je suis en train d’essayer de faire une liste de toutes les raisons pour
lesquelles on n’agit pas, ici, pour détourner le navire dans sa folle
course envers la falaise du néant. J’essaie, vraiment, de me mettre dans
la tête, de ne pas sous-estimer, de ne pas prendre à mal ou
déconsidérer les gens d’en face. Il en va de ma propre crédibilité
envers moi-même.
retours sur expérience
Et c’est pour cela que je deviens furax. Je bute contre une réalité qui
me paraît incontestable, n’importe le sens dans lequel je le tourne.
Je suis tombé sur un exemple d’une manière de tourner la chose dans la
tête. C’est l’argent. Genre : « Il faut bien de l’argent, si
tu vis sans argent, tu profites du contribuable ». En effet, j’ai
le CMU. Je contribues, moi aussi. Tout ne dépend pas de l’argent – qui
n’est qu’un moyen d’échange entre autres. Il y a également échange et
transmission de savoirs et travail productif humain, qui est à
valoriser. L’argent ne se mange pas, c’est ce que l’on produit qui se
mange.
Si je n’avais pas la carte de séjour, j’aurais l’AME – l’aide médical
aux étrangers, également « grâce aux contribuables ». Il
paraît que l’on va terminer avec tout ça, mieux laisser crever les gens
dans la rue. Réalisme, on appelle ça. Si on avait une bonne appréciation
des « contribuables », les humains, on s’occuperait de leur
entretien, comme on le fait avec un véhicule, c’est un peu ça, l’aide
médicale d’état ou le CMU. Lorsqu’on me le permet, j’aménage des jardins
pérennes et je sème des fruits et légumes, entre autre. Il ne pourrait
pas y avoir quelque chose de plus purement productif, de biodiversité,
de réponses au réchauffement du climat, et de quoi alimenter le monde
humain. Oui, je contribue.
Si le ton est acide, on peut également féliciter « les
contribuables » pour leur contribution, à travers leurs
« activités économiques », à la fin du monde, grâce au
réchauffement global. Merci pour toutes ces millions de kilomètres de
routes, goudronnées et bétonnés pour qu’on leur roule dessus, pour
réchauffer la planète. Merci aux subventions gouvernementales pour ces
milliards d’hectares de terre agricole compactée, sans vie, créant des
inondations par ruissellement chaque fois plus intenses, avec une perte
accélérée des sols.
Ce sont des adultes, quand même, ils ne sont pas bêtes. Si leurs
justifications sont bidons, ils le savent, dans le fond. Et je dois les
côtoyer.
Faîtes pas ci, faîtes pas ça. Faîtes quelque chose qui fait du sens, je
veux croire en vous ! Dans le non-dit, les gens paraissent avoir
élaboré des schémas mentaux du monde qui remplacent ce qui est devant
leurs yeux. La culture de l’argent hypnotise.
Pendant ce marché de Sainte Croix VF, j’ai fait un stand nominal pour la
première fois (ici). J’ai affiché les raisons de ma présence :
remplacer la voiture, pour faire simple. J’ai commencé à avoir des
retours, je pense en faire une sorte de question-réponse, les premiers
jets d’un discours, avant qu’ils ne s’effacent dans ma mémoire.
Il y a eu des regards intempestueux, des aversions d’yeux, des comportements de dégoût.
Ici-bas le genre de commentaire :
- les politiciens ou socialites rodés estiment que les gens ne veulent
pas y aller. Appelons cette attitude le « réalisme social ».
Ils se pensent sages. Je pense que le débat n’est pas clos.
- il y a une seconde groupe de gens qui disent que les gens ne veulent
pas y aller. Ce sont les gens qui ne veulent pas y aller, mais qui se
pensent malins s’ils brouillent les pistes en disant que c’est
« les gens » qui ne veulent pas y aller. Ces gens ont tendance
à être de mauvaise foi. J’ai demandé, de face, à l’un de ceux-ci :
« tu me soutiendras donc dans ma démarche – ce n’est pas toi,
c’est moi qui les fait, les preuves d’amour pour mon
prochain ? ». Il s’est vite effacé. Tout acte de charité, tout
acte associatif, est calculé au millimètre près pour soutenir la bulle,
la foule, qui masque sa propre incohérence égoïste. C’est l’argent qui
obsède. Les politiciens ont raison de faire avec. Le vote, il est privé.
On a bien les élus qu’on mérite.
- ensuite il y a le : « tu ne peux pas forcer les gens ».
Variante : « tu ne peux pas obliger les gens ». J’ai
l’habitude de prendre ce genre de déclaration avec un grain de sel, ceux
qui le disent sont clairement de mauvaise foi, ou aveugles, ou un peu
les deux, n’est-ce pas ? Pas acquis au débat, plutôt à
l’engueulade. Ne voient-ils pas que je n’ai aucun rapport de force,
aucune possibilité de contraindre qui que ce soit ? De quelle
contrainte parlent-ils ? Ne voient-ils pas que je suis seul, face à
une société qui n’a manifestement aucune sympathie avec ma cause ?
Ils m’assurent que non, au contraire, la cause, elle est jolie, c’est
moi qui m’y prends mal, … Mais dans ce cas, ils sont où, les
autres ? C’est un sale boulot, ce que je fais.
Ou est-ce moi qui suis de mauvaise foi, en disant tout ça ? Je
reconnais qu’il n’est pas strictement vrai que les gens n’ont
« aucune sympathie avec ma cause ». J’ai plutôt la sensation
qu’ils me regardent avec fascination, à dire les choses qu’ils n’osent
pas dire, en public, à faire les choses qu’ils n’osent pas faire. Dire
qu’on ne croit pas dans l’argent, aujourd’hui, c’est un peu comme dire
qu’on ne croyait pas en Dieu, au dix-huitième siècle. C’était hautement
sulfureux. Surtout à la campagne.
« Forcer les gens », c’est cela. N’importe que les mots ne
veulent pas dire cela, c’est un peu comme se déclarer athée à la Mecque,
cela ne se fait pas, il y a des limites. C’est l’une des choses qui
fait surface la plus fréquemment, il faut le reconnaître. Bon, je fais
mon boulot, devenu un peu anthropologique, à force. Et comme je le dis,
il est manifeste, à la campagne, que comme un seul homme, personne n’a
envie d’y aller, par le chemin que je propose. Sans voiture, sans
débroussailleuse, ils seraient où ? Ils raisonnent presque
exclusivement de manière auto-centrés, comme si c’était à d’autres,
élus, administrateurs, de s’occuper de cela. Une élaboration de cette
thèse, c’est l’idée qu’il ne serait pas « démocratique »
d’imposer le point de vu d’une seule personne sur la majorité. Je
n’impose rien. Il est vrai que le système que je propose, en agissant,
peut s’imposer comme norme, les choses évoluent. C’est une proposition,
pas une imposition.
Cette question, pour eux, il faut qu’elle reste rhétorique. Moi, je
propose de la concrétiser – de donner des réponses pertinentes.
Ils ont l’habitude, les gens, tout-à-fait prédictible pour moi
maintenant, de lancer une autre petite phrase tueuse, d’une stupidité
sans bornes, « c’est ton choix » - l’objet paraît être de
réduire tout à la seule prérogative individuelle, une sorte de
libertarianisme totalitaire des plus nantis. Tous ensemble qui veulent
la voiture, la monoculture, le confort de vie, l’indépendance de soi.
Soi et ses amis. Grâce, non pas à la voiture, mais au combustible, à
l’argent. A la campagne industrielle, c’est une évidence.
C’est, après tout, ici qu’on tue le monde, ici que l’on a le profile de
consommation d’hydrocarbures le plus grand, pour les populations les
plus riches. Paradoxe, une bonne partie de cette richesse s’écoule on
essence. J’observe que ces populations font deux choses, ils exportent
presque tout l’argent qu’ils gagnent en dehors du milieu rural, avec
chaque visite à la station essence, c’est très efficace. Et à la fois,
je constate, ils sont tous subventionnés, ils ne vivent aucunement du
terroir. C’est juste un paysage. C’est très bizarre, de vivre sans
argent à la campagne, tous les « bons bosseurs », ils vivent
des subventions. Cela donne une sorte de société schizophrène, avec la
valeur travail, les machines qui font le travail, le tourisme et les
subventions – l’argent. Je ne demande pas le RSA. Le RSA est nécessaire
pour alimenter la voiture en essence.
Pour cela que la beauté de ce paysage a quelque chose de tellement
triste, même une latence menaçante, malsaine. Elle n’est que scène, en
réalité. Fonctionnellement, elle n’existe déjà plus, son intelligence
d’être se détisse avec une rapidité remarquable. Et elle est distante.
Ce que l’on voit de près, c’est la route et les pancartes écrites en
grosses lettres pour qu’on puisse les lire en roulant vite. On ne voit
que des paysages.
Nous nous en prendrons, les uns contre les autres – les humains, ils
sont comme ça, il doivent toujours trouver quelqu’un qui est le
responsable de leur malheur. J’ai vu, à deux reprises, des mecs qui, si
je ne me trompe pas, auraient bien voulu en découdre avec moi, pour la
seule raison que j’ai affiché, en grosses lettres noires :
« La Banquise fond et ici on joue aux p’tites voitures »
suivi de
C’est quoi une vraie
« petite logistique » ?
… SANS VOITURE !
Je reconnais que c’était de la provoc, mais aussi, j’ai longuement
réfléchi, et je ne savais pas mieux dire, en peu de mots, ce qui
encapsulerait l’idée, sincère, de ce qu’il faudrait faire, de ce que je
faisais, déjà.
L’autre occasion était lorsque j’ai dit, point blanc, à quelqu’un, un
paysan, que non, je n’allais pas utiliser une débroussailleuse, j’allais
utiliser une faucille. J’ai compris qu’il avait deux choses en tête, la
première étant une vie de travail physique sans relâche, depuis
l’enfance, où son père l’avait interdit le club de foot (adhésion trop
chère) pour l’envoyer ramasser des châtaignes chaque jour, jusqu’au
débordement des centaines d’hectares qu’il devait entretenir « tout
seul », qui l’a cassé. La deuxième, c’était les connards qu’il a
du subir, toute sa vie, qui ne comprenaient pas cette vie de dure
labeur, qui proposaient des méthodes totalement maladaptives à la
réalité administrative qu’il vivait.
Cette trame se répète, paraît-il, à l’infinie, chaque personne qui
travaille ici, elle travaille « à distance » si elle est
employée, pas toujours, mais disons que si tu te présentes pour un
travail à la campagne, sans voiture, tu as peu de chance d’être
embauché. C’est cette fameuse « réalité ». Et si tu veux
travailler « avec la nature », on te mettra à coup sûr une
débroussailleuse ou un volant entre les mains. C’est la réalité qu’il
faut changer, et tout de suite, si le monde a un avenir. Mais dans cette
campagne, on vit l’inverse, on vit la folie, grandeur nature.
En cela, je suis d’accord avec Arthur Ashe, que j’ai entendu à la radio,
on vit une époque de folie collective où l’auto-défense se dresse
surtout contre ceux qui osent proposer des systèmes, des infrastructures
non-folles.
Je notes, donc, que oui, il est parfaitement possible, avec une faucille
et une paire de sécateurs bien à point, bien affûtées, une scie à bois,
une pelle-bèche, de s’attaquer au travail d’entretien d’un paysage, et
que si l’on fait bien son travail, en formant les haies et les
terrasses, on peut mettre le bétail pour faire le reste, à la bonne
saison, cheptel réduit par un facteur de dix, bien sûr. C’est un travail
qui se fait dans le détail, qui se combine avec beaucoup de jardinage,
de production et de ramassage de fruits et légumes. De quoi ne pas être
riche, comme dans le bon vieux temps. Tu veux être riche et mort, ou pas
riche et pas mort ?
L’intérêt de ces méthodes est à deux coups, il donne de quoi vivre à
l’humain et au reste du vivant – la biodiversité. Ce sont des méthodes
qui augmentent la rétention de l’eau dans le sol et auprès du sol, qui
diminuent la chaleur et encouragent les précipitations.
L’obstacle premier à ces méthodes, c’est le cadre administratif et
règlementaire, qui vise à nous obliger, à nous contraindre à pratiquer
une agriculture extensive et industrielle, qui tue le vivant. C’est
intéressant de noter que, des deux côtés, on est d’accord sur l’objet de
discussion, que l’on veut de l’essence moins chère, ou plus du tout,
c’est bien le sujet à débattre.
L’agriculteur d’aujourd’hui est né avec ce camisole administratif, mais
cela va bien plus loin, sa culture, productiviste jusqu’au dernier
souffle, paraît similaire à celle de l’industrie extractiviste, ce n’est
pas pour rien que l’agriculteur s’appelle « exploitant
agricole ».
On ne peut pas revenir en arrière
Cette phrase est sortie, bien sûr, lorsqu’on propose de faire
manuellement ce qui se fait à la machine – faucille contre
débroussailleuse. Ensuite, les mots « développement » et
« progrès » ne tardent pas à être prononcés. Mais en fait, la
tragédie, c’est que ce capitalisme extractiviste, hors-sol, est très
ancien. A l’époque moderne, il est féodaliste, mais on le voit également
à l’époque de l’Empire Romain. C’est une colonialisme d’extraction, qui
laisse souvent des territoires totalement détruits derrière lui.
Actuellement, la priorité est de réhydrater le paysage et les sols,
évoluer des techniques de survie pour la vie restante, lorsque les
seuils de tolérance sont atteints, d’espèce en espèce.
Aujourd’hui, nous voyons bien que le monde n’est pas infini, que nous
épuisons vite les ressources, atteignons les limites de la production.
Mais ce n’est le cas que tout dernièrement. Avant, on pouvait exploiter à
fond, jusqu’à l’épuisement, et passer à autre chose, ailleurs. Nous
avons la culture de l’avant dans nos têtes, celui qui dit « je vais
exploiter jusqu’à l’épuisement mes terres » et celui qui dit
« moi, tout petit, je ne peux rien changer », toutes les
excuses sont bonnes, sont mensongères, sont des codes sociaux.
Je suggère que l’on ne revient pas en arrière, à l’époque de
l’agriculture industrielle, donc, mais que l’on crée des infrastructures
où ceux qui passent et ceux qui vivent dans des lieux partagent
l’ambition d’en nourrir la vie, à l’échelle humaine, plutôt que d’en
extraire la substance vitale, avec des machines.
Tourisme : consommation ou production ?
C’est dans ce cadre que l’on peut revisiter l’idée du tourisme.
En ce qui concerne le gros du travail et de l’emploi à la campagne, il
est dédié au tourisme, en France. Le tourisme est un intrant, il
consiste en personnes qui viennent de l’extérieur, avec de l’argent.
Tout comme le pétrole. Le touriste importe le pétrole.
Et c’est pour cela que lorsqu’on regarde bien, et bien objectivement, la
campagne française d’aujourd’hui, on peut voir qu’elle est exsangue,
elle n’existe que par les flux, essentiellement d’essence et de produits
pétroliers. L’eau se fait rarissime. Les salaires des gens sont gonflés
au niveau où il est possible de se payer les machines industrielles
nécessaires pour faire perdurer ce modèle. On y récolte la mauvaise
santé, le mal de vivre, la boulimie et le sourire idiot.
Si les gens n’avaient qu’à manger, niveau « énergie nécessaire pour
vivre », ils redécouvriraient que ce qu’ils voient comme paysage
est en réalité magnifiquement productif, pour des populations plusieurs
fois plus grandes que celles qui existent actuellement.
Et c’est pour cela que ma fureur augmente, je vois que c’est la dernière
chose que veulent les gens qui sont installés là. Ils veulent tout ça
pour eux. Ils veulent « quelques réfugiés » mais pas trop. Ils
ne se sentent pas en capacité d’accueillir toutes les misères du monde.
Vas dire cela à un rwandais, il te rit au nez.
Comme tout le monde, quoi. Des enfants. Devenir adulte, c’est apprendre
qu’on ne peut pas avoir tout ce qu’on veut, qu’il faut tenir en compte
ce que veulent les autres. Je comprends que le droit à la propriété
privée est l’un des principes de la Déclaration de Droits de l’Homme de
la révolution française, qu’elle est, en partie, une réaction contre le
pouvoir arbitraire de l’état absolutiste, mais cet état absolutiste y
laisse ses traces. C’est comme si chaque adulte devenait un enfant
irresponsable, qui dit « je fais ce que je veux chez moi, point
barre ». Et c’est à l’état de lui assurer son rêve-fiction, sinon
il se révolte, c’est juvénile.
Cette idée va bien plus loin dans les Cévennes, c’est comme si chaque
petit bled imaginait que la vraie liberté, ce serait quand elle
réalisait une autarcie communale totale, alimentée par des voitures.
Chaque segment de la population a ses propres raisons, croit-il, pour
protéger son style de vie – les chasseurs, les anti-chasse, les éditeurs
et vedettes à la semi-retraite, les pratiquants de médecine alternative
avec des jeunes familles, les services à la personne qui s’occupent de
la campagne EHPAD, la campagne HP, scolaire, sports pleine nature, et
dans les Cévennes, la chaleur et la solidarité humaine, face à l’état,
créent d’autres synergies d’auto-protection, un vaste immobilisme social
qui augmente ma fureur.
C’est ici que l’on tue le monde. N’avez-vous pas noté, le tabou, dans
tous ces questionnements, c’est de mettre en question la voiture à la
campagne ? Macron l’a bien compris. Une interlocutrice m’a dit,
aujourd’hui, qu’elle a voté écologiste pendant des années, jusqu’à ce
que, selon ses dires, les écolos soient devenus « punitifs ».
C’est la même personne qui m’a posé la question « mais comment
voulez-vous que je vienne visiter mes enfants de la Bretagne, sans
voiture ? ».
Ou il y a « comment voulez-vous que j’amène mes enfants à la
crèche, je vis sur les Causses ? ». Ou « comment veux-tu
que je viennes à mon atelier, j’ai pris un an pour en trouver un,
tellement il y a peu d’endroits à louer ? ».
Chacune de ces personnes a choisi de vivre là où il vit. Autour d’elle,
des granges béantes, des ruines cadastrées, des pans de montagne entiers
en friche à cause de la confusion multipropriétariale, victimes du
système d’héritage fissile, et le Parc National, qui agit pour nier aux
humains l’accès à l’habitat.
Pour les personnes qui essaient, à titre personnel, de créer un îlot de
vraie fonctionnalité du vivant, sans les carcasses de voitures et de
camions, il y a la menace de se faire détruire son habitat. On peut dire
que dans la mesure que l’on vit en cohérence avec l’écologie, on vit en
illégalité, ici. Lorsqu’on défend des arbres qui risquent de vivre des
centaines d’années, on fait une bêtise. L’agriculture, c’est la
destruction annuelle de tout ce qui vit. C’est un champs. Il faut que ce
soit « nickel et propre » pour attirer les subventions. Tout
est réduit en poudre, idéalement chaque année. Faucheuse,
Moissonneuse-batteuse, Girobroyeuse, Débroussailleuse, ces noms laissent
peu à l’imagination, leur boulot est de détruire le vivant, à
répétition.
jeudi 2 octobre 2023
En fait, je me trouve face à une culture de plus en plus aliène. Je
viens de voir un film, Anatomie d’une Chute, qui laisse en creux son
sujet, au point de risquer d’être idéologique, dogmatique, enfin c’est
mon doute. La question posée dans le film est, est-ce que le mari s’est
suicidé ou est-ce qu’il a été tué par sa femme ? La réponse :
il est responsable de ses propres actes. On a entendu leur dispute de la
veille, où elle a été cruelle avec lui, ce qui expliquerait son élan
suicidaire. Le film « ne juge pas ». Tout est question de
responsabilité individuelle.
C’est le soir d’une grande tempête, sur l’ouest du pays. Sur France Info
on a droit à une série d’experts qui recommandent de rester chez soi,
pour ne pas répéter une autre grande tempête de 1999, qui a produit des
fatalités, faute d’anticipation. Ici, dans les Cévennes, il ne pleut
même pas et il n’y a aucun vent.
Les deux sujets se lient dans ma tête, par le biais de la responsabilité
et les conséquences collectives. Ce qui a changé dans les 23 ans entre
les deux tempêtes. D’abord la fiabilité des prévisions. Ensuite, la
technologie des alertes par téléphone portable, vraiment très efficace,
si tu as un téléphone portable et qu’il est géolocalisé. Mais il y a un
problème,qu’est-ce qui se passe si tout le monde reçoit la mauvaise
information ? Avec moins d’efficacité, voir des décisions dans des
petits agglomérats de communicants humains, il pourrait y avoir plus de
fatalités, mais aussi plus de chances que certains des groupes s’en
sortiraient. C’est un peu ce que fait l’évolution.
Mais une société où tout est ou noir ou blanc ne permet pas cette
flexibilité, ou elle tient, ou elle casse, elle est devenue
« brittle », cassante. Comme nous n’acceptons plus la moindre
fatalité, nous n’avons pas la moindre résilience. Nous ne courons plus
de risques. Les individus ne se sacrifient pas, les uns pour les autres,
tous travaillent pour qu’il n’y ait aucun risque. Un peu comme dans une
guerre où aucun de ses soldats ne meure (et toutes les morts sont de
l’autre côté).
Mais la mort, elle reste une fatalité, pour nous tous. Qu’est-ce qu’on
aura gagné ? Il me paraît qu’il y a un glitch logique, de faire
appliquer une logique de calcul des individus morts, pour généraliser
sur une société où personne ne meure. La société n’est pas la somme des
individualités. Est-ce que la réalité sociale chiffrée, par nombre
d’individualités, a un sens ? Peut-être pas, peut-être la méthode
de calcul est erronée.
Pour le film, la méthode de calcul est erronée, l’attitude de la femme
pèse dans la mort de son mari, même si elle ne le tue pas. N’y a-t-il
pas lieu déconsidérer une autre méthode de calcul, de calcul intriqué,
pour résoudre ces équations ?
Pour la tempête, pour ceux qui aiment braver les vents, qui ne portent
pas de portables, n-y a-t-il pas un risque de mort acceptable ? Le
problème avec des chiffres simples, cumulatifs, c’est que l’idéal, c’est
zéro morts, mais j’aurais tendance à croire que, vu les mesures qui
doivent être prises pour atteindre cet objectif, mieux vaudrait proposer
que l’idéal, c’est quelques morts, ou que l’idéal, il ne se mesure pas
en morts.
Bletchley Park : IA générative, reconnaissance faciale. Mêmes
thèmes, en quelque sorte. Le monde est tellement branché que tout le
monde se jette sur le même sujet, avant que cela ne vrille, hors
contrôle. Ils savent qu’il faut une seule instance d’une nouvelle idée
technologique, pour que cela se répande à la vitesse de la lumière
partout. De nouveau, ne serait-il pas de bon conseil de limiter la
rapidité et l’échelle de ces mouvements ? Comment mesurer ce
déclinaison ? Ce n’est pas un chiffre, c’est une modalité
organisatrice.
Comme le langage. Comment mesurer l’efficacité du langage ? Je
remarque que j’ai été troublé dès le début par la linguistique
quantitative, mesurer le vocabulaire des gens, la fréquence des mots,
même la configuration des mots – les mots en préfixe « co- »
par exemple. Ce n’est pas ça, la langue. Ce n’est que le sens qu’il
fait, la langue.
Ce n’est pas en utilisant peu de mots qu’on fait plus de sens, la
breveté n’est pas censé être plus sensé. On peut proposer d’autres
systèmes que la langue, pour penser, sans doute, ce n’est pas pour
autant que ces autres systèmes ou méthodes font plus de sens, pour nous
ou par leurs conséquences.
Et des langues, il en a toujours eu, pendant qu’on a été là. Donc, comme
pour l’évolution, l’idée d’une langue universelle est un oxymore, le
fait linguistique est autant construit sur l’incompréhension mutuelle
que l’intelligibilité.
A moins que je me trompes, le but de ces intelligences artificielles
est, en quelque sorte, de rendre intelligible, tandis que chez l’être
humain, on chuchote, on parle d’autres langues ou du jargon, en baisse
ou on monte la voix, tout dans le but de ne pas être compris par
certains, et d’être compris par certains autres.
Question d’organisation, de nouveau, pas de quantités, de 0 à 20,
négatives, positives, qui mesurent les résultats, pas les processus.
🖶
↑
↓
dimanche 5 novembre 2023
Erreurs
Pour reprendre, là où la Censure
termine, il m’arrive de penser que l’errance est dans la nature de
l’être humain et qu’en se le disant, on ne dit pas autre chose que
l’algorithme est dans la nature.
Le décodage, la synthèse et la reproduction de phénomènes naturelles,
n’est-ce pas le travail de la science et de sa technologie ?
Dans ce cas, en nous appliquant à nous-mêmes, nous n’avons qu’à faire d’une vice une vertu – de notre imperfection un atout.
L’émulation, l’algorithme, à la base, est une série d’itérations avec
des checksums – des vérifications contre des valeurs référentielles,
selon les buts recherchés.
On peut comparer ce processus au tir à l’arc – on tire, on note que la
flèche est partie en haut, à gauche, on rectifie le tir, cette fois-ci
la flèche se loge en bas, à droite dans le cible, on rectifie de
nouveau, la flèche est planté dans le centre du cible.
Autre scénario, qui m’a été raconté, un groupe de jeunes s’en va en
jungle avec des lance-pierres. Ayant perçu une proie dans les arbres,
ils tirent tous dessus, l’une des pierres ou plusieurs atteignent la
proie, qui tombe.
Ici il y a des actions et des interactions, parfois en parallèle, la
proie a potentiellement le temps de réagir aux trajectoires qu’il
perçoit, mais pas tous à la fois, la pierre qui l’atteint n’est pas
nécessairement celle de celui qui a bien visé mais n’importe laquelle
des pierres dans un rayon autour de l’animal.
Ceci est, il me semble, un processus algorithmique, composé d’erreurs. Il marche.
Peut-être ce qu’il nous faut apprendre, de nos jours, c’est qu’il n’y a
pas d’intelligence supérieure à la situation dans laquelle elle se
trouve – son contexte.
Pour autant, l’intelligence n’est pas une quantité mesurable en dehors
de sa situation – là où elle se trouve au moment où elle s’y trouve.
L’intelligence, dans le cas de la bande de jeunes à la jungle, est bien
collective – c’est un ensemble situationnel. L'ensemble social, la
mixité sociale, c'est essentiel.
Nous devons, en quelque sorte, nous délaver le cerveau, par rapport à la
haute technologie, ne pas nous laisser prendre dans le filet des
adorateurs d’objets – de gadgets, de manière semi-religieuse. Qui adore,
qui adorer ?
🖶
↑
↓
vendredi 3 novembre 2023
Censure
Je lis l’article de la Quadrature du Net sur la loi de l’anti-arnaque ici. J’ai de la Schadenfreude. Pourquoi ? Parce que, selon moi, c’est
à peu près inévitable qu’on arrive à ce point-là. La liberté du Net,
épousé par la Quadrature du Net, est illusoire, cela a toujours été un
mythe, au moins en termes absolus.
Cela a à voir avec la logistique des flux de l’information. La grande
logistique n’est administrable qu’à partir des nœuds qui centralisent.
C’est pour dire, dans la mesure qu’une information se répand sur des
réseaux ubiquiteux, il n’est jamais contenable par des individus sans
pouvoir, c’est même une contradiction implicite. Le Web, s’il est
partout, tout le temps, à l’instant, sera, finalement, dans les mains de
ceux qui administrent les nœuds d’accès aux réseaux. La Quadrature du
Net le veut autrement, mais il ne suffit pas de vouloir. Elle risque
d’être perçue, si elle continue sur cette ligne, comme l’une des
participantes dans une révolte de palais.
La course poursuite entre VPN (réseaux virtuels privés) des
« worm-holes » dans la fabrique internautique, et les
autorités ressemble à ces guerres privées d’information entre services
d’espionnage. Elle a comme critère de base une competition entre geeks,
chacun qui espère se montrer plus malin que l’autre, avec la conséquence
que monsieur ou madame tout-le-monde ne fait plus le poids.
Le monde du vivant a déjà résolu le problème, il a des acteurs vraiment
autonomes. Un livre sur la révolte au Moyen Âge par Patrick Boucheran
explique le concept – ce dont les classes dirigeantes avaient vraiment
peur, à cette époque, c’était que les paysans s’en aillent. Pour cette
circonstance, ils n’avaient pas de riposte. Il est vrai que cette menace
existait dans un monde qui dépendait du travail humain encore, …
Le maillage du Web est si complet que, comme une coopération entre
barons féodaux, il permet qu’il n’y ait aucun recoin, aucun refuge –
tant que les gens sont obligés de passer par les portables ou les
réseaux internet pour participer à la société. C'est un constat, c'est
déjà le cas, essentiellement. Les caméras, l’IA et les drones
quadrillent la terre, mais attention – il y a beaucoup de terre et ces
machines ne peuvent pas tout, si ce n’est que pour des simples raisons
de ressources terriennes limitées.
Le vivant a encore des bonnes ripostes, mais seulement si l’on accepte
de constituer des sociétés basées sur nos propres recours, qui ne
passent pas ou qui ne dépendent pas, viscéralement, de l’électronique,
et c’est là que, fatalement, les ingénieurs du numérique ont leur point
aveugle. Mais nous pouvons apprendre de la structuration informatique du
vivant – qui est capable de se créer de multiples autonomies ou
cohérences, localement, tout en retenant de la connectivité au long
cours.
Les enjeux ont subtilement changé, entre temps – entre l’avenu du web et
aujourd’hui. La frugalité dans le dépens énergetique, l’efficience
énergétique, sont des enjeux sociaux partagés aujourd’hui, par le gros
de la société. D’accord, on commence de bien loin et on est encore dans
la société de la surconsommation, mais le consensus collectif n’est plus
là, c’est même devenu ringard de brasser de l’énergie fossile.
C’est donc tout ce qui est mécanique et électronique qui aura,
dorénavant, tendance à se trouver en dehors de la société et c’est ce
que l’on perçoit comme étant à la marge – le vivant – qui deviendra de
nouveau précieux et « dominant » - si ce dernier terme aura
encore un sens. Quels sont les flux informationnels entre les êtres
vivants, quelle est leur efficacité? Pas pour tout un chacun, mais
demanière systémique ? Je crois que nous avons déjà nos intuitions
là-dessus.
La bouche à oreille, la rumeur, le présentiel assumeront de plus en plus
d’importance, et il deviendra un peu évident que ce que ne peut pas une
Intelligence Artificielle, c’est d’être en train d’aller d’un endroit à
autre tout en étant partout à la fois. Si elle nous remplace, nous ne
sommes plus là, comme les paysans qui s’en vont. Où est-elle, donc ?
L’information, c’est une interaction. L’IA peut chercher à s’imposer, à
figer le vivant, comme les riches qui tentent de figer les pauvres dans
leurs hameaux, mais c’est diablement difficile.Faire terre rase ? Oui,
peut-être, mais il est difficile de levoir commeun acte amical. Si ce
n’est que pour cela, les geeks doivent devenir un peu plus audacieux,
ils doivent apprendre eux-mêmes à sortir et à rencontrer le commun des
mortels sur leur terrain, les approvisionner en wormholes à leur
échelle.
Parce que la technologie de l’information est en réalité à la portée de
tous, nous sommes l’information que nous portons. L’échange que nous
avons établi entre nous et les machines, machines de transport –
voitures, drones ; machines de communication – portables,
fibre-optique; machines de calcul – ordinateurs; machines de travail –
robots, tronçonneuses; s’est fait avec des vastes compromis avec nos
modes d’opération et d'être humains. On a supposé que le jeu vaut la
chandelle - mais qui le croit vraiment encore ? Au mieux, il y aura
quelques survivants qui en bénéficient, peut-être sur Mars, et d'une
humanité méconnaissable. Je ne peux m'empêcher de citer le panneau qui
se trouve sur l'écran d'à côté, dans cette médiathèque, il y est écrit
« Rencontrer et converser avec vos proches ». Assis sur la
chaise d'en face, un enfant d'environ 1 an, avec sa mère et son amie à
proximité. Il mesembleque l'on sait déjà rencontrer et converser avec
nos proches, l'idée qu'il nous faudrait un ordinateur pour y arriver
n'est peut-être pas à l'apogée du progrès.
Les geeks activistes sont les premiers à critiquer la manière dont cette
technologie a été détournée pour renforcer la mainmise du pouvoir, mais
dans ce cas, ils devraient être les premiers à morcelliser le web, pour
qu’il corresponde mieux aux intérêts et à l’autonomie du vivant. On
pourrait dire, pour transmuter un dicton, que j’aime tellement le web
que j’en voudrais plusieurs.
Et il ne faut pas arrêter là, il est parfaitement possible de nous
désautarciser, individuellement, pour donner des accès groupés à
internet ou à la technologie des portables. Horizontaliser le pouvoir,
dans le jargon, c’est aussi repenser l’autonomie. L’assistance, le
secretariat, la complémentarité, vues comme des valeurs positives. Les
trous dans la raquette du numérique, les failles, comme des sources de
richesse. Là où il y a absence d’information, absence de certitude, on a
tout intérêt à poursuivre son entreprise.
C'est justement dans cette réalisation que l'humain n'est pas
l'intelligence suprème, qu'il n'y a pas de génie propre, que nous
pouvons, peut-être, prendre notre place dans la trame du pouvoir. C'est
par nos erreurs que nous triompherons !
🖶
↑
↓
jeudi-vendredi 8 / 9 juin 2023
Scalar
Une question d’échelles ?
Je suis en train de rouler sur une route, dans l’occurrence l’avenue de
Toulouse, à Montpellier. A vélo. Une colonne de trafic monte lentement
la côté vers le grand M, il fait chaud, humide, la pollution est au max.
Je regarde par habitude le bord de route, où je trouve de temps en temps
des toutes petites pièces, en cuivre. Je les ai toujours trouvé
magiques et distrayantes, les bords de route, les lisières, ce sont
comme des livres ouverts sur les histoires des « habitants »
défilants. Plus rarement, des pièces en bronze. Très rarement,
bimétalliques. Je me demande si leur rareté est dûe principalement à
leur valeur relative, leur poids, leur visibilité, il y a sans doute une
courbe de distribution qui s’explique par plusieurs facteurs, ce qui
n’empêche pas qu’il y ait un ou eux facteurs qui sortent du lot, en
termes de prévision.
Mes errances doivent paraître assez bizarres, du point de vu des
conducteurs de voiture. Je m’arrête, j’attends que le file se mette en
motion, je rebrousse chemin, je récupère, tout en essayant de n’avoir
l’air de rien, comme le paysage. Je ne sais pas si c’est par pudeur,
mais c’est une route que je fréquente, à des horaires assez habituels.
Il se peut que je suis un personnage connu, dans les parages, pour cette
seule tendance, alors que les autres véhicules restent mutuellement peu
familiers, surtout que les couleurs noir et blanc et les formes très
similaires rendent la tâche d’identification sans intérêt.
Mes errances vont plus loin. Je vois une rue parallèle sur laquelle je
ne me suis pas encore aventuré, je m’y lance. C’est comme ça que j’ai
trouvé une pièce de 2, oui je dis bien DEUX euros, sur une route que je
n’ai jamais fréquenté auparavant. Juste parce que je suis allé
voir ! Est-ce que je suis le seul collecteur de pièces comme ça, et
qu’il eût fallu que moi, j’y passe, pour récupérer la pièce, restée
plusieurs semaines sur place ?
Peut-être les détecteurs de métaux seront les premiers à utiliser des
robots pour "tout prendre" et qu'ils ne sont pas passés par là parce que
ce n'est pas sur google, encore.
Peut-être vaudrait-il mieux le considérer du point de vu de la volonté
des parsemeurs de pièces – on les jette, on les perd, mais si la valeur
est suffisante, on est plus attentif, on les retient et on les récupère.
Dans des milliers de co-locs, un pot à pièces permet de condenser les
pièces les plus humbles, comme leçon de vie, pour, dans un cas
d’urgence, les compter et aller emmerder le commerçant du coin. Mais
sinon, on les jette, on les perd, partout où on va. Quelle insouciance !
Mes errances, je le ressens, ressembleront probablement aux errances des
fourmis ou des autres animaux qui cherchent du fourrage. Peut-être pas
aux patrouilles des prédateurs, autour de leurs territoires – qui
chercheront plutôt des points panoramiques, où l’on peut faire le guet,
sentir le vent, écouter les sons. Ce sont, en tous cas, des
« search patterns », ce qui n'est pas le cas pour les colonnes
de voitures régimentées.
La route majeure sur laquelle je me trouve est dédiée à l’expédition à
destination du maximum de véhicules par heure. Des
« échoppes » essaient de choper le trafic au passage, en
rajoutant des ronds-points aux ronds-points, des drives aux parkings,
comme du camouflage culturel. Le rond-point du grand M a aussi son petit
M, le Macdonalds, trois supermarchés, une salle de sports, un magasin
de bricolage, … Le vacarme est terrible, jour et nuit les
infra-sons nous vibrent.
Est-ce que, dans le monde non-artificialisé, il y avait de telles
affluences, de telles populations mixtes ? Il y a le bruit des
marées, des orages, des cascades et rapides, eau assourdissante à la
longue, le bruit de la pluie sur la tôle, symptômes de l’entropisation
et des franges d’interférence déchaînées.
Ou est-ce juste une folie passagère, d’essayer de faire se côtoyer des
voitures, des camions, des bus, des motos, des vélos, des
trottinettes ? On voit le stress que cela induit, de par la
multiplication et la ségrégation des voies : trottoir, piste
cyclable, voie de bus, route à voitures. Dans la version de luxe, on
rajoute un ou deux tramways. La surface latérale devient tout simplement
démesurée, jusqu’à cent mètres de large – ces voies prennent plus de
place que leurs destinations, mais sans aucun but d'efficacité
productive en perspective. La fin justifie les moyens, les moyens la fin
… à perte d'horizons. On amène de la glace aux tropiques.
Niveau temps de parcours, il se passe quelque chose d’intéressant, c’est
souvent le vélo qui prime. Les gens se plaignent que les vélos – et
d’autant plus les trottinettes – ignorent le code de la route, ce qui
est idiot – tout le monde ignore conscientieusement le code de la route,
y inclus ceux qui la construisent – surtout ceux qui la construisent,
par observation.
Sur l’avenue de Toulouse, on voit par exemple que la règle d’un mètre et
demie de distance entre les voitures et les vélos varie – parfois la
piste vélo s’arrête, coup net, comme si l’on avait abandonné la partie.
Parfois on cohabite avec les bus, parfois non. On m’a expliqué que les
voies de bus et pistes cyclables en rose, sont de couleur rose pour ne
pas trop offenser les automobilistes – ils auraient l’impression qu’on
les avaient envahi et volé « leur » route, si c’était du
jaune. Petit à petit, on me dit, avec un sourire malicieux.
On « ignore » le code de la route pour des raisons de sécurité
– si on ne l’ignorait pas, on mettrait tout le monde en insécurité.
Chantier oblige.
Dans ce monde de flux circulatoires, ce sont les agents individuels –
les voitures, les vélos, qui prennent les décisions. Ce n’est pas qu’il
n’y a pas de règles, au contraire, mais ce n’est pas le code de la
route, tel qu’il est écrit, qui gouverne – cela est juste le début de
l’affaire.
Et observablement, cela marche assez bien, il y a très peu de signes
d’agressivité, dans un contexte qui est plutôt fait pour en créer. Les
vélos et les piétons, on leur laisse la place, on ne les klaxonne pas.
Peut-être le code de la route, il a servi à cela, au moins, à inculquer
des valeurs, des valeurs aspirationnelles, de côtoiement sans
fraternisation. Et les accidents, on les évite … c’est très dangereux,
tu peux perdre ton permis, tu peux être démasqué. On pourrait même dire
que sans culpabilité, sans peur d’être découvert, le système ne
fonctionnerait même pas.
Mais ce qui se passe sur le trottoir est encore plus auto-réglant. Entre
le bâti et le trottoir il existe des fissures. Et ces fissures servent
d’autoroute pour les fourmis. Surtout à cette époque, d’essaimage et de
division de colonies, dans la chaleur et l’humidité, l’activité est à
son comble. Il y a plusieurs fois plus de fourmis, qui courent dans les
deux sens, sur ces voies uniques, que de véhicules humains à leurs
côtés. En les observant, tu te rends compte qu’ils ne décélèrent pas,
mais qu’ils font des déviations, à toute allure, ce qui fait l’effet
d’un débordement, sur les côtés, là où il pourrait exister blocage. Mais
gare à l’humain qui fait ça, il risque d’être très mal vu !
C’est cependant un peu ce qui se passe lorsque tu as plusieurs types de
véhicules sur la même route, ils adaptent leurs parcours, de seconde en
seconde, dans des équations et des calculs vectoriels chaque fois plus
complexes, en apparence, mais qui obligent, à partir d’une certaine
saturation, à réduire la vitesse, jusqu’à ce qu’elle s’approxime à celle
des plus lents. La monoculture de la haute vitesse se plie à la
monoculture de la vitesse constante, comme avec les fourmis, dans une
certaine harmonie rythmique.
Il n’est donc pas par pur hasard que le vélo devient le véhicule le plus
rapide, dans ce contexte. Il est le plus rapide si, dans le système
globale « route », son existence est accommodée. Sans oublier
les fourmis, qui avancent peut-être aussi rapidement que les voitures,
en termes réelles, aux heures de pointe.
Après le grand M, cela devient une autre affaire, qui se ressemble à une
voie express, qui s’attache à un autre rond-point où des vraies voies
express et des vraies autoroutes commencent à s’établir.
Ici, les règles changent dramatiquement, le vélo n’a pas plus lieu
d’être sur ces voies qu’un véhicule en contre-sens. L’affluent devient
fleuve, à la confluence.
Ici, je décris une sorte d’écosystème qui émerge du seul diktat
« route », route à voitures, route à faire que les voitures,
elles roulent. Le reste, c’est du bric-à-brac, des vaines tentative de
faire que la monoculture « voitures » existe encore, mais qui
mettent en évidence tellement de variables externes que dans son
expression même, la route ne ressemble plus guère à son objectif
déclaré.
Maintenant, tournons le regard sur les variables quantifiées, parce
qu’ici, de nouveau, les objectifs ont été subvertis. Les véhicules font
pleuvoir des déchets sur la route, elles écrabouillent et rendent en
poussière et en fumée des parties d’elles-mêmes, principalement les
pneus et toutes les autres parties mouvantes, son essence. Celles-ci
s’accumulent, s’incrustent dans la matière même de la route, créent des
vernis, tuent les voisins, ce sont les « externalités » du
système « route » qui deviennent, néanmoins et cumulativement,
ce qu’est la route, noyée dans ses déchets.
Pour moi, ce sont des pièces de 2 centimes. Pour les fourmis, ce sont
des miettes. Bien que j’ai vu une fourmis en train de manœuvrer une
plume de vingt fois sa taille, cet après-midi, je méconnais les raisons,
je ne sais pas ce qu’elle voulait en faire, de la plume. Mais je sais
que les objets d’intérêt, pour une fourmi, sont tout autres que pour
moi, au point que pour moi, ils sont invisibles.
Dans un contexte naturel, une piste, une route, un chemin, c’est un
« centre de broyage ». Du fait, tout simplement, que l’on
marche dessus, qu’on la piétine. Des êtres vivants se sont saisis de
cette opportunité pour faire communauté. Les tubercules du trèfle,
comprimés et piétinés, dégagent de l’azote, ce qui intensifie, avec les
déjections des animaux, la fertilité aux deux lisières du chemin. On
voit le même phénomène en archéologie. Dans les anciens habitats
humains, on peut connaître les périmètres d’une hutte du fait que le sol
est plus riche et noir – c’est ici qu’ont atterri les détritus de la
vie de ses habitants.
Fatalement, sans plan, mais avec des résultats plutôt très utiles pour
tout le monde. Il faut chercher dans les choses les plus banales et
prosaïques, comme l’accumulation de débris autour des axes d’activité,
la base d’écosystèmes et de formes de vie les plus complexes. Plus ça
brasse, plus ça produit.
Plus c’est une route, plus ça produit, aux marges.
Sur un sentier, par exemple, on verra, à la bonne époque, des quantités
innombrables de petits monts de granules – de sable, d’argile, avec des
cratères. Ce sont les œuvres des fourmilions, qui se nourrissent des
fourmis qui tombent dedans.
On se demande comment toutes ces bestioles arrivent à éviter d’être
écrasées par les pieds de ceux qui passent. De nouveau, en étudiant les
réactions des fourmis, comme celles des moustiques ou des mouches, on se
rend compte compte du point auquel leurs jugements et leurs réactions
sont finement jugés. Pour eux, le geste le plus rapide humain est d’une
lenteur telle qu’il est facile de le prédire et de l’esquiver. La seule
manière de leur tromper dans leur réactivité est de faire approcher
l’objet – la main, le pied, de tous bords pareil, ce qui empêche le
calcul d’un vecteur d’échappement, avant qu’il ne soit trop tard pour
l’exécuter. La tue-mouches, blanche, avec ses plusieurs petits trous,
profite du même phénomène – la mouche est obligé de calculer les
plusieurs potentiels trous de secours, objets amovibles, pour s’y
échapper, avant de se rendre compte que ces trous, malheureusement, sont
trop petits pour elle. On l’a débordé d’information, pour la piéger.
théorie des catégories de nouveau
La théorie des catégories, dans la mesure que je la capte, ne parle pas
d’échelle, mais de catégorie – dont l’échelle n’est que l’un des aspects
déterminants potentiels.
globalisation
La globalisation est devenue un sujet de plus en plus en vue, dans les deux dernières décennies.
Il y a un entre deux – entre : « analyse catégorielle »
et « analyse scalaire », que j’appelle
« cohérences » - désolé s’il se trouve que c’est devenue toute
une discipline, dont je n’ai rien entendu. En tous cas, l’échelle – la
magnitude, la quantité des choses, d’un endroit à autre, est largement
insuffisant comme trame d’analyse et les « scalars » (les
mesures de volume, de vitesse, de masse, etc. ) servent,
mathématiquement, comme bases pour une analyse vectorielle d’un système –
ils sont les paramètres fixes qui permettent de mesurer la performance
du système en mouvement, tout comme la route est la base statique qui
permet le mouvement, les flux.
La globalisation est devenue un sujet brûlant parce qu’on a vu que le
cumul des plusieurs choses que l’on fait à plus petite échelle, qui ont
des impacts de plus en plus forts, potentiellement catastrophiques, au
niveau global, c’est-à-dire pour nous tous.
D’autres mots qui s’invitent dans ce contexte, sont des mots comme
« holiste » ou « dynamique », des analyses qui ont
plusieurs référents, plusieurs échelles, des mailles, des nœuds, des
interactions – ici on s’approche de la raison d’être d’une théorie des
catégories.
En fait, une analyse « top-down », une analyse
« réductionniste », une analyse avec des tenants et des
aboutissants imbriqués dans sa définition, prenons l’exemple d’une
« route à voitures », ce genre d’analyse et de projet est, on
le voit bien maintenant, voué à l’échec. Tout ce qui a été considéré
comme secondaire ou marginal au but central ne cesse d’accumuler – et de
poser problème, de devenir LE problème.
De poser problème, surtout pour nous. La route, elle est clé, elle
concentre l’accumulation de problèmes, elle est surtout une axe
d’évolution rapide, où l’aptitude (« la survie du plus apte »)
compte réellement pour quelque chose. On ne sait ni comment ni
pourquoi, exactement, mais on sait que les fourmis choisissent de se
mettre dans les fissures au bord non-route du trottoir, par exemple.
Pour elles, cela évite de se faire écraser et cela donne l’accès aux
deux côtés, aux surfaces des deux côtés de leur autoroute à elles. Il y a
quelque chose de hypnotique à voir ces rubans d’apparence tressée,
composées de milliers d’individus qui courent, la moitié à la verticale,
sur les murs, et avec aplomb.
Mais c’est peut-être pour une raison tout autre, et plus fondamentale
encore, qu’elles ont choisi le trottoir, côté maisons. C’est à cause de
la gestion de l’eau – de l’humidité. La route est construite de telle
manière qu’elle est supposée étanche, depuis le début du dix-neuvième
siècle. L’eau de ruissellement pénètre dans les fissures au bord de la
partie imperméable et c’est donc là que tout devient possible, niveau
« vie », d’autant plus qu’il y a l’abri au sec, sous la route,
tant recherché par les insectes. Ils se sont placées à la frange, à
l’interface entre ces deux mondes, le seul accident de terrain qui
compte, dans un écosystème route.
Les fourmilions (environ 2000 espèces d’insecte dans la famille
névroptère des Myrméléontidés) donnent la contre-partie – de toute
apparence, ils acceptent le risque et se distribuent là où ils peuvent,
étant sédentaires, et s’il y a beaucoup de trafic, ils vont, fatalement,
on pourrait dire, ceux qui survivent, se trouver plutôt aux bords du
chemin, c’est la mérite d’être marginal. Si c’est elles qui sont là et
pas quelqu’un d’autre, c’est que leurs trous donnent quand même un peu
de protection contre la compaction des pas, et elles ont une source
prolifique de nourriture (les fourmis). Leur cycle de vie, dont l’état
larvaire ne fait qu’une partie, est rythmée aux cycles de pluie et de
beau temps.
Au bord du chemin, le détritus, le sable, les nombreux éclats de verre,
le kératine des milliards d’insectes brisées, le calcaire des escargots,
l’hémoglobine du sang, s’accumule avec chaque crissement de pneus, pour
devenir, grâce aux intervenants, terreau fertile, mobilisé, métabolisé.
La vie se construit au bord des chemins et donc des routes, qui ont
toujours été des broyeuses, des brasseuses de la vie et de la mort.
On peut voir que, en prônant une technique et pas une autre, pour
accepter les charges chaque fois plus imposantes de nos véhicules sur
nos routes, la technique du bitume et du calcaire zéro trente qu’est
devenue cette technologie, bref, cette création d’une monoculture de
fait a radicalement altéré l’« écosystème route », sans aucune
intention de le faire et avec des conséquences, pour l’équilibre de
cette vie des bords de route, tout à fait non-anticipées – ignorées ou
dépréciées par les décisionnaires.
L’écosystème « route », je le dis, sachant qu’aucune
reconnaissance officielle est accordée à ce concept, parce qu’elle n’est
pas assez « matérielle ».
Si la seule finalité d’une route était d’expédier des véhicules avec de
plus en plus de réussite, parce que de plus en plus efficaces, rapides
et sécurisés, entre point A et point B, si c’était celui-là, le seul but
de la route, elle serait comme elle est, on me dirait. Autrefois
c’était pareil, on n’avait pas les moyens d’aujourd’hui.
Eh bin ? On a les quantités. L’artificialisation des sols, c’est la
route. L’artificialisation des bords de route, d’autant plus. On dit
que l’on vit dans l’Anthropocène, parce que c’est l’anthropos – l’Homme,
qui a l’impact le plus dominant et durable sur la géologie – sur la
Terre – il est devenu une « force naturelle majeure ». Du
genre qu’on ne paye même pas les assurances pour ses dégâts
( ! ), ce qui relève de la déresponsabilisation collective,
par incohérence. « L’être humain est comme ça, n’y a rien à y
faire, … ».
Eh bin ? En termes physiques, c’est au bord de la route que se
trouvent la plupart des impacts des humains sur l’environnement. Dans la
mesure que l’on étend son rayon d’action, sa fréquence, sa vitesse, on
multiplie la magnitude des conséquences, des impacts, de ses actes.
Je parle au singulier, mais les routes, c’est un effort conscient de démultiplier ces actes.
L’objectif des routes, c’est de faciliter le distanciel. L’écosystème
« routes », existe parce que cette volonté démultiplicative
existe. Et chaque point sur ces routes, ces réseaux routiers, est moulé
autant par cette raison d’être que par sa réalité physique si
transitoire.
On n’a qu’à considérer la culture romaine – connue pour son usage de
béton et ses routes pavées et droites, toujours dans le but de
connecter, à des distances de plus en plus grandes, à des échelles de
plus en plus vastes, sa logistique de commande.
« Si la seule finalité d’une route était d’expédier des véhicules
avec de plus en plus de réussite, parce que de plus en plus efficaces,
rapides et sécurisés, [ … ] »
Je l’ai dit et je le répètes ici.
Parce que, très clairement, cela ne peut pas être le seul but. La
globalisation veut dire « ça ». Comme un intrus à la fête.
C’est une manière de dire que tout est multifactoriel, et qu’il faut en
tenir compte, lorsqu’on construit des infrastructures, surtout des
infrastructures qui entretiennent ou font émerger une
« monoculture ». On ne peut pas s’abstenir du débat, lorsqu’on
se trouve face à une monoculture meurtrière.
Je peux convertir cette idée en termes dites « physiques » ou
« concrètes » ou tangibles », avec des mots comme
« biomasse », des volumes, des statistiques – mais est-ce que
je dois vraiment le faire ? Est-ce que je n’ai pas déjà assez dit
pour que l’on voit qu’une petite chose, une bifurcation dans l’évolution
des fourmis qui les permet de choisir le trottoir, côté maisons, peut
permettre à la « biomasse » des fourmis de monter, par des
tonnes et des tonnes, et avoir son effet, également démesurée, sur
l’infrastructure dite « route » ? On m’a raconté qu’à
danser toute la nuit sur de la terre battue, une foule a baissé le
niveau de cette terre par dix centimètres. Essayez une fois de vous
placer près d’une route où passent des camions, allongés dans le sens de
la route. Vous sentirez la terre fléchir, à chaque passage, de chaque
essieu.
Ne ferais-je pas mieux d’étudier, de très près, les fourmis, si mon
objet était de comprendre le fonctionnement de l’écosystème
« route » ? Peut-être que oui, peut-être que non – les
fourmis, mais quoi en dire des bactéries, ou des virus (!) ou de toutes
les matières transportées, ou emportées, d’un lieu à autre, comme par
une rivière ? Que dire du vent ? La liste de candidats est
longue, aussi longue que la route, qui devient centrale à l’activité de
la biote. N’oublions pas que la route, c’est aussi « les
routes », là où des formes de vie ou de non-vie établissent un axe
de mouvement, il y en a d’autres qui le parcourent et les humains, avec
leurs œuvres routières, comme avec leurs chemins de fer et leurs canaux,
ouvrent ou créent d’autres écosystèmes, dont profitent d’autres formes
de vie.
Il y a enchevêtrement des cadres logiques d’analyse, et répercussions entre échelles, cela est clair.
Mais concentrons-nous sur les effets de l’humain. Heureusement, elles
sont concentrées auprès des routes – si elles étaient également
distribuées partout sur la terre, le défi serait d’autant plus grand,
mais dans l’occurrence, la proportion de débris dans les sous-strates
atteint des niveaux où il est possible de les miner – de les extraire.
La pollution que nous avons créée, nous avons toute possibilité de la
traiter, parce qu’elle est surtout aux bords des routes. Il est plus que
probable que des formes de vie, comme les fourmis, sont déjà en train
de faire ce sale boulot pour nous – pourquoi réinventer la roue ?
Traiter cette lisière comme un écosystème, c’est tout-à-fait logique.
Cela positivise l’affaire – on refait vivre, on assainit dans le but de
refaire vivre, avec toutes les réserves possible sur le sens de ce mot
« assainir ».
Et où se trouve la voiture, dans ce mixte de priorités ? J’ai envie
de dire « nulle part ». Ses atouts majeurs, telle qu’elles
sont conçues actuellement, deviennent, écologiquement parlant, ses
défauts principaux.
Elle va trop vite. Elle ignore tout sauf la destination. Elle ne fait
pas partie, au contraire, elle coupe à travers l’écosystème, alors
qu’avant, elle en était la force motrice, ce couloir de vie qui
s’appelle une chemin, une voie, avec deux lisières.
La route est un écosystème comme les autres
La faute, notre faute d’intelligence collective, jusqu’à là, a été de
considérer les écosystèmes comme des unités surfaciques,
non-vectorielles, alors que tout indique le contraire – les surfaces
s’étalent à partir des lignes – des trajets des êtres vivants – et rien
n’empêche les surfaces elles-mêmes de bouger, de s’étaler, de se
transposer d’un lieu à d'autres. Une réserve naturelle ne sert plus si
elle est débordée de tous les côtés par un sol artificialisé.
Pour cette raison on parle de « corridors », de couloirs
écologiques, qui permettent à se rejoindre aux îlots de biodiversité. On
analyse la migration des oiseaux sous l’optique des gîtes de passage
qui leur permettent de continuer ces rotations. Etc. Un exemple d’une
réserve de biodiversité, c’est le mangrove, un écosystème très riche,
très distinctive, qui protège les côtes de l’érosion.
A Toulouse, et dans d’autres villes, on essaie de récupérer les rives
des rivières pour la ripisylve – « l’ensemble des formations
boisées [ … ] qui se trouvent au bord des cours d’eau ». Ce sont,
après tout, des voies publiques écologiques, ces rubans de végétation
ininterrompus, au bord des flux d'eau. Dans un autre article ( textes des rives
), j’examine ces mêmes cours d’eau en tant que véritables routes
( thoroughfares - artères ) multifonctionnelles. Dans ce cas,
c’est le milieu, l’eau elle-même qui bouge, constamment – il n’existe
pas de plan d’eau – de l’eau qui stagne – sans qu’elle ait préalablement
bougé.
Que les rivières, marais, anciens bassins de captage des moulins d'eau
et autres milieux aquatiques ne soient pas un "ensemble d'écosystèmes à
défendre", dans toute leurs diversités et complexités, ... comment ne
pourraient-ils pas l'être, imbriquées comme ils le sont dans le paysage,
enveloppées dans leurs ripisylves ?
Une mégabassine, dans cette analyse, est un archaïsme. Il est là pour
"capter" des mêtres cubes d'eau, les enlever de tout dialogue avec le
milieu. Comme les tuyauteries qui les abbreuvent, ils contiennent de
l'eau morte.
Ce sont des véritables mètres cubes: la seule raison d'être de ces "conteneurs" est de contenir des volumes d'eau.
Sur un autre sujet, pas si anodyn, il y a la question de la production alimentaire - nourrir le monde
- pour lequel l'accès à l'eau devient LE sujet à penser, avant tout. On
parle de l'agroécologie. Mais c'est un peu comme le terme exploitant agricole,
ou "agroforestrie", une contradiction dans ses termes. Une autre
agriculture n'est pas possible, elle est à ce moment-là mal-nommée.
C'est du jardinage que ça traite, pas de la culture des champs mais de
la culture des petits espaces, pas nécessairement horizontaux, des
clairières, par exemple. On peut dire horticulture, si l'on veut (hortus=jardin) y mettre un mot en latin. Rien n'empêche, ..., mais pas agriculture, qui est une autre histoire.
Larzac est un bon causse parce que c'est comme s'il avait subi toutes
les affres du destin et il est encore là. Toutes ces interventions de
l'humain, en terre maigre et sèche, plein de cailloux. Et, dès qu'il y a
un creux, de la vie enrichie. Les routes à voiture sont austères,
droites, exposées aux éléments, dominent maintenant le paysage par leur
horizontalité.
C'est de la fin de l'agriculture que ça traite, dans ces terres à la
fois agricoles et jardinées. Plus de présence humaine ici produirait
plus de par-vents, plus d'humidité, plus de milieux de vie, y inclu
celui de l'eau à l'état liquide. Issue de notre ingéniosité, la vie est
dure gagnée sur le Larzac, depuis des siécles.
Pour cela qu'ici, c'est le paysage même qui nous donne des indices et
des prémonitions sur l'aridité et la garrigue qui nous attend, à
l'avenir, ailleurs en France métropolitaine. Si l'écologie est une
guerre, mieux vaut former les soldats écologiques dans ce terrain
d'entraînement que le laisser à la zone militaire, c'est une question de
vie et de mort !
Living Labs
... est une appellation officielle permettant l'opération d'"expériences
écologiques" exemptées du cadre réglementaire normatif, pour des
raisons de recherche et d'expérimentation. Cela permet l'étude, par
exemple, d'habitats jardinés par des jardiniers de passage, avec des
refuges de jardinage, analogues aux réfuges de montagne ou aux huttes de
chantier dans leur fonctionnalité.
La mobilité douce ainsi proposée permet de tester ces habitats
productifs adaptés à ces types de mouvement, à pied et à vélo. Une
infrastructure écologique est une infrastructure qui a un bilan positif,
écologiquement, et en particulier en termes de son bilan énergétique et
dépendance industrielle.
🖶
↑
↓
mercredi 7 juin 2023
Internet Invasif
On pourrait parler d'architecture du système, de l'équilibre de
pouvoirs, entre le citoyen et l'administration. Il y en a qui parlent de
la futilité de s'en prendre contre les décisionnaires, alors que
finalement, le système détermine bien plus que ses titulaires humains.
Ou bien, on peut commencer par aborder le caractère, la manière d'être
des associations, des institutions d'aujourd'hui, qui est plutôt
révélatrice d'une certaine malaise sociale.
Très peu de gens assistent volontairement à des réunions, des assemblées
générales, et de moins en moins. Pendant un temps, j'ai pensé diviser
les gens en types - ceux pour lesquels les réunions représentaient la
normalité, ceux pour lesquels ils représentaient l'insupportable.
On se retracte, des réunions physiques, le distanciel est moins intense, plus facile à supporter.
Ce n'est pas vrai!
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a délocalisation physique, une sorte
d'interventionnisme colonial, un régime de clés, de cadenas et de
clôtures, détenus par des ayants droits en distanciel. Il y a quelque
chose qui fait rigoler là-dedans, quand même - les gens communiquent
leurs codes par sms, pour fermer les lieux contre l'intrusion physique,
alors que, informatiquement, ce sera toujours le captage de codes qui
permettra l'ouverture des lieux. Le mystérieux malfaiteur, cambrioleur,
squatteur, ... est une espèce en voie d'extinction, il n'a que sa
présence physique pour se faire valoir, et ce n'est pas le suffisant.
Ceux qui ne sont présents que localement sont déscomptés.
artificialisation des sols
Quelle blague, cette histoire de zéro artificialisation des sols! La
réalité est une augmentation de l'artificialisation des sols. Ces abus
de langage nous laissent sans mots.
Plus loin, on se rendra compte que la mise en oeuvre de la "zéro
artificialisation des sols" rend plus facile, plus lisse, la
continuation de la destruction. Plus loin, on se rendra compte qu'à peu
près chaque critère de l'artificialisation des sols est une masquérade,
que les pavillons contiennent les dernières restes de la biodiversité,
que les friches, désignées pour être développées, sont les plus riches
niches de récrudescence de la vie, que les exotiques et les invasifs
sont les seuls créatures qui restent assez costaudes pour engendrer la
vie.
Vus sur la carte, donc, les seuls endroits qui donnent de l'espoir sont
devenus indétectables et invisibles, puisque déjà considérés
artificialisés.
carte topologique de notre déroute
Une autre manière de visualiser la nature de ce cataclysme, cette
frénésie de destruction, presque à notre insu, c'est de nous considérer
comme une espèce qui est en train de se fragmenter en plusieurs espèces,
par des simples mesures de rayon d'action physique.
Il y a, selon cette vision des choses, des espèces qui restent locales,
qui sortent très peu de l'habitat dans lequel elles sont physiquement
localisées. Ensuite il y a les inter-métropolitaines, les
internationales, les intercontinentales.
Chaque espèce forme des cercles de sociabilité qui ne se croisent guère,
surtout qu'en mouvement, elles sont contenues dans leurs bolides,
trains, cars, ... et que leurs instruments, supposément de
communications, en réalité limitent leurs communications à leurs seules
cercles de connaissances.
Le cadre naturel - l'environnement, a été complètement sous-estimé comme
facteur d'influence sur la composition de la sphère sociale, on s'en
est aperçu comme une limite du pouvoir, qu'une fois dépassé, ouvrirait
de nouvelles horizons, de nouvelles possibilités dans l'exercise de sa
volonté de puissance - par alliance ou attachement aux plus puissants -
ceux qui sont capables de "s'imposer" sur le maximum de strates de
l'écosphère.
Mais les interactions des plusieurs formes de vie sont déposées sur la
terre comme des strates d'interconnectivité qui permettent l'émergence
de formes stables - d'écosystèmes, qui ne sont autres que des systèmes
d'autorégulation efficaces, parce qu'elles déploient toutes les forces
présentes sur le terrain. En s'éloignant de cette autorégulation, on se
met à la place d'un dieu qui n'a jamais existé.
Historiquement - et encore dans plusieurs têtes aujourd'hui, le monde
est si manifestement une oeuvre d'une finesse magnifique qu'il lui faut
un grand ingénieur, ou architecte. Mais au contraire, c'est l'absence de
cette puissance suprème qui rend possible l'autocomposition telle qu'on
l'observe, l'absence d'un dessein, l'absence d'une maquette, l'absence
d'un système chiffré.
Qui profite le plus de cette éruption de modellisations - cette
artificialisation d'un écosystème libre ? Surtout les
architectes-paysagistes ! Ceux qui "savent", mais qui, en réalité, ne
savent rien. Le concept même d'artificialisation communique cet abandon
du savoir, puisqu'il fait naître son inverse, la terre laissée à "la
nature", où, cette fois-ci, l'on abandonne toute prise sur le sol. C'est
une politique de tout ou rien, nulle part est-ce que les êtres humains
trouvent leur place, sans s'y imposer, selon cette diagnostique.
Mais ce n'est pas les humains en général qui imposent, sinon les
architectes en particulier, ici et maintenant. C'est une guerre de
modèles, le modèle hierarchisé contre le modèle autoconstructeur. Nous
vivons dans une maquette d'architecte, c'est vrai, mais nous y faisons
quoi? Comme les autres animaux, on fait ce que l'on peut.
🖶
↑
↓
vendredi 2 juin 2023
Intercalaire
squelette de page !
- intercalaire
- précarité
- équilibre dynamique
Il y a des éléments de langage employés de nos jours qui n'avaient pas ces usages, lourds de sens, il y a quelques années.
A Montpellier, actuellement, où une bonne partie de la ville est en
chantier, l"urban blight" ( fr : "environnement urbain dégradé") afflige
de plus en plus de quartiers, laissant émerger, pendant quelques
années, des îlots de biodiversité dans l'abandon qui seront ensuite
détruits par les pelles mécaniques.
C'est le paradoxe. Pourquoi aspirer à un état figé (solid state) alors
que, de toute évidence, la vie en général, et sa vie en particulier, est
en constante évolution ? Pourquoi ne pas refaire vivre autrement ces
endroits inintéressants pour les propriétaires et les capitalistes
fonciers, même si ce n'est que pendant peu de temps ? Ce temps a la
mérite d'être "en amont", après tout.
En Angleterre, le mouvement de "Reclaim the Streets" (à partir des
années 1990 ) fait écho à cette envie de se réinvestir dans une vie
harmonieuse qui repart des recoins abandonnées par l'exploitation
financière et industrielle.
Tandis que la recherche de répit, produit du stress démographique, du
burnout, des tiraillements d'une vie "en ligne", paraît expliquer assez
largement le désir de repli, de paix, interne et externe, qui nous
saisit, mais qui contient une menace latente ... la fatigue de la vie,
l'abandon de l'autonomie, l'envie d'un cadre où on pense pour nous, ...
🖶
↑
↓
vendredi 2 juin 2023
café scientifique
Cafe Scientifique is a place where, for the price of a cup of coffee
or a glass of wine, anyone can come to explore the latest ideas in
science and technology. Meetings take place in cafes, bars, restaurants
and even theatres, but always outside a traditional academic context.
The first Cafes Scientifiques in the UK were held in Leeds in
1998. From there, cafes gradually spread across the country. Currently,
some seventy or so cafes (in the UK) meet regularly to hear scientists
or writers on science talk about their work and discuss it with diverse
audiences.
Cafe Scientifique is a forum for debating science issues, not a shop
window for science. We are committed to promoting engagement with
science and to making science accountable.
Source : café scientifique website
Je faisais partie de l'équipe de ces cafés, j'ai écrit les comptes
rendus de nos rencontres et j'ai assisté aux conférences des bars de la
science, à l'université de Lyon II, où l'établissement scientifique
français avait un tout autre point de vue, que l'on peut appeler "la
vulgarisation de la science", plutôt que sa mise en cause, qui perdure,
j'ose dire, jusqu'à aujourd'hui. Prenons les écrits sur ce site de
l'écowiki comme des tentatives d'auto-critique fidèles à l'esprit qui a
animé les premiers cafés ...
la théorie des catégories
les marges, les cellules, les alvéoles, les franges d’interférence, les
parois – osmotiques, perméables, semi-perméables, les marges, lisières
et ornières, les rives, ponts et tunnels
Si tous ces catégories ont un point en commun, c’est que ce sont des
visualisations conceptuelles ou analytiques du passage de l’information,
des « formes » qui créent les paramètres de l’écoulement de
l’information, de l’informatique.
Pour un « informaticien » qui travaille dans le numérique, les formes
sont des abstractions, l’ordinateur est un « multitool », c’est ce que
l’on appelle les logiciels qui créeront les formes et les structures –
les « catégories ».
Mais à un niveau plus profond, ce n’est pas nécessairement le cas, la
disponibilité d’un architecture physique économe en ressources, par
exemple un processeur qui a plusieurs circuits en parallèle, permettra
de traiter l’information visuelle en temps réel, parce qu’elle intègret
une architecture qui accommode la rapidité, tout comme le système
nerveux d'un poisson comme la truite.
Les limites (les paramètres) du système seront donc parfois
quantitatives, parfois structurelles, et en vérité, toujours un mélange
des deux.
Pour comprendre un système, il suffit d’en faire partie.
le modèle : fourmilière
C’est une hypothèse. La fourmi vaque à ses courses, ne connaissant
qu’une partie infime de l’ensemble informationnel, le nid dont elle fait
partie. Mais regardons le verre à moitié plein – elle est
rigoureusement dans un contexte de « need-to-know » - elle n’a
d’information que ce dont elle a momentanément besoin. Sa « mémoire »
n’existe, en grande partie, qu’en dehors d’elle-même, ce sont des traces
phéromonales codées, laissées par tous les fourmis qui passent. De
nouveau, cette information, linéaire l’on peut dire, se concentre
localement, n’est présent que localement, et de manière éphèmère.
C’est vraiment très efficace.
Chaque cerveau humain peut atteindre des sommets de conceptualisation,
par analogie, par allégorie, par des mots qui, comme dans la théorie des
catégories, ont une réalité mathématique et conceptuelle traitable, par
des équations.
Un humain, dans sa tête, peut tenter de faire un modèle du monde entier,
universel, peut comprendre, par analogie, « comment ça marche ». Il a
la tête pour ça.
On peut supposer qu’un fourmi « ne pense pas comme ça » - il n’a pas
l’appareil neuronal adapté à cette tâche, que l’on appelle, souvent, et à
tort, la pensée abstraite.
Il faut chercher cette capacité cognitive de la fourmi ailleurs, dans le
collectif. D’autant plus que ce raisonnement collectif est fait des «
raisonnements physiques » des parties constituantes, des actes de chaque
membre de l’ensemble, des tracées laissées par chaque membre de
l’ensemble, des seuils de détectabilité de ces tracées, de la
coïncidence dans l’espace-temps des membres de cette sororité. La fourmi
est l’une des « antennes » de la colonie, tout comme ses propres
antennes servent à l’informer. Les colonies sont des comptoirs dans
l’évolution chronologique et spatiale de l’espèce, à un autre niveau de
logique combinatoire.
La cohérence de l’ensemble, imbriqué dans son « environnement », est particulièrement forte, dans le cas des insectes sociales.
La cohérence de l’ensemble des humains s’explique à travers
l’internalisation marquée de ces mécanismes. Chaque individu de l’espèce
a sa « carte mentale ». La carte mentale peut s’extérioriser, devenant
une carte sur papier, ou sur un téléphone portable. Les concepts sont
donc communicables, le langage est l’un des codages qui rendent
possibles ces faits d’armes intellectuels, dans chacun des petits
ordinateurs que nous sommes.
On internalise les instructions, les modes d’emploi, les normes, les
étiquettes, … et on les extériorise, pour les internaliser, pour les
extérioriser, ...
Et souvent, comme les fourmis, on se laisse emporter par la pensée des autres, bercer
par notre certitude, notre foi dans la légitime idéologie d'une masse
culturelle, sans boussole, à part la loi du plus grand nombre, ...
🖶
↑
↓
jeudi 1 juin 2023
Récits Écologiques
« On a besoin d’un récit. »
De l’Eau jaillit le Feu est un film (2023) qui donne un récit, le
récit de la lutte contre les mégabassines et en particulier celui de
Sainte-Soline (département des Deux Sèvres) au bord du Marais Poitevin.
http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/index.php?id=4059&mode=film
https://www.youtube.com/watch?v=QwfI6FHOL7Y
est un documentaire sur le Newbury Bypass Protest (1996) en Angleterre.
En regardant les deux, côte-à-côte, on voit des subtiles différences,
mais aussi une forte similarité.
Et ici un autre documentaire sur Newbury, qui a l'air un peu plus chouette et authentique :
https://www.youtube.com/watch?v=-ScZN9z0U_Q
Cela vaut le coup de comparer les comportements et techniques dans ces
deux contextes de confrontation. Le film sur Newbury met en lumière la
gaieté, la créativité et les rigueurs qui peuvent accompagner la
désobéissance civile, dans ces luttes et occupations de terrain de
longue durée. Mais il met en évidence aussi un langage de corps, une
proximité, entre les policiers et les manifestants, très peu visibles
dans les luttes vénéneuses d’aujourd’hui en France. On peut l'expliquer
en disant qu'il y a eu changement de doctrine policière (maintenez la
distance!), mais ce n'est pas ça, à mon avis, et je prends pour témoin
les expressions sur les visages, dans ces films. ACAB? Avançons masqués?
On joue avec le feu, ou on fait feu ?
Le récit, si je ne me trompe pas, reste à peu près le même, c’est devenu
une formule. Dans un film, on choisit un personnage central, ou
quelques uns – des incarnations. A Newbury, c’était
« Swampy », un très jeune, très petit activiste qui passait
son temps dans des tunnels très étroits et inaccessibles, qui n’avait et
ne voulait aucune autorité. Je reconnais certains des autres
personnages, mais ce n’est pas ce qui intéresse, ce sont les scènes
collectives qui impressionnent. C’est en fait un journal populiste de
droite qui a choisi de mettre Swampy en avant, en accord rigolo avec les
manifestants, qui ne voulaient ni leader, ni porte-parole. La taille et
la corpulence de la classe dirigeante et des forces de l’ordre les a
tout simplement interdit l’accès à Swampy qu’ils demandaient.
A la ZAD de Notre Dame des Landes, on n’a pas voulu de chef non plus.
Tout le monde s’appelait Camille, pour rendre l’identification des
« malfaiteurs » plus problématique pour les forces « de
l’ordre ».
Mais les exigences de la propagande sont, à vrai dire, la raison d’être
de ces oppositions contre des mégaprojets. On peut citer Larzac et José
Bové (No Pasaran), qui, comme Daniel "Le Rouge", n'occupe plus du tout
la même position idéologique que jadis ... Mais à Nantes, vers 2012-13,
10 000 gens de la ZAD ont manifesté sous le slogan « ZAD
Partout », sans chefs et sans mots en -iste. Cette aspiration
consensensuelle ne s’est jamais convertie, pourtant, en un vrai
retissage de liens et d’actions au niveau local, partout. Cela reste à
faire.
Le bilan de ces techniques – de chercher de la pub pour un récit
emblématique qui va se transposer dans la sphère politique – est, pour
tout dire, épouvantable, surtout que la violence – le sang - est à
marchander pour rendre l’événement notable, aux yeux du média. Ce n’est
pas étonnant – si c'est cette finalité qui justifie les moyens.
Nous parlons de 50 ans de luttes, ici, qui, dans un contexte
catastrophique au niveau du climat et de la biodiversité, n’ont
aucunement réussi à augmenter l’opposition (auto)organisée contre l’état
industriel – qui l’ont plutôt fragmenté, cette opposition. C’est
peut-être à cause de cette recherche trop manifeste, par quelques
activistes de classe moyenne-supérieure qui essaient de faire foule,
visiblement marginaux et excentriques, qui démotive le peuple et désarme
l’écologie, laissant la voie royale aux solutions techniques. Et c'est à
cause de ce vide de propositions concrètes d’infrastructure
non-industrielle.
Pour changer, il faut du sang, paraît-il – il faut réagir contre le
système, sans pour autant en proposer un autre. De là, le besoin
d’événementiel et de vedettes, un peu comme pour un concert de rock, ou
un festival, dont les ZADs sont les héritières, avec les raves.
D’ailleurs, pourquoi n’existe-t-il plus, ou pas encore des circuits
écologiques de festivals écologiques ? Les rainbows ? C'est souvent
le camion qui a fait le gros du chemin.
Julien Le Guet, le « star » dans le documentaire De l’Eau jaillit le Feu,
nous à parlé dans le cinéma de l’Utopia, après la séance, par
viséo-conférence, d'une cave, au Marais Poitevin. Très particulière,
cette expérience, lui qui occupait, Mélanchonesque, l'entiéreté d'un
écran de projection, au ciné, et nous devant ...
Pour lui, l’une des clés du succès relatif de cette campagne contre les
mégabassines et leur agriculture industrielle, c’était tout simplement
de faire des réunions chaque semaine et aller sur les marchés pendant
quelques années, d'être dans le détail de ces interactions, pour arriver
à une équipe d’une douzaine à une trentaine de personnes en liaison
utile, montant à soixante en période d'activité intense. Il y avait
aussi le facteur d'un blog vidéo régulier, vu par plusieurs, qui a joué.
Mais 30,000 d'arrivants, c'était un ordre de grandeur qui dépassait la
logistique habituelle ...
On peut supposer que l’autre raison de fond pour le "succès", c’est que
la recette et le menu proposés ont été d’une conventionnalité profonde,
qui cochait toutes les cases d’un récit médiatique répété, dans diverses
actions, depuis cinquante ans.
Un autre récit
Peut-être le récit que nous avons envie d’entendre est un récit social
qui rend un autre monde possible. Mais de ce monde, nous n’en voulons
pas – ou nous ne voyons pas bien comment ça pourrait marcher, cela
génère des peurs.
Pour s’attaquer, donc, au problème du non-recevoir populaire, on
prescrit de l’homéopathie, on s’applique à saper notre croyance dans les
différents piliers du système industriel, les transports, l’usage de
l’eau, les pesticides, le plastique, sans oser proposer de vraies
infrastructures holistiques alternatives. On les appelle "monocultures",
alors que le monde moderne loue le choix, le consentiment, la
flexibilité ...
On devient des « défenseurs de la nature (dont nous faisons
partie) », ce qui évite d’aborder frontalement le besoin pressant
de changer de système. Le système, c'est une organisation hiérarchique,
n'est-ce pas ?
D'autres vérités : "L'apoliticisme, c'est l'idéologie du statu quo" et «
Les types qui se déclarent apolitiques, ce sont des réactionnaires,
fatalement. » Simone de Beauvoir, 1954. ( source:
resolez@lists.riseup.net https://mastodon.tetaneutral.net/@demoiselles
Et l’autre récit continue de faire défaut. Pas de système pour remplacer
le système. Cette situation ne peut qu'être transitoire, puisque la
sécheresse s'impose sur nous de plus en plus - mais comment
fait-on, sans rajouter au réchauffement ? Il n'y a pas assez de
bras pour remplacer les machines, à la campagne. Les activistes
écologiques risquent fort d’être oubliés, tellement ils n’ont pas abordé
la question. Pour nier le stigmate de la radicalité, ils se laissent
devancer par les politiciens conventionnels, mais dans ce cas, à quoi
cela sert, tout cet activisme ?
Qui d’entre eux n’a pas accès à une bagnole, un téléphone portable ou un
ordinateur branché sur internet ? Les fonctionnaires, l’équipe
légale, la gestion publicitaire, deviennent même l’épine dorsale de la
lutte. Ces grandes kermesses de l’écologie n’existeraient pas sans
industriel – on peut même dire que le déplacement du parc auto d’une
grande manifestation à la campagne coûte en général plus que l’œuvre à
laquelle il s’oppose. A l’Occupation de Newbury, c’était même l’un des
buts, de coûter cher, très cher, à l’état – mais les protestataires, ils
venaient de partout dans le pays, en minibus. Bien que sur place,
souvent de manière affichée, on soit dans les "petits gestes"
écologiques.
Logiquement, pour ne pas être en contradiction évidente avec ses idéaux,
on proposerait d’autres manières de se rassembler, mais il y a une
sorte d’inertie dans cette attraction au grand événement, d’envergure
nationale, ne serait-ce que pour répondre aux besoins des activistes de
ne pas se sentir tous seuls dans leur coin.
Julien le Guet a mentionné que l’ambition cet été est de lancer une
série de convois, composés de tracteurs et de vélos, venant de
différentes parties de la France, en convergence vers Paris. Il a même
suggéré que ce serait bien si le cinéma de l’Utopia installe des
toilettes sèches. Mais, et il est bien placé pour le savoir, ce n’est
pas cela qui compte, médiatiquement et politiquement. Ce qui compte,
c’est l’événement – et son incarnation médiatique. Jusqu'au point où,
dans la chaleur de l'action, on brûle du plastique !
Considérons maintenant pourquoi il est nécessaire, si ces luttes vont
servir à quelque chose, de créer l’infrastructure qui les permette de
faire boule de neige, partout, dans la durée – et rapidement, étant
donné le peu de temps qu’il nous reste pour changer, radicalement,
d'infrastructure, tous ensemble.
D’abord, si l’on veut que ces mouvements élargissent leur socle
populaire, il faut qu’ils soient accessibles à la majorité d’entre nous,
et pas aux seules minorités bénies de suffisamment d’argent pour faire
des centaines de kilomètres en voiture en se passant de revenu, où les
autres minorités suffisamment privilégiés pour avoir déjà un
pied-à-terre à la campagne - ou des amis qui en ont ... la deuxième
maison, la gîte saisonnière, ...
En réduisant les frais de l’entreprise, on la rend accessible à tous.
C’est intelligent, aussi, de ne pas jouer des contextes où l’argent
compte pour beaucoup – c’est justement la force majeure de l’état et de
l’industrie qui sera déterminante dans ce cas.
Non, si l’on est sérieux, on marche et on fait du vélo, mais on n’amène
pas de tracteurs. Sans transport motorisé, on réduit le rayon de chaque
action, on augmente la durée, on crée une continuité, plusieurs
mouvements, plusieurs actions qui se rejoignent, parsemés autour du
pays.
Dans le cas de la mégabassine, un exploitant agricole un peu
« anarchiste de droite » a décidé de mettre à disposition une
partie de ses terrains pour accueillir les activistes, selon Julien.
Avec un peu plus de continuité et de connectivité, il y aurait sans
doute beaucoup de propriétaires terrestres prêts à mettre leurs terrains
à disposition, mais pour cela il faudrait qu’ils soient en confiance
avec le mouvement. Comment générer cette fiabilité ?
Ici, le récit nécessaire est une visualisation pragmatique d’un réseau
d’accueil et d’orientation écologique, accessible à toute la population,
et pas juste à une petite minorité.
Le danger, si l’on reste dans une bulle d’activistes, est qu’il n’y aura
aucune légitimité démocratique à plus grande échelle. Lorsqu’on prêche
aux convertis, c’est les convertis qui votent, … Lorsqu’on prêche la
démocratie participative, il faut voir qui peut bien participer.
Julien le Guet a souligné le fait que son collectif n’était pas une
assoc. juste des gens, et qu’il n’y en avait pas besoin puisqu’il n’y
avait pas d’argent dans l’affaire. L’un des aspects de cette lutte est,
justement, de penser à ce que les autorités publiques inventent des
prétextes pour chercher le ou les « groupes de malfaiteurs »
qui peuvent être attaqués en justice. De là la sensibilité à cette
question associative, sans doute – mais est-ce vraiment la bonne
tactique ?
Il se peut que plusieurs des hypothèses avancées ici sont mal fondées,
mais elles sont basées sur une écoute attentive de ce qui est dit par
Julien et dans le documentaire, et on pourrait également dire que,
justement, le récit manque d’originalité à l'égard de sa force
propositionnelle - est-ce qu'il y en a, des propositions ?
Il faut suivre cette logique un peu plus loin. Normalement, si l’on
accepte la territorialisation de ces mouvements, l’un des actes
fondateurs serait de se baser sur des axes de mouvement régulières, de
créer une infrastructure fiable pour permettre à la population locale
d’y accéder. La voiture et les télécommunications, au contraire, mettent
un flou sur cet objectif.
Le fait d’imprimer son propre récit, sa propre culture, cette nouvelle
vision, devient important. On sait que les toilettes sèches, ce n’est
pas un sujet « sexy ». C’est pour cela qu’il faut faire
l’effort – une force de proposition par les actes, la création
d’infrastructure aussi généralisable que localisable – et vivable, il
faut le vivre, pour en parler, pour créer le récit il y a besoin
d'expérience du récit.
Quoi de plus simple que d’aménager des lieux où on fait pousser sa
propre nourriture, dans des jardins, sur son chemin ? C’est de l’or
vert qu’on parle ici. De la France des campagnes repeuplée. Des lieux
alternatifs existent, mais est-ce qu'ils sont accessibles, reliés,
stables ?
Dans les conférences sur la crise de l’eau qui ont précédé le film, on a
eu droit à des explications techniques du problème, reconnu comme
multidimmensionnel, sans pour autant entendre des propositions sociales
et politiques pour s’en sortir. Or, obliger les opposants à passer un
temps interminable à réfuter des arguments détaillés, c’est l’une des
tactiques classiques des industriels. L’autre étant la destruction ou
l’absence de contre-exemples, d’information et d’études
d’infrastructure, surtout infrastructure de voyage, alternative.
Mais, il faut les créer, les contre-exemples ! Le Marais Poitevin
est intéressant, dans le sens qu’il a été un environnement artificiel
ancien qui montrait une certaine réussite, un certain équilibre, autant
pour la biodiversité que pour les humains, un exemple
d’« artificialisation des sols » non-industrielle. Pour
devenir, actuellement, une instance de la destruction d’un
contre-exemple.
Dans cette situation, de résistance contre la destruction massive d'un
écosystème, il faut de la mobilité – la capacité de bouger, de passer du
temps sur place sans tuer la nature qu’on est censé protéger, de
concentrer ses forces là où il y en a besoin et au moindre coût. On a
des éléments, des ingrédients de ce menu, mais très peu coordonnés. Leur
rentrée dans le quotidien de plus qu’une petite minorité est
nécessaire. Cette pensée sur le transport, l’hébergement et le travail
utile, maillés sur tout le territoire, est, en bref, ce qui manque.
Julien le Guet a proposé que pour lui, il fallait des violents et des
non-violents, des conservateurs de la nature, des acteurs sociaux, des
gens de tous bords avec des idées de tous bords. Peut-être, pour lui,
c’est ce qu’il faut, pour la défense du marais.
Un melting pot et un endroit où les nouveaux peuvent se former. Mais
est-ce que l’on a vraiment le temps ? Cela laisse un vide
organisationnel qui permet aux associations les mieux constituées dans
ce petit monde d’activisme écologique de prendre la part dominante
réelle dans les stratégies suivies, des stratégies définies aussi par la
finalité de leur propre recrutement et « succès » compétitif.
Et tout cela sans aucune légitimité démocratique réelle, par rapport
aux enjeux, qui nous touchent à tous.
Dans la réalité, la démocratie participative constituante – la force de
proposition écologique, se constitue seulement lorsque cette
infrastructure, qui permet des déplacements sans essence, existe. Sinon,
les orgas, l'argent et les lobbies vont dominer l'affaire.
Sans ce déclic, il n’est pas étonnant que l’on se focalise sur la
défense des paradis naturels, des intérêts et des sentiments des gens
qui les habitent. Ce qui permet aux opposants de nous assigner le rôle
de « doux reveurs ». N’oublions pas que ceux qui ont tendance à
plus souffrir du changement climatique sont les pauvres et qu’ils
vivent, en général, en centre-ville et en périurbain. Il n’est pas
surprenant, pour autant, de voir qu’ils sont très peu investis dans les
questions écologiques du monde rural.
Le repeuplement écologique de la campagne devient un vrai sujet.
L’auto-constitution de corps délibératifs qui vaillent le nom, aussi. On
oppose souvent l’intérêt local à l’intérêt général, mais dans un pays
de deuxièmes résidences qui permettent aux riches de dominer la
campagne, ce sont ceux qui utilisent le plus le transport motorisé qui
décident pour tous. C'est en vélo que le peuple peut envisager de
réhabiter la campagne.
L’un des conférenciers a souligné que le droit des propriétaires était
très fort en France, mais il existe plusieurs possibilités, des baux,
des droits de métayage, de travail saisonnier et itinérant, qui peuvent
coexister dans ce cadre, sans parler des voies et places publiques et
biens d'état. En exploitant ce potentiel, on peut très bien envisager
une transformation du tourisme de consommation en tourisme de
production, de biens écologiques.
Ici des liens envers des pages qui décrivent ou recommandent ce genre d’infrastructure.
http://www.cv09.toile-libre.org
https://ecowiki.inecodyn.org
Peut-être vous en avez, des idées ou des pratiques infrastructurelles, à proposer :
inecodyn@singularity.fr ( infrastructure écologique dynamique )
🖶
↑
↓
vendredi 12 mai 2023
L’Agroécologie n’existe pas
Dans le futur, c’est ce que l’on dira – que l’agroécologie est un
oxymore, une contradiction dans ces termes agro -
« agriculture », la culture des champs, « écologie »
- ce qui rend possible notre existence sociale et physique.
L’échelle nécessaire, c’est celle du jardinage. Les champs sont tous
petits. Ils sont à vrai dire des des surfaces dédiées à la longue aux
pluriannuelles. Ces "champs" sont des vergers en devenir, avec des haies
et des arbustes. Ce ne sont pas des champs.
Le modèle écologique à suivre n’est tout simplement pas industriel. Il
n’y a pas de tracteurs ou de motoculteurs – le sol ne se retourne pas.
Il n’y a ni débroussailleuses, ni girobroyeuses, pas de tronçonneuses,
ni de faucheuses – il n’y a aucun outil majeur à fossile, ni à
électrique.
Il n’y a donc pas d’industrie verte, si par « industrie » on
se réfère à l’échelle industrielle, ni, par conséquence, de
développement industriel vert.
Cela n’existera pas, écologiquement parlant.
Si c’est ainsi, c’est parce que ce qui est écologique, c’est ce qui rend
l’avenir, l’avenir proche, vivable pour le vivant et que c’est le
vivant qui fait le travail. Ce n’est pas à travers la multiplication des
instruments infernaux de notre destruction mutuellement assurée que
nous allons survivre.
De même, pour ces travaux faramineuses, Dantesques, d’installation de
tramways, d’infrastructure lourde, de voies cyclables à côté des
autoroutes. L’investissement – le béton coulé, l’acier forgé, le bitume
et l’agrégat transporté en camion, les pelles mécaniques plus grandes
que des tanks, pour faire ces œuvres, ce travail est tout en amont. Le
retour sur investissement tout en aval. Et en plus, tout cet argent,
tous ces salaires renforcent l’intérêt des gens à faire ces boulots de
merde, donnent la préférence et le pouvoir au moins responsables et
éthiques d’entre nous – il les encourage, même.
Or, c’est maintenant qu’il nous faut cesser de creuser le trou dans
lequel nous nous trouvons, pas d’ici 5, 10 ou 20 ans. Nous devons cesser
de faire couler le béton, cesser de forger l’acier, cesser le transport
routier lourd et même léger, maintenant, et surtout pas en rajouter.
Si nous ne le faisons pas, la raison est toute simple. Le politicien qui
avance de telles politiques, qui prend de telles décisions, perdra à
coup sûr les élections. Ses électeurs, qui dépendent pour leur vie
quotidienne du travail dans le secteur industriel, ne voteront pas pour
être au chômage. Tout cet édifice, profondément égoïste, est étayée par
les syndicats, autant que par le patronat, par les services, les
hôpitaux curatifs et non pas préventifs, ... Nous avons une politique de
nous servir sur les dos des autres, d’utilisation de rapport de force,
d’ex-pouvoirs coloniaux.
Peu importe qu’il y a toujours pire – ce n’est pas en tirant sur les
super-riches que l’on masque la vénalité des classes moyennes, voir
populaires, dans les pays riches.
On parle beaucoup des lobbies, de l’FNSEA, de l’industrie chimique,
pharmaceutique, etc., et de leur influence décisive sur les
législateurs.
Ces lobbies et les élus qu’ils ont choisis et subornés à leurs
objectifs, ont crée une trame législative qui favorise massivement
l’industriel. Et comme dans n’importe quel rapport de force, favoriser
l’industriel peut s’accomplir en pénalisant, en défavorisant, en
ignorant le non-industriel. La réalité est un contexte législatif et
réglementaire qui rend presque impossible de pratiquer une vie
écologiquement consistante. Essayez-la. Vous allez voir. Sans voiture,
sans espoir de s'en sortir, à moins de vivre dans des endroits de
population dense et stressé.
Gare à celui qui ose rejeter ce système, sans moyens – il sera accusé de
parasitisme, il recevra mil encouragements à se trouver un boulot –
n’importe lequel, pour ne pas « dépendre des autres ». Quelle
blague ! Vent debout contre lui, un chauffeur de camion. Tuer le
vivant, cela rapporte encore.
Dans une économie de marché, les contraintes législatives sont si
draconiennes, si efficaces, que seulement des personnes de moyens
indépendants peuvent s’installer en cohérence écologique.
Ceux qui ont moins d'argent et qui doivent vraiment gagner leur vie de
leur propre production essaient de s’accommoder à la réalité
réglementaire et se trouvent obligés d’utiliser des tracteurs, d’avoir
des grands cheptels, de ne pas employer des gens, … et, chacun, d’avoir
une voiture qui crée une empreinte écologique super-négative.
Et le résultat, c’est que l’on n’y croit point à l’écologie – qui n’est visiblement que pour les riches et performants.
Ce qui n’est absolument pas cohérent – qui ne fait aucun sens.
Le mot « Transition » a été inventé pour cela – pour faire que
ce qui n’a aucun sens paraît en avoir un peu. « Sur la voie de,
... », « petit-à-petit, … »
Des gros mensonges.
Le déni, ce n'est pas le déni - c'est un mensonge. Et celui qui se ment,
il a besoin de croire que les autres, ils mentent aussi, de former des
coalitions de menteurs. Sans vérité, pas la peine de débattre. Pas la
peine de se parler, donc, ce n'est que de la mauvaise foi - ça va ?
🖶
↑
↓
?
Géopolitique du sol
Il paraît que le sens racinaire du mot géopolitique relève de
notre lien vital avec les reliefs et la géologie, la topographie de nos
milieux de vie. Alors que l'emploi courant de ce mot communique la
vision et l'hégémonie des grandes puissances mondiales.
Une géopolitique du sol prend le sous-strate de nos vies comme indice,
cumulatif, de tous nos efforts et absences, afin de mesurer
l'amélioration ou la détérioration de la qualité de nos sols. Par qualité
on communique la vitalité - la présence de la vie, dans le sol. Un
désert absolu, par exemple, c'est un sol sans vie parce que sans eau,
même l'air il est sec. Une garrigue ou un maquis, c'est une vie réduite.
Une savane, une vie adaptée à la sécheresse, les saisons. Chaque vie
grapille, s'assoiffe, se désaltère, motivée - animé.
Et cela à l'échelle du micro aussi bien que du macro.
Nous sommes à l'époque de la pensée systémique, écosystémique. - notre
démographie démultipliée dépasse la raison d'état. Ce n'est plus inter
national. Les alliances des ONGs et des intérêts, des lubies et des
éléphants blancs industriels, sont mondiaux.
Au niveau d'une métropole, les autorités locales s'étant bien saisies de
l'enjeu vital, on sectionne le cadastre par pourcentage de sols
"artificialisés" et naturels.
Et en ce faisant, on artificialise tout, en toute innocence.
La vie se construit à partir du plus petit, les photons, les atomes, les
molécules d'eau, la perspiration des gouttelettes sur une toile
d'araignée à l'aube. Le rayonnement solaire tape chaque volume, chaque
surface, ainsi pulse son énergie primaire pour se diversifier au ras du
sol.
La métropole impose son plan quinquennal, pour le bien et pour le mal,
son écosystème d'excès de vitesse, sur le tout, sur l'ensemble.
Les fractures dans le béton, les interstices entre les pavés, les
craquelures et ondulations des racines sapinaires, amateurs du goudron.
À eux seuls, ils représentent la surface cumulative la plus importante,
dans nos métropoles, tous en train d'essayer de se rattacher, vainement
dans la plupart des cas, de rétablir le courant, mais le jus se remet
dorénavant à l'échelle métropolitaine - ça s'allume, ça s'éteint, comme
un réverbère dans le désert, mais sur toute la surface, ensemble, en
masse.
La vie est déboussolée, elle s'adapte aux rythmes de la navette, aux
pulsations quotidiennes amplifiées, elle rentre en résonance,
épileptiquement, en spasme.
La ville dort, elle se réveille, partout pareil, des pointes de lumière
s'allument, des portables vrillent, des connexions étranges
s'établissent entre fuseaux horaires, des machines se mettent en branle,
un univers de vibrations, d'infrason assourdissant qui ne s'entend que
subliminalement mais qui se voit sur les visages tendus et difformes.
Le sol n'y est pour rien. Pour ne prendre qu'un exemple, allons dans les
pépinières situées aux bords des voies express à l'entrée des villes,
leurs oliviers en pots fièrement mis en évidence, hors sol, empaquetés
prêts à l'usage, livrés à l'instant en camion-grue, placés ci et là dans
des parcs et jardins, comme des plots d'appoint visuel, des plants,
expédiés à destination.
On dit souvent que les Utopistes, les irréalistes, ce sont les
soulèvements de la terre, mais la vraie Utopie, on la vit maintenant,
elle est industrielle, d'apparence, d'appareil, on la trouve là où les
arbres font cette danse macabre, au rythme des translations, des flux de
trafic, un grotesque simulacre.
🖶
↑
↓
dimanche 30 avril 2023
Watershed
Des mots clés
watershed (en) : bassin versant (fr)
Deux expressions qu'il faut connaître ...
Comme l'idée d'un fleuve, une rivière, une rigole à qui en accord des
droits, comme si c'étaient des humains - légaux, en plus. On ne rigole
plus, on incarne, notre exosquelette, notre environnement chaque fois
plus désarticulée, en articulations putatives.
Comme s'ils pouvaient avoir des sentiments, ces accidents de terrain,
qu'ils pouvaient être lèsés, ... on sent la tension propriétariale
monter, perplexe, ...
Qui sont les porteurs humains de cette autodéfense territoriale : ceux qui bougent avec les eaux, les fluviens ?
Un bassin versant, il n'est pas fixe, bien que géolocalisable, dynamique et évolutive dans l'axe du temps.
Cela déborde, la flaque s'étend, ce sont les nappes supérieures, les
bassins versants, collinaires, la nappe phréatique qui les soutend qui
se renfloue, ...
... mais voilà que l'artificialisation des nappes a lieu, par
l'abstraction et la réinjection, par le pompage, la rédistribution de
nappe en nappe, de bassin en mégabassine, de crue en étayage. Les
poissonariat s'imbibe d'oxygène jusqu'au dernier soupir, sa chance de
vie réglémentée, au robinet, du débit à la vanne.
''Des mots clés.''
🖶
↑
↓
?
Société Toxicomane
à retrouver !
co-respondants
🖶
↑
↓
samedi 24 février 2024
Agriculture
Memorandum destiné aux éditeurs France Inter
(initiative de mise en forme scientifique des équipes éditoriales de France Radio)
- • On ne nourrira pas le monde avec du bio
- • L’agriculture n’est pas du jardinage
- • Les acteurs du terrain (les agriculteurs) et les habitants
- • La main d’œuvre coûte trop cher
Etc.
Version lucide
- • On a d’abord à faire venir des intervenants qui disent autre chose
que ce que disent le FNSEA et la Confédération Paysanne – les lobbies
industriels
- • Il n’y a pas de conflit entre l’écologie et nourrir le monde
- • L’agriculture est du jardinage
- • Il faut avancer vers l’avenir – avec de la main d’œuvre humaine, sans machines motorisées
- • Il n’y a pas de monde paysan – ce monde est l’affaire de tout le monde, fait par et pour tous
Explication
L’écologie : le climat, la biodiversité, les biorégion, l’eau,
l’air, ce sont l’affaire de tous, le ménage des champs (l’agriculture),
des bois, des bassins versants, des eaux, des jardins, des airs (la
météorologie) ne sont que des manières de territorialiser l’affaire de
tous.
Tout ce beau monde, ce sont ce que France Inter fait passer pour
« le monde agricole ». Il faut arrêter de parler du monde
agricole, d’exploitants agricoles, d’agriculture industrielle de
production. La population de la France tourne autour de 67 millions, les
agriculteurs autour de la moitié d’un million, une personne sur 136.
Ils ne sont pas représentatifs de la population rurale et le monde rural
n’est pas représentatif de la France, non plus.
Le gros de la population rurale, ce sont des touristes, des maisons
dortoirs pour ceux qui travaillent, des endroits où on place des zones
artisanales, industrielles et commerciales, les résidences secondaires
qui restent vides, 9 mois sur 10, et des jardins d’ornement.
Ce qui fait que la campagne, le péri-urbain et la ville peuvent
comporter des habitats absolument identiques, à une échelle mineure.
Lorsqu’on regarde les chiffres, sur la vaste majorité du territoire, les
jardins potagers et productifs de biodiversité, les zones de maraîchage
en polyculture, c’est 1,5 % de la surface (SAU). Les jardins
domestiques échappent au calcul. Leur rendement annuel est supérieur,
par unité de surface, au rendement de l’agriculture industrielle, les
intrants see trouvent sur place (pas de transport), les apports en
énergie sont minimales (énergie humaine). Il y a souvent une
diversification de tâches entre plusieurs intervenants (couper le gazon,
éplucher les légumes, etc.).
Comment comparer ce modèle à celui de l’agriculteur ? Il faut le
comparer à chacune des tâches qui a été externalisé par l’agriculteur,
plus le travail de l’agriculteur.
Chaque intrant de l’exploitant agricole a été fait par quelqu’un
d’autre. En réalité, derrière chaque exploitant agricole il y a
plusieurs personnes et plusieurs hectares d’êtres vivants.
Derrière chaque jardinier, il y a une pelle. Sa production échappe à
l’économie monétaire, il la mange. Sa transformation échappe au fisc, il
la met en bocal et il la mange.
Son temps de « loisir », il le passe souvent au jardin, un
lieu également de sociabilité (la terrasse, sous la vigne). Il ne le
passe pas dans un lieu où il faut payer sa sociabilité et sa
consommation.
Au contraire, s’il travaille pour gagner de l’argent, c’est pour pouvoir passer plus de temps dans son jardin.
Il faut donc bien séparer les valeurs matérielles et humaines des
valeurs économiques financiarisées conventionnelles. L’analyse
macro-économique financière n’est qu’un sous-domaine de l’économie.
Le modèle de « travail humain manuel et consommation directe »
qui échappe au fisc et à l’argent, est un modèle matériellement très
productif et efficace, bien plus que le modèle industriel. Il est donc
un modèle non-industriel, mais au niveau macro-économique très
intéressant.
Puisque ce modèle non-industriel échappe, ou peut échapper, très
largement, au monde de la monnaie et de la commercialisation, il peut
favoriser de manière disproportionnée la partie de la population la plus
pauvre – il peut les encourager à aimer la vie humble.
Donc, dans un monde financiarisé, il réduit le rendement financier.
Si la campagne est un champs de bataille sociale, actuellement, c’est
que ce que l’on appelle l’agriculture s’est accaparé d’une bonne partie
des terres, détournant la majorité de la population de l’engagement avec
la terre, pour la diriger vers des activités qui dépendent du monde
financiarisé.
En séparant les domaines artificiellement, on tord la vérité écologique.
En parlant du transport, on ne parle pas des surfaces goudronnées et
pavées, des routes et des trottoirs, des parkings qui font l’espace
public, par exemple. De ces surfaces dépendent très largement les
exploitations agricoles. Ils en dépendent parce que par là viennent
leurs intrants.
En parlant d’agriculture, on ne parle pas de transport, ni de biorégion,
et cependant, comme l’agriculture industrielle et paysanne dépend,
vastement, des intrants qui viennent par la route et par tracteur,
l’empreinte bio-productive de l’agriculture est surtout à l’extérieure
de l’exploitation proprement dite. L’analyse s’applique aux lieux
culturels, comme aux musées, à Disneyland, au cinéma ou à l’internet.
Leur bilan écologique négatif vient surtout des communications, des
transports et des hébergements des visiteurs, et non pas de leurs
activités sur place. La réalité de la vie rurale est plus celle de la
dominance du tourisme et de la consommation qu’autre chose.
AI et Drones
Notons que l’idée supposé futuriste où les machines nous enlèvent encore
plus de travail « pénible » (physique), et où les drones,
dirigés par des intelligences artificielles, administrent les doses
d’adjuvants (insecticides) sans que l’on s’en occupe nous-mêmes, comme
s’ils faisaient part de l’arrière fond de la nature, …
… est encore hypothétique, les coûts industriels de la fabrication,
communication et motorisation de ces intelligences restent bien réels.
Le monde industriel et bien trop là. L’injection anthropique (par
l’humain) de végétaux, animaux, produits chimiques, métaux lourds,
poisons, terraforming, incompatibles avec la biodiversité, dont nous,
est connu de tous.
L’être humain, en soi, est relativement non-polluant, par rapport aux
intelligences artificielles. Il n’est peut-être pas nécessaire de le
faire consommer des produits faits avec des hydrocarbures fossiles.
L’amalgame dans l’analyse entre l’effet anthropique présent et l’humain,
en tant que tel, est incorrecte. La sociopathie collective est le
contexte présent anthropique.
Le Mensonge Total
- • La fabrique du doute
- • Du Greenwashing
- • Du traîner des pieds
- • Stagnation des émissions par 2030 (moins 40 % est le cible)
- • 80 % de la production Total reste fossile.
Le fait de centrer sur des accusations de greenwashing envers Total,
l’entreprise, peut être mis en contraste avec le l’absence de
contextualisation. Le mensonge total est collectif, dans son ambition.
Chacun, dans sa voiture, accepte ou se résigne à faire l’équivalent à
son échelle de Total, le géant.
Le mensonge est collectif, mais il n’est pas total. France Radio n’a
aucunement la mission d’une ligne éditoriale d’auto-censure, à cet
égard. Elle se déclare, d’ailleurs, résolument indépendante du
politique. Le contexte de l’analyse est donné par l’interviewer. Il peut
faire des mises en cause des chiffres et des présupposés des invités.
Sinon il devient lui-même complice dans le mensonge total.
Par rapport à la représentativité des jardiniers, …
En Angleterre, la réunion annuelle des jardiniers remplace la réunion
annuelle des agriculteurs, le salon de l’Agriculture, en importance
politique. Le monde paysan est plutôt remplacé par le monde de
jardiniers. Le jardin anglais est bien moins rectiligne et dénaturé que
le jardin français, en général.
Il est important de ne pas faire d’amalgame. L’agriculture ne représente
pas la campagne. L’élite urbaine domine très largement la campagne,
aujourd’hui. Elle habite les deux mondes, grâce au réseau de transport
routier et de communications à distance, grâce aux des effets
transgénérationnels.
Parler des secteurs du tourisme ou de la culture, sans parler des flux
routiers et logistiques qui les accompagnent, n’a pas de sens. Selon
cette analyse, l’empreinte carbone des parcs et réserves naturels, par
tête de population présente, est bien le pire. Il est pressant de
changer de paradigme, vers un tourisme de production écologique plutôt
que de consommation (destruction) écologique.
La campagne, la majorité de la surface de la France, est donc bien plus
industrialisée, en termes de ressources déployées par tête de population
présente, que la ville.
C’est une vérité qui échappe très largement à une trame d’analyse qui
met les écologistes avec la nature et l’agriculture avec l’économie
réelle. La polarisation qui nous touche à nous tous, dans nos vies,
c’est celle entre le monde du vivant et le monde anthropisé version
présente. Les deux ont tout-à-fait l’air d’être incompatibles.
🖶
↑
↓
lundi 18 décembre 2023
démystification
Le premier pas envers la reprise du pouvoir décisionnaire populaire,
c’est de créer une expertise générale – que tout le monde devienne «
expert ». Les lobbies industriels doivent cesser d’exercer leur pouvoir
arbitraire.
Les pouvoirs publics ne veulent pas ça, pour des raisons évidentes. Le
peu de pouvoir qu’ils exercent, la main posée sur la manivelle, ils
l’exercent à travers ces lobbies, la seule courroie de transmission
disponible. C’est le problème, établir d’autres flux, d’autres systèmes
capillaires, mais pour cela il faut faire face à ce monde industriel,
qui élimine la concurrence pour éviter de changer, lui. C’est la
non-neutralité de ce problème qui mène, tout naturellement, à la
compétition systémique.
Il nous faut proposer une solution systémique. Face à une monoculture,
celle des routes à voiture, il faut savoir en créer une alternative.
J’ose dire que c’est tout simplement une question d’échelle, de taille
et de temps. À hauteur d’homme, ou de « poids lourd » ? Nous ou les
dinosaures ?
C’est peut-être un peu libertaire, ce que je vais dire, mais ce n’est
qu’un élément – ceux qui valorisent la liberté, valorisent la liberté
décisionnaire de chacun. À hauteur d’homme, cela veut dire cela. L’être
humain, comme espèce, a sa taille, a son rayon et son rayonnement, sa
temporalité, des caractéristiques qui ont évolué dans et par rapport à
la nature qui l’engrène. On n’est pas de la taille d’un éléphant, on est
plutôt gracile.
La question est très démocratique, cette liberté d’interaction, cette
immersion humaine dans le monde, c’est une hygiène de vie, une «
thérapie » cognitive. L’artificialisation de nos vies – de notre
expérience d’être en vie, est à mettre en cause, comme source du mal
écologique. Les routes laides, éternelles, toujours les mêmes, les
sentiers humains inaccessibles, incertains, tout ce qui nous conduit
envers la soumission industrielle, dans sa dimension « échelle », est à
mettre en cause.
Actuellement, on n’ose pas le confronter, par peur d’être accusé d’être
anti-humain, irréaliste, par rapport aux normes sociales existantes. Or,
être humain consiste en être hostile à la déshumanisation, il me
semble. La tribu des quatre quatre se parade, comme si à elle seule,
elle représentait l’esprit populaire, « la vraie culture », dont les
excès identitaires débordent actuellement.
Comme des parades de blindés devant le Kremlin, des démonstrations de puissance véhiculée.
À hauteur d’homme, c’est une question de revalorisation de l’humain,
devant une culture qui nous déshumanise. C’est une question de taille
plutôt que d’hubris. On se trouve face à une autre culture, de ceux qui
ne se sentent vraiment humains que lorsqu’ils sont branchés à leurs
machines, c’est une question de familiarité. Et au niveau personnel, on
n’a peut-être pas trop envie de baigner dans une atmosphère de canicule,
on préfère son Jeep air-conditionné. Liberté de suicide collective,
dans l’occurrence.
La question de faire renaître nos interactions sensées avec la nature
n’a jamais été aussi brûlante. J’ai le sentiment de ne dire que ce que
nous avons tous derrière la tête. Il y a, une sorte de nervosité, de
peur de mettre ces idées en relief, comme si on avait peur d’être
déclaré « déloyal » au système présent, tout en l’étant, de plus en
plus, c’est énorme. Le système industriel s’est accaparé de 90 % du
vivant, de la biosphère, toute la biodiversité est compactée dans le
dernier 10 %, le dernier kilomètre, personne n’ose lancer le défi à ce
qui les nourrit, les aspirations, tout,commeune article de foi.
jeudi 21 décembre 2023
Vraie mobilité rurale
J’ai oublié, dans mon élan de dégoût du système actuel, de décrire mon
idée du genre de système de transport rural qui pourrait ré-insuffler la
vie à la campagne (quand je dis campagne, vous pouvez lire « le gros de
la surface encore vivante », « campagne », c’est plus court), remplir
les cases de l’écologie socialisée, bio-compatible. La vie c’est le
vivant, le vivant qui a toujours existé, comme possibilité, qui est
devenu un mot courant dans la dernière décennie. Ce qui vit. Il ne
suffit plus d’un nom abstrait – La Vie – il faut un mot qui communique
la continuité de cette vie, encore vivante, précieuse. Nous sommes tous
des vieux qui fuient la mort, c’est improbable, elle est devant nous.
Donc je rajoute cette annexe à mon esquisse caricaturale de la journée de la mobilité lozérienne.
Désabusé j’ai été, de constater qu’il n’y aurait aucune opportunité pour
les présenter dans le cadre de la journée. Que j’entendrais les vœux
pieux des facilitateurs sur « l’intelligence collective », que je
m’insurgerais chaque fois plus en voyant ce système si efficace de
manipulation de groupes pour éliminer la raison, pour éliminer
l’inventivité. L’argent fait ça, il réduit des questions pratiques à des
options d’achat, il sectionne notre cognition de la terre.
jeudi 28 décembre 2023
mobilité vive
faire vivre le mouvement
Que faut-il ?
Des gîtes de passage, de l’hébergement, de la restauration, des lieux de
stockage, des travaux physiques, dans le potager, dans la récupération,
cueillette et transport de produits locaux, dans leur transformation,
une véritable infrastructure locale à l’échelle humaine.
Les marchés hebdomadaires sont la clé de voûte de ce système alternatif,
ils rythment le quotidien, permettent d’établir des circuits, d’éviter
les allers-retours. Dans ce système, s’il faut subventionner quelque
chose, c’est le transport sans voiture. L’anomalie est là – un système
sans transport motorisé coûte beaucoup, beaucoup moins cher que le
système actuel. Cette réduction des « frais d’entreprise individuelle »
met en question la viabilité du modèle industriel. Elle met en question
les fondements du système. Si une personne peut bien vivre, en cultivant
des légumes, sans voiture, elle a besoin d’être moins payée, parce
qu’elle consomme bien moins d’énergie pour réaliser ses fins.
La politique, l’encadrement politique et administratif de nos vies, à la
campagne, se dresse contre cette possibilité, c’est l’équivalent d’un
effondrement du PIB, une perte de poids à l’international dramatique,
une terra incognita qui donne le vertige.
Mais si l’on prend ce pas vers l’avenir possible, on n’arrête pas
d’acheter les légumes du coin, ni de les faire pousser de par ses
propres efforts. On rétablit les circuits courts. À vrai dire, et ceci
depuis un certain moment, qui se mesure en décennies, le seul mérite du
financement central étatique, de par nos impôts, c’est que cette
dividende nous a permis d’acheter des voitures et de rouler. Mais si
cela passe de mode, on reste avec des milliers de tonnes de véhicules
rouillés sur les mains, qui ne servent à moins que rien.
J’explique ainsi la tour de cartes que nous avons construite, et qui
risque maintenant de s’écrouler sur elle-même. De cette manière, on peut
mieux apprécier les enjeux, la trouille que peut sentir tout employé,
tout fonctionnaire, à voir disparaître son boulot. De se trouver dehors,
dans le froid. De se trouver mal à l’aise, en manque de confiance, face
au milieu naturel.
On s’emmure. On s’amalgame avec les machines qui font notre joie, qui
nous défendent, qui nous isolent du mal. On collabore avec le système
qui détruit son identité et son amour propre.
On s’attaque aux donneurs d’espoir, d’alternatifs, comme des mauvaises
herbes, des erratiques. Ayons tort, tous ensemble ! Ne montrons pas de
failles ! À vrai dire, on ne peut pas agir autrement, soutenir son
destin c’est un acte, sans cesse, d’élagage, comme une faucheuse de bord
de route. Le système industriel est fait pour s’imposer, pour intolérer
la moindre différence.
Jusqu’à là, on a résolu le problème d’échelles en tuant tout ce qui
n’était pas à l’échelle industrielle. Microbiote, insectes, virus, tout.
Pas compliqué. D’ailleurs, nos machines s’occupent du compliqué et du
casse-tête, pour nous, quel soulagement !
Mon idée serait déjà de ne plus faire cela. Ou bien, de faire autrement
et de propager le phénomène. Lorsque les écologues se montrent
optimistes, alors que beaucoup d’entre nous pensent que tout est foutu,
c’est parce qu’ils connaissent le vivant. Dans des conditions propices,
le vivant se multiplie, mais très rapidement, bien plus rapidement que
l’industriel en est capable. Les friches industrielles, les orties et
les ronces en sont les témoins actifs. Ils font revivre ces endroits
avec leurs salaires.
C’est un feu vert pour nous, le feu rouge, le canicule, il devrait nous communiquer le sens interdit.
Et c’est pour cela que la pensée écologique sociale est une pensée
d’avenir, là où la stérilité du débat industriel s’auto-combustionne et
s’étouffe. Les écologistes ne sont pas optimistes, sinon clairvoyants,
ils voient de possibles jours heureux, là où l’industriel s’entête à
réconcilier l’irréconciliable. La science est « optimiste » parce
qu’elle devient de plus en plus bio-orientée, non-industrielle,
spécifique et ciblée sur des problèmes d’ensembles du vivant, dont nous.
Cette révolution idéologique se manifeste dans les milieux
intellectualisés, en contraste forte avec la pensée dite populaire,
instrumentalisée par des démagogues. Je ne peux m’empêcher de penser que
la force des idées vaincra, et que le monde industriel est en train de
se briser devant nos yeux, que nous sommes témoins de ses ébats
auto-destructeurs, de sa sévérance forcée de toxicomane. Une société
devient très toxique elle-même, à ces époques d’ajustement inévitable,
où le foie fonctionne mal et la bile s’injecte dans le sang. Cela nous
chamboule.
Problème de granularité
« Est-ce que l’échelle de la France est la bonne échelle pour traiter du problème migratoire ? »
La subsidiarité.
La Communauté de Communes.
Le département.
La région.
« Respecter les normes environnementaux. » « Concurrence déloyale. »
La démocratie représentative, où l’on vote périodiquement pour mettre en
place des décisionnaires à plus grande échelle, conduit à un
renoncement dans la vie de tous les jours à la participation aux
décisions organisationnelles. Cela conduit à son tour à une anarchie de
fait, une abstention du collectif, une intelligence collective de l’art
du déni, de l’extranéité qui lui-même s’abstient de tout ce qui ne
relève pas de sa responsabilité spécifique.
Les villes lentes, le lo-tech, l’anti-techno-solutionnisme, la relocalisation.
J’essaie d’énumérer quelques-uns des sujets dont on parle aujourd’hui.
D’autres sujets « catégoriels » comblent l’ordre du jour médiatique; les
femmes, les questions identitaires, les plages horaires se remplissent,
la fourmilière inter-communicative fourmille, fructueusement.
Mais en réalité, ce ne sont pas du tout des problématiques d’actualité,
mais d’époque. On les approche par le mauvais bout en partant des faits
divers -il y a besoin d’analystes relativement distants de la politique
politicienne, mais comment passer dans la zone de décontamination ? Qui
habite encore les tours d'ivoire ?
Ce que l’on voit, il me semble, est une réorientation des sujets
d’importance, une quête parfois sincère du sens de la vie de chacun.
Plusieurs des questions posées n’existaient même pas dans la tête de la
plupart d’entre nous, il y a, mettons, un siècle. La société était
ségrégué, entre ceux qui s’occupaient de ces questions d’élite, et ceux
qui s’occupaient de leur quotidien. Et entre temps, on est redevenu
populaire.
Aujourd’hui, les gens sentent qu’ils peuvent constituer des corps
décisionnaires ad hoc, menaçant les trames de pouvoir hiérarchiques. Les
questions identitaires sont donc des questions d’assemblage : comment
constitue-t-on des corps décisionnaires, des lobbies qui vaillent ?
Si j’ai titré cette section « Problème de granularité », c’est parce que
cette question d’échelle et d’éléments constitutifs des corps
décisionnaires n’a pas de réponse unique, sinon combinatoire. On le
voit, par exemple, dans la constitution de « groupes parlementaires »
dans le parlement européen. Des nationalistes, l’extrême droite, se
constituent un pouvoir central, dans le but de l’autonomie à de toutes
autres échelles, théoriquement, à l’instar d’un Trump dans un système
d’états unis désunis.
Ces politiciens d’extrême droite avanceront l’argument qu’ils ne le font
que par pragmatisme. Constatant l’existence et la puissance de ces
corps supra-nationaux, démographiquement immenses, ils essayeront de
s’en accaparer pour mieux s’en libérer. Il reste qu’en ce faisant, il
est observable qu’ils trouveront des alliés et des liens plus forts,
peut-être, au niveau international qu’avec leurs propres nationaux,
idéologiquement opposés. Comment se divise-t-on, dans ce cas, si ce
n’est pas entre caïds et meneurs de clans, basées sur une sorte de
primogéniture ancestrale ?
La soi-disante préférence nationale est elle-même pleine d’hypocrisie.
J’ai entendu à la radio qu’une bonne partie des naissances en France
viennent de couples où au moins l’un des partenaires est d’origine
étrangère – c’était la formule d’usage. Je suppose que d’entre ces
couples, ils se trouveront pas mal de députés et de journalistes –
logique – puisqu’ils et elles se fréquentent. Cela ne date pas d’hier.
La royauté et sa retenue, en Europe, est européenne, depuis toujours on
choisit de fomenter des alliances, entre pays, par des mariages qui
arrivent à la consanguinité supra-nationale.
Par rapport à l’écologie, on voit que l’ordre du jour se dirige vers le
localisme, pâle reflet du monde étiré par les super-riches. Mais le
monde physique nous donne des leçons objectives. Elle fonctionne,
objectivement, à plusieurs échelles interactives à la fois, et les
différentes échelles s’enchevêtrent. Ce métaphore de la granularité a
donc des limites, parce que plus près de l’entropie d’une plage que de
la complexité d’une forêt.
Le monde des super-puissances géopolitiques, gonflés par cette ambition
abracadabrantesque du centralisme cru, est encore plus éloignée de la
délicate interface entre l’échelle des forêts statiques et, par exemple,
la transmigration rythmée des oiseaux qui effleurent sans endommager,
en enrichissant ce monde plastique à leur commande qui toujours les
échappe.
Le modèle localiste manque de sens, si l’on n’accommode pas ces grands
voyageurs, ces migrateurs à toute échelle, comme les oiseaux et les
virus, sinon c’est fatalement leur rythme qui finira par s’imposer sur
nous. Dans les océans et dans n’importe quel corps d’eau, c’est la
relation dynamique qui prédomine aussi, ce qui met en doute la
pertinence de la territorialité, du « territoire », (dans l’océan, un «
territoire » peut être un courant) comme unité de base. Cela conduit à
la renaissance du concept « peuple », qu’il soit ou non géographiquement
auto-identifié, qu’il ait ou non un sens racinaire.
Et cependant, l’intelligence de l’oiseau, d’un rapace ou d’un corbeau,
est territoriale : il est « géographe », par excellence, et il étudie et
il suit, attentivement, dans son étude, les traces et les
fréquentations humaines.
Mais comment faire, dans un monde sans frontières ? Peut-être que la
réponse est devant nos yeux, mais que personne n’est si aveugle que
celui qui ne veut pas voir.
Osmose
L’osmose, ce processus qui permet de trier et de niveler, à travers les
frontières, les périmètres, plus précisément, donne une bonne partie de
la réponse. Ici une définition et un lien :
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-osmose-5766/
L'osmose est le passage de molécules de solvant, en général de l'eau,
à travers une membrane semi-perméable, depuis le milieu le moins
concentré (hypotonique) en solutés vers celui le plus concentré
(hypertonique).
Ce phénomène s'arrête lorsque les deux liquides séparés par la membrane
ont atteint la même concentration. On parle alors de milieux
isotoniques. La pression hydrostatique due à la différence de hauteur
d'eau entre ces deux milieux compense alors la pression osmotique
Ce qui est intéressant dans cet exemple, pour moi au moins, c’est que
c’est un processus autorégulateur, multifactoriel. La « membrane » est
semi-perméable. Ni imperméable, ni totalement perméable, elle
discrimine, une forme de boucle retro-active. Quel être vit sans eau ?
Les agents qui déterminent sa perméabilité sont ceux qui la pénètrent,
c’est leur densité dans le milieu, leur distribution, qui est
déterminante. Je lance le défi à quiconque de désigner une forme de vie
qui est ou totalement perméable ou totalement imperméable. Donc, je
défis à quiconque défend le concept que l’intelligence, au singulier ou
au collectif, peu importe, puisse être un processus de commandes d’en
haut, plutôt qu’un assemblage bien transitoire de ses parties
constituantes, forcément du bas vers le haut, forcément interactif.
Ceci, en guise de bon vieux argumentaire de doxa médiéval.
Les super-organismes appelés « états » ou états nations, etc., avec
leurs frontières, créent des interruptions de flux « osmotiques » du
demos. Je pense à des exemples comme la Mayotte, dans les Îles Comores,
qui illustre bien, il me semble, ces phénomènes « artificiels » qui
distendent l’espace-temps local, créant le chaos dans la distribution
locale de richesse, pour des enjeux d’entretien de comptoirs par des
puissances non-locales.
La dématérialisation du « nous » commence là. La guerre ukrano-russe est
un autre exemple. On vient de voir Poutine démontrer son pouvoir de
nuisance sur tout le territoire ukrainien, en lançant une salve de 150
missiles, montrant beaucoup de tact en choisissant une date
intermédiaire entre le noël européen et le noël russe, et peu de morts.
L’un de ces engins qui a franchi l’espace aérien de l’OTAN en Pologne,
pour ensuite atteindre son but en Ukraine. Une menace codée et finement
jugée, purement symbolique.
Pourquoi fait-il cela ? Nos journalistes sur ménagés et hyper-actifs
ont, comme d’habitude, raté l’analyse intelligente et mesurée, préférant
une sorte de code morse populiste. Ils se sont concentré sur l’effet
plutôt négatif pour Poutine d’augmenter la rage et la haine des
ukrainiens, en ignorant la méta-analyse du « pourquoi donc fait-il cela ?
».
Je donnerai une réponse articulée, non pas sous-jacente ou dans le
non-dit. Dans le non-dit, tout est dit, aujourd’hui. Dans le reportage
que j’ai entendu tout-à-l’heure, on a dit que le Royaume Uni envoie 200
missiles anti-aériens à l’Ukraine, immédiatement. En ce disant, on a
non-dit que cela nous en fait 200 de moins pour nous protéger
nous-mêmes.
Dans d’autres reportages, échelonnés dans le temps récent, on a expliqué
à la va vite que les pays européens n’étaient pas encore en pied de
guerre, c’est-à-dire, qu’ils ne s’étaient pas encore décidés à prioriser
et investir massivement dans la production d’armements, surtout de
munitions, ils hésitaient encore. La Hongrie bloque l’aide collective
européenne à l’effort de guerre en Ukraine, ce qui aide à perpétuer ce
non-effort-de-guerre collectif, merci Hongrie, pour encaisser et dévier
le regard.
Les républicains, aux États Unis, ont bloqué la tranche d’aide militaire
de plusieurs milliards d’euros qui était anticipé. Merci, les
républicains, pour l’avoir dit, pour laisser le gouvernement dans la
position confortable du non-dit. Les ukrainiens manquent de combattants,
étant donné qu’ils en perdent plus avec moins de super-armes et en
maigres rations de munitions. Pas de feux d’artifice pour eux, en tous
cas, cette année, ce serait du gaspillage. Flux tendus au point de
rupture, peut-on vraiment demander aux européens de rentrer
personnellement en guerre avec la Russie ? Et pourquoi, finalement ?
Et les journalistes, ils ont présenté tout cela comme un roman
graphique, à la va vite, un copié-collé digne de Chat-GPT, de questions
de politique interne, de puérilité politicienne, de faux amis
est-européens. Pour les intellectuels, le sous-texte, pour les ploucs,
la version bande dessinée. Notre langue est trouée, notre leadership
aussi, par des non-dits et des non-chefs, prêt à abdiquer toute
responsabilité pour l’articulation de cet état d’affaires.
L’Occident (plus ses comptoirs – l’Israël, l’Australie, etc.) :
« Poutine joue-t-il loyal ? Pas du tout. » Mais la conversation est
plutôt celle-ci. « Veux-tu que nous nous fâchions vraiment, que nous
nous mettions en pied de guerre, au risque d’une profonde
déconcentration sur le délicat équilibre de nos affaires internes et
hégémoniques ? Nous n’avons pas encore pris ce pas. On peut arriver à un
compromis, nous pouvons encore te sauver la face. »
Poutine :
« Voulez-vous reconnaître une fois pour toutes que l’abandon de la
Crimée, notre base d’ouverture au monde sudiste, immémoriale et
historique, et l’absorption de notre proche étranger, voir notre « Tibet
», l’Ukraine, par vous, ne nous sont et ne seront jamais acceptables.
Plus vous réussissez à saper notre position de pouvoir régional régnant,
dans ce sphère frontal, plus nous serons obligés à vous emmerder,
n’ayant pas l’intention de nous prosterner devant vos faits accomplis. »
Nous parlons « Poutine » comme un mantra, c’est tellement bête. De la
pure propagande, étant donné que même ses opposants, en trouvant le
pouvoir, auraient les mêmes fondamentaux stratégiques en tête.
Poutine est en train de nous dire : « laissez-nous libres, soyez loyaux,
ça suffit, à la longue. » C’est le même message codé que celui des
palestiniens, « nous vous faisons, en version courte, ce que vous nous
faites subir depuis des décennies. Comprenez que ça suffit – vous êtes
démasqués par nos atrocités. »
Nos comptoirs sont aussi nos cauchemars, revenus nous hanter après tant
d’années. Il y a une once d’humour (je fais fonction d’avocat du diable
ici, très deuxième degré, ce qui donne aux malhonnêtes la possibilité
d’exciser ce commentaire et prétendre que j’écris ce que je pense, sans
nuance) dans l’intelligence redistributive collective de l’affaire. Nous
avons signé des conventions de droits universels de l’homme qui nous
assurent un flux constant de personnes issues de pays en guerre, en
guerres de comptoir, guerres de proxies. Les personnes qui viennent sont
diversement traumatisés, habitués, endurcies et formées par le « haut
conflit » (violence, passage à l’acte, souvent contre nous, notre
culture et nos méthodes).
Ces personnes, dans la forme de « réfugiés politiques » et de «
fomenteurs de troubles » font partie de notre « préférence nationale »,
nos migrants privilégiés. Bizarre, non ? Des honnêtes gens qui sont
venus plutôt dans l’optique d’une vie paisible et productive, les «
réfugiés économiques », nous les vilipendons comme des profiteurs, nous
les rejetons, nous les soumettons, de nouveau, dans une parodie de
l’esprit gaullien. Et cependant, cette situation de fait est à peu près
irrécupérable, sans grand génocide, maintenant.
Cumulativement et à la longue, nous, les puissances dites «
ex-coloniales » devenons des pays-mondes, et avec l’ubiquité de nos
transports, nos mains-mises sur le système économique et les
communications instantanées, nous sommes les sociétés les plus mixtes,
les moins homogènes du monde. Ce qui nous distingue, peut-être, est la
subordination de l’identité nationale à l’intérêt particulier et
profondément égoïste de tout un chacun. Il y a un auto-tri osmotique qui
va dans ce sens-là. Pour ainsi dire, les derniers à réussir à grimper
sur le bateau de sauvetage sont les premiers à repousser à l’eau les
prochains venus. Il ne faut pas que cela déborde, ni que l’on soit «
remplacé », il y a des quotas. Très Darwinienne, finalement, cette
préférence nationale, très performative. La nouvelle loi exprime bien ce
concept d’auto-tri performatif, ce syndrome de Stockholm en souvenir de
la Choir.
Il y a aussi cette vision qui nous dépasse, nous, les européens, dans
nos minuscules pays – si la Russie a une population bien plus grande que
chacun de nous (200 millions?), elle occupe la plus grande surface
terrestre du monde, touchant sur l’Atlantique et la Pacifique. Elle est,
relativement, sous-peuplée, avec des ressources naturelles
bourgeonnantes. Sa potentialité est latente, son territoire aussi
difficile à occuper qu’à défendre, et depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, elle a subi une guerre économique et idéologique
d’attrition, de la part des pays de l’OTAN, autour de l’axe principal
des États Unis, de l’Angleterre, du Japon et de la France, pour qu’elle
n’assume pas sa vraie place dominante dans la Géopolitique.
Poutine menace de réveiller l’ours. Les changements climatiques le
réveillent déjà, le dégèle du permafrost la secouent dans sa longue
hivernation, un bascule d’état frigide à état liquide, instable et
dynamique, a lieu d’être. Nous avons du mal à saisir ce que la Russie
aurait à faire en Afrique, qui, nous croyons, nous est bien plus proche,
culturellement et climatiquement. Redressons-nous. L’Afrique est un
continent de l’envergure de la Russie, ce dernier un pays-continent qui
s’est auto-constitué par le colonialisme et le comptoir-isme interne,
dans un cadre continental, non-maritime, et sans éliminer une bonne
partie des « indigènes ». Un pays continent, sans discontinuité, dont
les russes font partie, comme peuple ancien et moderne, essentiellement
européen, basiquement opportuniste.
Nous oublions de noter que la Russie a encore beaucoup de chemin à
parcourir pour nous rattraper, dans ce parcours qui nous est devenu «
postcolonial » (euphémisme - « oligarchisme » universaliste, peut-être
?).
Prenons le Singapour et le Hong Kong, face à l’Indochine et à la Chine.
Les Îles Britanniques qui, pendant des millénaires, ont eu leur « paroi
osmotique », pour dire l’océan, ont été des forces clés dans la
restitution de ce système osmotique, gréco-romain, de « comptoirs »
coloniaux, faisant partie de systèmes impériaux de la même manière que
l’entité artificielle « Israël », créée de toutes pièces par des
puissances coloniales, fait partie aujourd’hui de l’hégémonie
états-unienne. Le colonialisme est, finalement, très payant, … trop
payant, il permet d’extraire et de détruire sans subir directement les
conséquences de ses actes.
Depuis l’époque des grecs et des phéniciens, il a été payant, il crée
des cellules, des parois et de l’osmose culturelle – en relation avec
l’altérité des flux tendus. Dans ce sens, par exemple, l’établissement
de l’Empire Romain n’est pas un accomplissement de faits d’armes mais un
processus d’assimilation réciproque culturelle, amorcée, pour
simplifier, par les grecs, qui rend possible, comme si c’était un fait
accompli, la convergence et la mutualisation d’intérêts, la Pax Romana.
Ce n’est que lorsque cet empire perd ce dynamique, en devenant
centriste, que le drapeau est transféré aux peuples, territoires et
nations assimilés à cette culture, qui ont terminé par l’intégrer et
l’exprimer à leur guise.
🖶
↑
↓
samedi 16 décembre 2023
La Journée « Mobilité Lozérienne »
Plus de mobilité véhiculaire = moins d’emploi local
J’écris ces mots sur le papier de la table « mobilité/emploi » à côté d’une étiquette « besoins ».
Il y a toute une éducation à se faire dans le fourvoiement d’un agenda,
ou « comment détourner une exercice d’intelligence collective pour
qu’aucune intelligence non-consensuelle n’en émerge ».
Dans un monde où les algorithmes machinaux jouent libres et les êtres
humains, avec leurs « rule-based-systems » (systèmes
inflexibles basés sur des lois), sont réduits à la langue de bois.
Je suis participant à la Journée de la Mobilité lozérienne, dans une
grande salle de la préfecture à Mende. Ma journée a commencé de manière
intéressante. M’étant levé à 3h30 pour faire le trajet à vélo de Florac,
pour arriver à Mende avant 8h30, je me suis trouvé à 7km de Florac avec
un petit problème mécanique – ma chaîne s’est cassée, plus de force
motrice, plus de transmission, 33km à faire. Arrive le premier véhicule
qui passe depuis ma sortie de Florac, je fais le stop, il s’arrête, bien
sûr, je rêve, mais non ! Je me trouve avec mon vélo dans la
voiture d’un très jeune gendarme de Marseille, qui monte à Paris et qui
suit son GPS – on se trouve sur le Causse de Mende, à descendre par le
Parc des dinosaures, malgré mes tentatives de lui indiquer le chemin, et
je suis déposé à 6 heures dans le gel devant la médiathèque, on est
loin de l’aube encore.
L’avantage, quand on fait du vélo, c’est qu’on produit sa propre chaleur
– on est auto-chauffant, sauf sur les longues descentes à roue libre.
On préfère donc le froid, pour pédaler. Là, j’ai deux heures de marche, à
Mende, juste pour ne pas me geler. Je découvre la forêt des Poilus,
c’est formidable, d’éducation, de respect de nos ancêtres. L’ancien
maire de Mende me regarde, avec son fils, balaise, à ses côtés, son fils
qui va mourir dans la première guerre mondiale.
Émotionnellement rafraîchi, bien que physiquement un peu rincé, je me
présente à la Préfecture à 8h15 (au moins je ne suis plus dans une queue
de sans papiers à attendre les mots péremptoires d’un fonctionnaire
omnipotent). À l’intérieur, une panoplie de croissants, de petits pains
au chocolat, de café, de jus de fruits, … on voit bien le contraste avec
nos maigres rations de tous les jours.
On peut vite comprendre qu’avec une seule journée, on ne va pas bien
loin dans l’approfondissement du sujet. En fait, si la convention
citoyenne sur les mesures écologiques a eu tellement de succès
productif, c’est que l’on a commencé d’abord par une exercice sincère
d’apprentissage, en invitant des vrais experts pour expliquer leur cœur
de métier, ainsi donnant aux « jurés » au moins la capacité
d’y voir un peu plus clair.
« Les Besoins »
Ici, on voit immédiatement, avec le rubrique « les besoins »
écrit tout en haut de la colonne principale, qu’on a bouclé l’affaire –
on voit déjà comment ça va tourner, nous sommes là dans le rôle de
canards qui s’encanaillent pour faire beaucoup de bruit – on demande
d’être gavé, on a faim, c’est le moment du « wish list ». Donc
« toujours plus de mobilité, plus de cars, plus de trains, plus de
covoiturage », pour cette élite des subventionnés, avec une ou
deux absences curieuse – pas d’usagers simples, sauf moi et un autre,
dans la cinquantaine de personnes qui assistent à l’événement. Pas de
représentant politique ou de fonctionnaire communal ou départemental.
Pas de décisionnaire, que le monde associatif de la Lozère, finalement.
Et pourtant, on n’est pas une île.
Au début de l’affaire le « facilitateur » nous demande de nous
mettre en quatre groupes, aux quatre coins de la salle. Milieu
associatif (plus des deux tiers des gens réunis), milieu
entrepreneurial, habitants, … Je décide de me mettre dans le groupe
« nomades », que j’ai inventé sur le coup et dont je suis le
seul membre, au centre de la salle. J’explique que si je suis
« domicilié » ou « hébergé », c’est purement pour
des raisons de pragmatisme administratif – comme pour les gitans.
Il y a la dame qui dit fièrement que son empreinte carbone n’est
« que » de 4 tonnes par an, y inclus le voyage en Afrique pour
visiter son fils. Je l’interroge : « et les routes sur
lesquels vous roulez ? » … « ah, c’est vrai que les
routes n’étaient pas tenues en compte dans le modèle du
questionnaire. »
Bon, sachons que la Lozère, comprenant une population d’environ 75 000,
est l’un des départements les plus accidentés, avec le plus de dénivelé,
de la France métropolitaine. Le coût de l’infrastructure routière, par
habitant, est donc d’entre les plus élevés de la France. Sachons que le
bilan carbone du transport motorisé et électrique est, en moyenne, en
France, de 50 % pour cent infrastructure, cinquante pour cent
véhicules. En Lozère, c’est plutôt 80 % infrastructure routière,
20 % véhicules qui roulent dessus, par habitant, un chiffre qui est
accentué par l’usage des touristes. L’impact du véhicule, en terme de
taille de chaussée et entretien, dépend du poids (par essieu) du
véhicule plus sa vitesse/accélération – un seul tracteur ou quatre
quatre va faire plus de dix fois plus de dégâts qu’un véhicule léger,
peut-être bien plus que cent fois plus qu’un vélo, par exemple –
l’échelle de calcul pour le renforcement des routes est également
logarithmique.
Le dernier kilomètre
Le représentant de « Mobilité Lozère » déclare fièrement qu’au
lieu de parler du dernier kilomètre, il faut parler du premier
kilomètre, ceci dans le contexte bien connu en logistique qu’il est
facile de livrer à des entrepôts, mais que c’est le dernier kilomètre
jusqu’à la demeure du particulier, qui peut se révéler
« compliqué » (synonyme : coûteux).
Je vais faire un résumé « audacieux » – l’être humain, il est
plutôt une complication, vu du point de vu d’un véhicule (on imagine que
le véhicule est doté d’IA). Ceci dans un monde où cette complication
peut-être « ignorée » dans la mesure que c’est au particulier
de se débrouiller pour aller à l’intermarché de Florac, avec 500 mètres
de dénivelé, et d’assumer les frais de trajet. Le supermarché ne
s’occupe que d’amener des denrées d’un entrepôt à un autre. Plus il ne
s’occupe que de véhicules lourds, plus il économise. Le supermarché est
massivement subventionné par l’état - qui doit fortifier les routes
jusqu’à cent fois plus pour supporter les poids et les vitesses des
camions lourds, tout cela totalement gratos pour le supermarché. Du
point de vu du supermarché, mieux vaut des riches à la campagne, à tous
égards, ils ont les véhicules, ils ont l’argent. Les touristes aussi,
comme cela on peut fermer hors saison et économiser en main d’œuvre.
On a vu un peu où cela nous mène avec les annonces du Président Macron
d’assistance aux foyers « pauvres » pour l’achat ou plutôt le
leasing (location de longue durée) d’un véhicule électrique, pourvu
qu’ils soient des « gros rouleurs ». Donc, on subventionne les
gens pour les kilomètres qu’il avalent. Chapeau, Monsieur Macron, je
n’aurais pas pu faire mieux pour gonfler notre hyper-consommation
d’énergie fossile et de dépendance sur les matériaux venant de
l’étranger. Génial.
COP28
Et tout cela se passe le vendredi de la semaine du COP28 à Dubaï, où
l’on célèbre l’inclusion du mot « fossile », dans l’expression
« transitionner » (nouveau verbe COPien) vers un monde sans
fossile pour l’année « x » (c’est un peu comme la promesse
macronienne de sortir du glyphosate dans un laps de temps « d’ici
trois ans », pour renier sa parole la date venue).
J’ai une proposition, pour ré-induire une atome de confiance dans la
parole politique et la parole toute courte, c’est d’être déjà en train
de faire ce que l’on propose. On constate, avec une vision
multidécennale, que les paroles les plus tranchantes ont été prononcés,
par exemple, par le Club de Rome (plusieurs experts économiques de haut
statut politique), en 1973 je crois, sur un avenir compté en décennies,
pour que s’ensuive la course vers l’abîme, chaque fois plus effrénée,
des décennies suivantes. Donc, aujourd’hui, on produit plus de déchets
totalement innécessaires que jamais, on est plus que jamais
industrialisée, et tout le monde est au courant de ce que l’on
« devrait » faire pour un minimum de cohérence écologique et
sociale.
Je m’imagine le conclave des quatre associations dédiées à promouvoir la
production de chaque fois plus de véhicules, de routes et de
« mobilité » pour une élite d’humains chaque fois plus réduite
– l’un d’entre eux dit « mais ne pourrions-nous pas l’appeler
« mobilité douce » ? » « Ah non, quand même
pas » dit un autre, « nous serions coincés dans notre logique
de « toujours plus de mobilité » à ce moment-là. »
L’affaire est bouclée. On a fait un tour de table sur ma première table,
pour voir le mode de transport utilisé par chacun pour venir. Tout le
monde est venu des quatre coins de la Lozère en voiture, sauf moi, en
vélo à jambes, l’idiot de la partie. En dehors de la salle, quatre vélos
électriques, payés par « nos impôts », pour ceux qui ont fait
le « premier kilomètre » de Mende. On peut juger de la bulle
d’irréalité dans laquelle on vit par les réponses des gens, ils parlent
maintenant, comme les américains depuis longtemps, de « temps de
trajet », les kilomètres et surtout le dénivelé les échappent
totalement.
Je tente une exercice pédagogique, « toi tu brasses combien
d’énergie ? je demande au directeur de Lozère mobilité. Aucune
idée. Et un quatre quatre ? Non plus. Bon les chiffres pour une
personne moyenne (60-70kg) sont de l’ordre de 60 Watts, l’équivalent
d’une vieille ampoule électrique, et de 10 000 Watts (10kW) pour un
quatre quatre. Grosso modo, 100 à 200 fois plus d’énergie consommée par
le véhicule en question. J’explique « il faut quand même tenir en
tête que le vivant dépasse très largement, en performance, toutes les
machines que nous utilisons au quotidien. Même si si on rajoute au
calcul le temps de trajet, l’humain, et n’importe quel animal doué de
locomotion propre, est plusieurs fois plus économe qu’un véhicule
motorisé. »
L’objet est quand même de réduire nos empreintes énergétiques.
Je suis sûr que si cet événement avait eu lieu au cours de plusieurs
journées, avec des éléments de pédagogie simple, les écailles seraient
tombées des yeux des participants, mais le cadre administratif a été
scénarisé par un équipe de « facilitateurs » qui a mis le
bâton dans les roues chaque fois que l’on risquait de sortir des chemins
connus. Je m’étonne encore de cette nouvelle mode de « gestion de
groupe », il y a le gestuel, il y a toute la logistique framasoft
et Facebook, il y a la centralisation et il y a les petits groupes
fragmentés, chacun sur sa « table », en train de faire des
« décisions » sur le projet le plus donnant, après vingt
minutes de discussion.
Les deux groupes avec sans doute le plus de vrai intérêt et/ou de
pouvoir matériel, les usagers et les sections du fonctionnariat chargés
de la logistique, de l’infrastructure et du planning urbain, n’étaient
pas là, les décisionnaires politiques non plus.
Au cours de la réunion, j’ai pu constater que la seule personne avec une
relative expertise dans le domaine de la logistique routière, la
mobilité et son impact social, c’était moi, basé sur le dictum de
Socrate qu’après avoir bien questionné les sages sur un certain nombre
de sujets, il s’est aperçu qu’ils ne savaient pas du tout de quoi ils
parlaient, tout en se faisant passer pour "autorités", tandis que lui,
qui en savait plus loin qu’eux, savait bien peu de choses.
Je me proclame donc fièrement « expert » à toute opportunité
maintenant, en notant que personne ne m’accorde cet illustre titre. Dans
un tel contexte de journée de réunion, cela aurait eu un bel effet que
quelqu’un avec la responsabilité dans le fonctionnariat local pour
l’entretien des routes explique à peu près en quoi ça consiste – et
combien ça coûte. J'imagine que ce serait difficile, pour lui,
d’expliquer combien cela coûte à la planète humaine, il y a le mot
« Jobsworth » en anglais, dans l’expression « it’s more
than my job’s worth », ce qui veut dire que l’on ne tue pas l’oie
qui pond les œufs en or. Dans le cas de quelqu’un pour lequel le boulot
consiste à faire couler le goudron à flots, en utilisant les machines
les plus grosses et énergivores possibles (économie d’échelle, comme
pour les supermarchés), pour créer des routes chaque fois plus robustes,
s’il faisait une analyse écologiquement et sociale cohérente, il ne
pourrait que démissionner – une sorte de Hara Kiri professionnel.
Reste que les seules personnes avec lesquelles j’ai pu avoir des
conversations sensées sur le sujet de la logistique et de
l’infrastructure, ce sont les professionnels, les ingénieurs des Ponts
et Chaussées, de l’École des Mines, tellement le sujet est invisibilisé.
Auparavant, la dîme, la corvée, les cantonniers locaux étaient aussi
des citoyens.
Dans la partie concluante de ce marathon, vers 17h30 le vendredi soir,
j'ai avoué ma profonde déception sur la journée, j’ai observé qu’elle
manquait de démocratie La démocratie participative nécessite aussi une
connaissance des causes. La délibération démocratique « a
besoin » de consentement éclairé.
C’est-à-dire que la thérapie cognitive de groupe est d‘abord de
s’apercevoir des vrais enjeux et quantités au centre de la matière dont
on discute.
Pour la vaste majorité des participants à cette journée, le principal
objet d’intérêt était « les sous » et « combien de
véhicules en plus est-ce que l’on pourrait acheter avec les sous ».
Je simplifie à peine.
L’astuce, pour arriver à un tel niveau d’insouciance et d’ignorance pure
et simple sur la base du sujet de la réunion, est d’abord de parler
d’une manière exclusivement auto-référentielle. Selon la méthode
néo-libérale devenue si classique que même la gauche radicale la
pratique, dorénavant, on établit des alliances de circonstance avec ceux
qui ont la même problématique – pas assez de « mobilité »
dans le cas de l’élite associative de la Lozère, pour eux et elles
spécifiquement, puisque leur méthode de travail est d’aller en véhicule,
souvent collectif, aux quatre coins de la Lozère sur les jours
successifs de travail de la semaine, ainsi évitant d’employer des gens
dans ces coins perdus. Chaque nouveau venant doit être équipé pareil,
dans le meilleur des cas, selon cette vision.
J’ai eu une vision personnelle de plusieurs professionnels et
fonctionnaires qui se décident qu’au lieu de faire une vidéo-conférence,
cette fois-ci, ils viendront faire un pique-nique sur le Mont Lozère.
La scène est de deux douzaines de mini-buses à gazole venus des
extrémités de la Lozère, en cercle, en coupe-vent, avec leurs
conducteurs, un par véhicule, au centre du cercle. Le titre de la
composition pourrait être « Faune du Parc Naturel de la
Lozère ».
Je note à la table de « mobilité Lozère », que vivre dans une
ville comme Florac, c’est vivre dans un endroit où tous les
fonctionnaires se vident à la fin de la journée ouvrable. Les forces
vives ayant évacué les lieux, la ville est raide morte, le soir, hors
saison. L'infrastructure et les résidences secondaires stagnent,
gentiment, pendant que les SDFs et les immigrés se gèlent, dehors.
La manière des élites locales « de fait » de manigancer les
opérations de telle manière qu’ils ne fréquentent jamais en groupe
participatif les populations théoriquement desservies, préférant
systématiquement des « ones on one », des interviews
personnalisés d’insertion sociale, des « projets personnels »,
ne cesse de m’étonner, c'est tellement flagrant. Nous n'avons qu'à
demander nos subventions - mais sommes-nous assez riches pour en avoir ?
Cela ne peut pas se passer autrement, si nous continuons d’exporter tous
les sous que nous gagnons en dehors de la Lozère, en pétrole, en
bitume, en portables, en véhicules. Le mieux que nous pouvons espérer,
c’est que les impôts récupérés sur le pétrole par les autorités
centrales nous reviennent – notre élite décisionnaire doit aussi avoir
du pouvoir dans l’exécutif central.
Tout bon fonctionnaire, associatif, et la pléthore des accompagnants
nécessaires, doit donc se dresser vers l’échelon supérieur pour attendre
les miettes qui tombent de la table, les « gens du coin » ne
comptent pour rien, sauf en termes de problématique, les transients ont
comme fonction de justifier les salaires de ceux qui les soignent.
D’où l’inconfort visible de cette élite « mobilité
lozérienne » de ne pouvoir compter que deux personnes, là, avec
comme seul titre « usager du système ». Encore plus tragique,
ni l’un ni l’autre était Lozérien, ils n’étaient même pas
« résidents », mais « dépendants » de l’une des
associations qui a lancé la journée. Pas très gai, si l’on voulait se
faire passer pour représentatif de quoi que ce soit, au niveau de la
population locale, pas d’échantillon très convainquant de la démographie
locale réelle.
Malgré les apparences, bien sûr, on apprend vite que comme pour les
entreprises fossiles comme Total, tout est rose et on fait le mieux
qu’on peut, dans la sincérité la plus absolue, bref, une autre
forme de greenwashing (grooming) mutuelle.
Témoigne l’attitude désabusé total des deux « usagers », le
« vote blanc » habituel, quoi, le rejet habituel de la
politique politicienne habituelle.
Le problème avec les élites locales rurales en France, je n’ai pu que le
noter, c’est qu’ils ne s’identifient pas du tout comme faisant partie
de l’élite. Ce qui donne parfois des conversations totalement
surréelles. Comme tout le monde, ils se trouvent attrapés dans une
logique infernale d’auto-justification sans fin, cherchant désespérément
des potes pour pouvoir se décontracter socialement – ce qui mène tout
naturellement à ce genre d’entre-soi exclusiviste. La seule chose qui
m’a vraiment frappé – et à beaucoup d’autres je le crois bien, c’est un
chiffre, 1 pour cent et demi de la population lozérienne utilise le
réseau de transport collectif public (les bus).
Tout ça pour ça. C’est vraiment très peu, un pour cent et demie, j'ai du mal à le croire.
Ne s’identifiant pas comme élitaires, dans leurs pensées, ils paraissent
ne pas noter qu’avec les catégories macroniennes – devenues courantes
dans la mentalité corporatiste de l’époque Macron, il suffit d’allouer
des catégories échelonnées, tels que « bénéficiaire », emploi
aidé, conseiller, professionnel, bénévole, CDI, etc., pour parvenir à
des niveaux de pouvoir sur le sort des autres qui ne ressemblent à rien
de plus que le pire des stratifications sociales du 18iême ou 19iême
siècle.
Pour obtenir des biens de subsistance primaires, logement et nourriture,
tu dois accepter l’« accompagnement » sur un « parcours
d’insertion sociale » ou, pire, un « projet personnel
d’insertion professionnelle ». Ce qui veut dire que tu vas toucher
des sous de l'état. Si tu refuse cet arrangement faustien, tu es sans
intérêt. Ce qui veut dire que tu te trouves devant quelqu’un de 25 ans
qui peut te rayer de la carte s’il ne t’aime pas. Tout le monde, sauf
celui qui détient le pouvoir, essaie d’être très poli à ce moment-là. Il
est intéressant de noter les abus de pouvoir, l’insolence, je dirais,
de ces petits fonctionnaires, renaître, dans le confort de leurs rôles
indémontables institutionnels. Il faut peu d’avantage social pour que
l’être humain moyen devienne un vrai facho.
Comme s’ils n’avaient pas compris, qu’ils ne voulaient pas comprendre,
que seulement ceux qui étaient assez riches pour se payer un véhicule et
l’essence qui va dedans pouvaient vivre en campagne. Que l’utilisation
réelle du transport collectif était si pitoyablement, abysmalement
réduite parce qu’il ne restait à vivre ici que des riches – des riches
qui se sentent pauvres, puisque au moins 8000 euros par an (véhicule
légal plus carburant, annuel) est le seuil d’entrée à cette société,
aujourd’hui.
Et vous en voulez plus ! Rassurez-vous que les cas sociaux qui
alimentent les professionnels, ils ne pourront plus tenir pied dans une
telle configuration socio-économique, sauf s’ils attirent des tonnes de
subventions, des doubles-RSA. Le travailleur agricole, il ne peut plus
tenir, logiquement – il n’y a que des machines qui font le travail, en
tous cas, la tribu de chasseurs à quatre quatre, autre élite rurale, se
pavane.
🖶
↑
↓
?
le bénéfice des circuits courts en milieu rural
climat social
Il peut exister un problème de réception positive de populations pauvres
à la campagne. Cette problématique est associée avec le spécialisme,
dans certaines petites villes à la campagne, dans le domaine de la prise
en charge de populations à fort besoin d’accompagnement social ou de
santé, aussi bien que de personnes réfugiées pour des raisons
climatiques, économiques, politiques ou de guerre.
Le risque est de créer du ressentiment chez une partie ou l’autre de la
population localement présente, ou de créer un conflit d’intérêts avec
l’industrie du tourisme de consommation. On a pu constater une
différentiation entre l’accueil de réfugiés de l’Ukraine,
majoritairement des femmes avec des enfants, qui ont été extraits
d’urgence des zones de guerre de manière souvent temporaire, et la
réception de réfugiés climatiques et de guerre du Moyen Orient et de
l’Afrique qui auront des projets d’installation dans la durée.
Le conflit d’intérêts peut souvent être perçu comme un conflit dans
l’accès au logement ou aux services sociaux, de santé et de première
nécessité, étant donné que la priorité dans ces cas est accordée selon
des critères de précarité et d’urgence, alors que la réalité économique
est que les subventions d’état combleront et compenseront ces conflits
apparents d’intérêt, que le bâti du coin est souvent sous-occupé et en
besoin d’entretien et que les nouveaux venus sont aptes au travail dans
ce secteur, comme dans le secteur de rénovation écologique.
Dé-désertification rurale
Dans la mesure qu’il existe cette économie décarbonée rurale, la
population active des centres urbains français peut, elle aussi, venir y
participer, par période ou de manière permanente.
Contribution socio-économique
Si la contribution socio-économique des milieux pauvres et précaires est
localement visible et que l’intégration sociale et économique réduit
une dépendance sur l’état, il n’y a aucun conflit d’intérêt.
L’infrastructure de tourisme de consommation à grand rayon, qui reste
souvent vide en bas saison et qui se prête à une utilisation dans des
accueils d’urgence ou temporaires, peut être progressivement intégrée à
une économie de mouvement à rayon local ou régional, le long de l’année,
qui soutient l’économie et les services de proximité de manière
durable.
Emploi environnemental
Une solution écologique relativement simple serait de considérer
l’emploi de membres de toutes ces populations dans le secteur du
transport bas carbone, à vélo, vélo-transporteur et à la marche, comme
fil conducteur de cette nouvelle économie décarbonée. De cette manière,
aussi, on élargirait le rayon de placement autour des petites villes
rurales, des individus et de familles, dans des gîtes ruraux, sans
risque de les désocialiser. En régularisant les mouvements logistiques
de ces véhicules légers autour des marchés locaux hebdomadaires
renaissants, bénéficiant de la fréquentation de la population locale
non-motorisée qui y contribue et qui en profite, on attire aussi
l’industrie et les services complexes qui bénéficieront à la population
locale, diminuant le problème de « désert rural » qui existe
lorsque la quasi-totalité des transports se font par véhicule motorisé,
imposant de lourdes charges supplémentaires sur les ménages les moins
aisés.
Métiers régénérés localement
Industrie
Les industries rurales qui peuvent en bénéficier sont le jardinage
vivrier avec surplus pour les marchés, l’entretien d’arbres et de haies
productives, l’économie paysanne à besoin fort en main d’œuvre, les
ateliers manuels de transformation de produits locaux qui rajoutent de
la valeur, l’hôtellerie, la restauration et le commerce, les mécaniciens
spécialisés dans l’entretien et la production locale de vélos, de
vélo-transporteurs et de portes-bagages, le bâtiment, la construction et
les divers métiers de petit artisanat associés au bâti et à son
équipement, le recyclage et le vestimentaire.
Services
Les services à la personne, les services sociaux et médicaux, les
métiers administratifs et d’entretien sont également nets bénéficiaires,
puisque les populations qui arrivent sont souvent des membres de la
population économiquement active, qu’ils soient sur le marché du travail
ou disponibles pour participer au volontariat.
Les populations nationales précaires ou en grande fragilité de santé
peuvent également bénéficier des effets sur leur santé et intégration
sociale associés à leur assimilation dans la population de marcheurs et
de cyclistes qui fréquentent les marchés locaux à maillage plus dense et
régulier.
Les nouveaux venus, qui peuvent venir de milieu urbain ou rural, peuvent
aussi se familiariser avec la vie rurale ici, en apportant leurs
propres savoir faire et énergie.
Aspects écologiques environnementaux
Il est possible de décarboniser plus rapidement l’économie rurale en
remplaçant les flux d’énergie venant de l’extérieur dans la forme de
carburants fossiles ( qui impliquent un flux qui extrait notre argent
vers les économies de pays lointains, dans les industries climatiquement
mortifères d’extraction pétrolière et de transport en circuit étendu ),
par une économie d’emploi humain local, à coût plus bas en termes
d’infrastructure, soulageant les dépens annuels et les nuisances
associées au passage des camions et utilitaires à poids et à vitesse
élevés, désartificialisant les sols réservés au stationnement des
voitures, rendant moins nécessaires et moins coûteux des projets de
construction et d’entretien routiers.
En développant l’économie du jardinage, on augmente le bénéfice
écologique localisé, en termes de biodiversité, de mesures
anti-sécheresse et de bâti durable. L’emploi manuel dans ces secteurs
facilite le partage de savoirs, contribuant à l’éducation populaire aux
enjeux écologiques.
Le re-développement d’une économie horticulturelle productive et des
savoir faire et compétences associés se fait de manière progressive,
avec l’avantage que l’horticulture nécessite relativement peu de
surface, souvent associée au bâti. Plusieurs surfaces de taille réduite
sont devenues non- ou peu productives en agriculture industrielle et
pourraient bénéficier d’une récupération et entretien plus manuel, dans
un climat de mixité participative.
Faite à Florac en Lozère, le jeudi 30 novembre 2023
https://ecowiki.inecodyn.fr/?Circuits_Courts
🖶
↑
↓
mercredi 6 décembre 2023
Projets Florac
pour la réunion de fonctionnement de l’Ancrier
14h jeudi 7 décembre 2023
- 1. Projet anim-éco hebdo ( tous les mardis, 20h pour 20h30 )
- 2. Projet permanence après-midis en semaine (ateliers co-apprentissage, orientation)
- 3. Projet bennes déchets biodégradables/compost (construire et installer)
- 4. Projet squat, atelier, jardin (trouver, occuper et mobiliser, avec accord du propriétaire)
- 5. Projet circuits courts/Boucles des marchés (Florac jeudi, Sainte Croix dimanche)
- 6. Projet atelier v-libre régulier, accessible, adapté aux besoins des nomades
- 7. Projet kambucha (production, enseignement et redistribution)
- 8. Projet hygiène buccale / médecine préventive (cherchons stagiaires dentiste/médecin)
- 9. Projet récup restaus (récupérer, trier et redistribuer produits perdus de supermarché)
- 10. Projet baux de transformation écologique (cultivation de terrains en bon ordre légal)
Faite à Florac en Lozère jeudi 30 novembre 2023
https://ecowiki.inecodyn.fr/Projets_Florac
🖶
↑
↓
lundi 27 novembre 2023
ça fait mal, refaire le monde
le bon étranger et le nomade (les butés)
Scène comique – duo comique – le loyal et l’auguste, où on dit les
choses qu’il ne faut pas dire, critique les mœurs de la société au sein
de laquelle on est, commet les faux pas qu’il ne faut jamais commettre,
tout dans le meilleur possible des mauvais goûts.
Cela se (dé)fait sur un tapis roulant, peut-être il y a quelqu’un qui
pédale, pour montrer l’utilité de l’énergie non-fossile. Un ou des
écrans alimente le propos.
Mais ce tapis roulant est aussi le déplacement dans le réel, la synergie
du cinéma en temps réel avec les impossibles défis d’y arriver, à
temps. On raconte les aventures vécues au cours de la dernière étape du
voyage. La participation de l’audience est sollicitée de cette manière.
On se trimbale de bled en bled avec tout ce matos et sans énergie
fossile ni électrique, en demandant, par la mime et l’inaptitude, du
soutien pour le projet global – refaire le monde.
D’ailleurs le titre du projet pourrait être « refaire le monde ».
La mise-en-scène de soi-même souvent tragi-comique provoque la
sympathie, alors que le duo est plutôt en train de gronder l’audience.
Le jeu tourne autour d’un enjeu hyper-sérieux. Tous ces paradoxes !
On peut envisager que le loyal gronde constamment ses compagnons, le
film crew, l’auguste, la technique, tout le monde quoi, pour leurs
ratures réelles ou imaginaires, leurs défaillances face à l’éthique
inébranlable de la fin du monde. Les textes de la mise en scène
représentent la réalité des points et des contrepoints des arguments
réels entre les acteurs. On essaie de faire sortir à tout moment que
bien qu’il y ait inaptitude, le défi est plutôt le total inadaptation du
monde dans lequel on vit à une vie réellement écologique.
– Comment en est-on arrivé là ?
– Bin, moi, à vélo. D’ailleurs j’ai eu un crevaison en haut du col et
j’ai pas mangé depuis vendredi. Vous avez de quoi manger pour moi ?
(à l’audience – pause pour qu’ils sortent les grignotes de leurs sacs –
qu’on critique pour leur industrialisme ).
– D’ailleurs, ce n’est pas que le vélo qui est crevé.
– Pourquoi t’as pas pris le camion, comme moi, j’ai dormi tranquilo ?
– Je crache sur ton camion !
– C’est pas ce que tu as dit lorsqu’on t’ ramassé à 2h du mat., t’étais bien content de notre aide, à ce moment-là.
– The show must go on.
… et ainsi de suite
On joue du réel en comique-fiction, ce qui donne une improvisation qui
n’est autre qu’une conversation alimentée par des faits réels, en temps
réel, ou tout au moins récemment vécus. Le ou les cinéastes, qui sont
vraiment là on train de filmer, qui ont aussi édité et mis sur écran,
devant l’audience, l’évidence visuelle de la dernière étape, sont en
train de filmer la prochaine étape. Rien n’empêche des membres de
l’audience d’y participer, de voter les morceaux, ou même de nous
accompagner sur l’étape suivante. Nous sommes en devenir, notre destin
ouvert.
– Liste de besoins ( s’ensuit une parodie des AGs des gauchistes, chamboulée bien sûr )
– Nous avons besoin de toi, toi et toi, pouvez-vous nous créer les
fiches – on indique l’écran où il y a la liste à copier – et les
distribuez entre vous, n’hésitez pas à en rajouter, on ramassera au
cours de l’événement, …
– sinon on fera avec ce qu’on n’a pas, …
On essaie, de cette manière, de créer des ponts entre monde réel physico-social et monde virtuel, idées abstraites.
Dans la liste des besoins il peut y avoir, piaule cette nuit, compagnie
humaine, quelqu’un qui est sur réseaux sociaux, nouveaux lieux pour
faire le spectacle, des bons acteurs pour nous remplacer, des bons
cinéastes pour remplacer les mauvais, des écrivains, artistes, bonnes à
tout faire, ...
On essaie de créer un emballement.
Notes scéniques
Une certaine ingéniosité est requise pour que les objets utilisés soient
transportables ()ou facilement trouvables sur place) et que
l’assemblage se fasse, autant que possible, devant les yeux de
l’audience. Le tapis roulant peut consister en tapis de sols rattachés.
Le vélo et les rondins qui l’opèrent, les mêmes que pour se transporter.
Lorsqu’on fait l’assemblée générale, on met les chaises de l’audience
en cercle, s’il existe des chaises. Lorsqu’on note ce qu’il faut sur le
tableau, l’acteur-cinéaste approche son objectif du tableau et
l’acteur-mixage bascule la vue sur écran sur ce qui est en train de
s’écrire.
Malgré l’apparent chaos et les glitchs de la mise-en-scène, une certaine
fluidité/dextérité mobilisatrice se manifeste, mettant l’audience dans
un état où elle peut spontanément contribuer à l’œuvre. Dans la mesure
qu’on arrive à mettre les gens à l’aise, la fin de la performance peut
devenir un endroit où des petites conversations entre plusieurs peut
avoir lieu, pour discuter de comment mettre en œuvre diverses actions
régulières d’entraide mobile sans voitures.
faite à Florac en Lozère le lundi 27 novembre 2023
https://ecowiki.inecodyn.fr/?Ca_Fait_Mal
🖶
↑
↓
jeudi 30 novembre 2023
Élucidation du projet « refaire le monde/ça fait mal »
Selon mon informateur (ex-cloun), le loyal et l'auguste, c'est un duo
comique (en anglais c'est le fouteur de gueule et le straight man, celui
qui ne comprend pas la blague), une combine qui permet la modélisation
par le jeu entre ces deux positions, d'un "dialogue", même s'il y en a
un au moins qui est sourd (et les deux généralement muets).
Dans ce cas, les Augustes, c'est ceux qui ne pratiquent pas l'écologie
pure, s'inventent des raisons pour justifier leur inaction ou
« petits pas », les gens, quoi, alors que le Loyal, il fait
tout, socio-écologiquement, au pied de la lettre. Il demande que les
Augustes le soutiennent, puisque s'ils soutiennent des gens qui font
comme ça, ils soutiennent la naissance et l'épanouissement d'une
véritable infrastructure écologique.
Le message passe par un mélange d’humour et de mise en scène burlesque,
avec le projet "refaire le monde/ça fait mal". C’est un spectacle nomade
qui se joue sur les marchés ou dans les salles polyvalentes sur le
chemin, une réalité-fiction improvisée. Cela donne une enveloppe
matérielle qui permet aux écolos pur jus de se faire accompagner et
entraider par la société civile.
Un interlocuteur de Toulouse m’a dit :
"J'étais à la manifestation contre l'A69, il y a quelques semaines et
j'étais effondré du nombre de voitures présentes. Les actions contre
l'A69 sont fortement dépendantes des voitures, même si quelques
vélos se sont insérés dans les actions. Comme si c'était impossible de
faire autrement. Même après avoir dit que je ne voulais que me déplacer à
pied, des personnes me proposaient quand même des transports en
voiture."
Il s'est sans doute déplacé de Toulouse en train, pour le gros du
chemin, pour cheminer à pied sur place. S'il y avait eu des gîtes de
passage, il aurait pu tout faire à pied. C'est deux jours, limite trois,
de marche ou de vélo. Si les activistes de Toulouse et ailleurs avaient
vraiment pensé "écologie", on aurait eu des milliers d'activistes à
marcher ensemble, à converger, et beaucoup de couverture médiatique. Une
démonstration dans les actes du nouveau monde de transport doux
inclusif que l’on propose.
Ce n’est pas embêtant de vivre une partie de sa vie sur des longs
chemins si l’on se trouve avec des gens qui font les choses en mobile,
mais c'est embêtant si l’on ne rencontre que des gens qui n'arrivent
qu'à penser en statiques. S'il y a une infrastructure qui reçoit,
décemment, des gens qui se déplacent habituellement à vélo et à pied, de
manière régulière, on crée aussi l'infrastructure nécessaire pour
assembler des forces agissantes écologiques sur toute la surface
métropolitaine. Cela parce qu'ils sont déjà mobilisés, leurs
communications et besoins basiques sont déjà configurés pour ce genre de
vie et pour s’engager dans des chantiers et des actions écologiques.
Donc, ... là ou on dit qu’il faut "faire des tests, savoir bien
expliquer, trouver des contacts diffuseurs", le texte ci-dessus répond à
l'une des demandes, directement, il explique le projet d’infrastructure
humaine « refaire le monde/ça fait mal ».
Ensuite, il n'y a rien de mieux que l'expliquer par le faire ensemble,
ou bien par faire l'un des ingrédients statiques ( créer un gîte de
passage, un lieu de stockage, un chantier de création de jardin vivrier,
un stand régulier sur un marché hebdomadaire ) qui interagissent avec
le composant "mobile" (nomades, vacanciers productifs, cantonniers
mobiles ), aidant à les rendre opérationnels. Les contacts diffuseurs
s'établissent de cette manière, ils se branchent sur les moyens de
communication qu’ils trouvent sur le chemin, ils ont aussi leur propre
média. C'est flexible, ça s'adapte à chaque milieu. On arrive ainsi à
intégrer l'explication et on la fait sienne.
Par contre, comme le texte cité ci-dessus le démontre, il est très
difficile de changer les habitudes des gens, même ceux qui militent pour
la cause. La meilleure manière, généralement, comme pour les phobies,
c'est une thérapie cognitive où on arrive à leur faire intégrer, par des
échanges verbales et des passages physiques à l'acte (familiarisation)
et au moins une répétition du pire, à intégrer de nouvelles routines
dans leurs gestes quotidiens possibles. Par exemple, pour un
arachnophobe, on parvient à faire qu'il ne tue pas toute araignée qu’il
voit, qu’il laisse courir sur sa main un tarantula ( ou au moins à
proximité de sa main), sans flancher.
Ici, c'est le fait de créer une opportunité pour des gens qui vont
trouver tous les prétextes sous le soleil pour, par exemple, ne pas
marcher jusqu'à Castres de Toulouse, sans savoir où ils vont dormir, à
le faire quand même, ou au moins créer les gîtes de passage, ateliers
V-Libre, etc. nécessaires pour ceux qui le font. C’est donnant donnant.
Petite logistique, grand impact positif.
Faite à Florac en Lozère le jeudi 30 novembre 2023
https://ecowiki.inecodyn.fr/?elucide_Ca_Fait_Mal
🖶
↑
↓
mercredi 6 décembre 2023
Implémentation
Pour qu’un circuit court à finalité socio-écologique se matérialise,
cela peut aider de penser de manière modulaire, en nommant chaque
élément.
Quelles sont les composants qui, réunis, permettent que l’ensemble
fonctionne de manière cohérente – qu’il atteint les objectifs qui lui
ont été fixés ?
Ici on décrit une infrastructure, une logistique.
Pour une mobilité à empreinte carbone réduite à moins de deux tonnes pro rata par an relâché à l’atmosphère, …
stockage, hébergement, restauration, transformation, atelier vélo, social, échange (marché).
Essentiellement, pour qu’un transport à pied ou à vélo fonctionne,
éventuellement avec des ânes, des mules ou des chevaux, il faut une
infrastructure de prise en charge, la nuit, dans l’endroit où on se
trouve, qui ressemble fortement à celui des auberges de Montaigne, ou
des relais de Genghis Khan. En même temps, les acquis de notre époque et
les connaissances nouvelles font qu’il y aura, nécessairement, une
fusion de savoirs pré- et post-industriels, où les biosciences nous
aideront à stabiliser le monde évolutionnaire du vivant dans lequel nous
vivons et dont nous, humains, faisons partie.
Mobilité
La mobilité, telle qu’elle est interprétée actuellement, relève
essentiellement de l’accès véhiculaire d’une population locale, aux
services et centres de population locale et régionale, que ce soit par
le covoiturage ou le transport en commun.
Une toute autre vision de la mobilité est nécessaire pour y voir clair
dans un avenir à empreinte en énergie fossile très réduite. La
production, la transformation et la redistribution de matières à origine
locale deviennent le point focal de l’infrastructure, qui n’a plus
besoin d’être aussi surdimensionnée que l’existante, construite pour
accommoder des camions à conteneur qui nous apportent des denrées à
grand rayon. D’autres filières, comme la filière bois locale,
bénéficient du marché renaissant pour remplacer les plastiques avec le
bois, les liants avec la résine du bois locale, etc.
Cette mobilité humaine locale, via un réseau stable de gîtes de passage
fréquentés, est à la fois locale et universelle. Elle permet de calculer
des voyages d’un, deux, ou trois jours, donnant accès à des villes
comme Toulouse ou Montpellier, par rapport à la Lozère ou l’Aveyron.
Dans un monde maillé de circuits courts, à pied et à vélo, des endroits
relativement inaccessibles, avec une infrastructure dédiée aux voitures,
deviennent relativement plus accessibles. Ici on peut parler de la
remise en habitat de plusieurs coteaux abruptes et terrassés,
difficilement accessibles en voiture, facilement atteignables à pied.
De cet manière il est possible de redistribuer équitablement dans des lieux de stockage plus fréquents, les commandes locales.
Flux
Les flux de transport étant réduits en rayon et en vitesse, calées aux
rythmes hebdomadaires des villes locales, recapturent les ressources
actuellement consacrées à l’achat de carburants venant de l’extérieur.
Le système par lequel le fisc prélève des impôts sur les carburants pour
ensuite subventionner l’économie rurale change en économie où, dans la
réduction de ses achats de carburant trouve moyen de réinvestir en main
d’œuvre humaine locale qui remplace la voiture privée pour la plupart
des besoins en transport local.
Reconnaissance du terrain
Historiquement, les « surveyors » de l’IGN quadrillaient le
terrain, notant des « features »,par exemple, pour savoir si
un endroit boisé l’était par des conifères, des arbres à feuilles
caduques ou un mélange des deux, ils allaient sur place le constater.
Sentiers
La population connaît de moins en moins le détail géographique de la
campagne, qui continue de perdre ses accidents de terrain. Actuellement,
les sentiers piétons et muletiers qui ont existé sont peu employés en
milieu rural, la plupart des transports à distance étant effectués en
véhicule motorisé, même en élevage. La chasse est pratiquée de plus en
plus moyennant des déplacements en 4x4, des communications par
talkie-walkie ou portable.
Faute d’usage, ces sentiers sont souvent bloqués ou obstrués par des
propriétaires qui préfèrent qu’ils tombent en désuétude. Le choix de la
marche à pied devient plus hasardeux et l’offre plus restreinte. De
manière bénévole ou en travaux d’intérêt général, plusieurs personnes
sont employées à débroussailler une gamme forcément réduite de ces
chemins, d’autres balisent les GRs et autres chemins de randonnée.
En même temps, l’accès de véhicules à deux ou 4 roues continue d’abîmer beaucoup de sentiers non-conçus pour ce genre d’usage.
Prescription
Entretien des haies, murailles, pierres formant la chaussée de ces
chemins, aussi bien que de la conduite de l’eau. Ne pas utiliser des
machines mais des outils manuels de jardinage (faucille, scies à bois et
d’élagage, sécateur, etc.).
Routes
Sur toute la voirie publique, de domaine national et parfois privé, il
serait possible de développer des syndicats de jardinage des bords de
route, par section linéaire. Ces syndicats seraient issus de la
population localement présente, l’objectif étant d’installer et
entretenir des essences fruitières et s’en faire rémunérer. Également,
de fournir des services en faveur de l’écologie, augmenter la
biodiversité, dépolluer et régénérer les sols du bord de la route,
stabiliser la végétation et l’emprise racinaire qui aidera dans le
non-affaissement de la route.
Il serait d’utilité et d’intérêt publique de limiter le poids par essieu
et la vitesse des véhicules lourds, en interdisant l’accès à une gamme
plus extensive de petites routes.
Les routes et chemins voûtées des canopées des grands et moyens arbres
servent à donner de l’ombre et de la fraîcheur, maintenant l’humidité
relative de l’air et du sol. Il faudrait cesser la politique
d’élimination des arbres à 10 à 20 mètres de chaque côté de la route, en
partie pour éviter des « sauts » de feu en cas d’incendie. Les routes de cette envergure exposées au soleil et à plein vent, servent
de canaux d’évacuation de l’humidité des forêts qui augmentent le
dessèchement et, concernant les inondations, qui augmentent la vitesse
de ruissellement des eaux.
Il faudrait que la prise en charge de l’infrastructure routière cesse de
sur-prioriser la voiture, par rapport aux plusieurs autres
fonctionnalités paysager de cette infrastructure. Dans la mesure qu’elle
est bien réfléchie, elle crée et augmente l’accidentation du terrain
propice à la bio-diversité et à la production vivrière qui en fait
également partie. Par exemple les mûres, le cynorhodon (églantier), le
noisetier, noyer, chêne, châtaigner, prunier, pommier, cassis, sont des
essences qui poussent bien dans des haies et aux bord des chemins.
Coût de l’infrastructure routière
Le camion et le tracteur fléchissent la route. L’entretien de la route
est en partie un coup fixe, et en partie dépend de l’utilisation. Les
véhicules lourds, surtout qui roulent à vive allure, abîment beaucoup
plus la chaussée que les véhicules légers (l’échelle est un logarithme
de la vitesse) et multiplient les travaux d’entretien et de renforcement
de la route.
Conflit d’intérêt route : biodiversité, hydrologie (gestion de l’eau), incendie
– besoin d’une gestion intégrale écologisée de l’infrastructure du transport
Entretien et construction routière
– les cantonniers sont responsables de l’entretien des bords de route.
La responsabilité pour l’entretien des différentes échelles et
catégories de route, des petites routes aux routes départementales et
nationales relèvent de différentes autorités et de locales plus et moins
grandes et centralisées. L’entretien devient de plus en plus mécanisée
et centralisée, avec des moissoneuses-faucheuses pour le gros de
l’affaire et des équipes de débroussailleurs.
Historiquement, la corvée était un « impôt » en espèces par le
travail, la dîme était le dixième en valeur, que ce soit par le travail
d’entretien des routes et chemins de la commune ou d’autres tâches de
construction et d’entretien de la voie publique.
Les gros œuvres se faisaient par chantier par encore d’autres groupes d’ouvriers et d’ingénieurs spécialisés.
Place au transport doux ?
Sans doute, mais pas sans peine. La surface de la France est riche en
matières de construction, assez bien redistribuées sur l’ensemble du
territoire. Cela se mentionne parce que c’est dans le transport de
matières lourdes à distance que l’on détermine la limite systémique.
Pour transporter un tronc d’arbre de 25 mètres de longueur, par exemple,
un convoi exceptionnel ? Les hélicos et les drones deviennent des
services de transport d’appoint, limitant le recours à de véhicules
motorisés. La robotique laisse espérer que des véhicules sans roues
capables de négocier des sentiers humains soient en bonne voie.
L’investissement lourde dans des flottes de grands véhicules de fauchage
implique des périodes d’investissement assez longs. Pour autant, il
faut immédiatement mettre en train des programmes d’investissements en
machines douces (humain et faucille) et désinvestir en machines
industrielles mal-calibrées et surdimensionnées.
De faire que la première place soit allouée à nous, en tant qu’humains
qui marchons, paraît très légitime. Si l’humain polluait plus, en
marchant qu’en voiture, ce serait vu autrement. Ce n’est pas le cas. Les
calories consommées par km par un être humain, par rapport à une
machine motorisée, sont dérisoires, dans l’ordre de cent fois moins. Son
impact sur le sol est si peu qu’il lui faut des routes bien moins
solides que pour un véhicule motorisé.
Le transport doux est doux dans ce sens aussi – qu’elle coûte moins
cher, beaucoup moins cher, en énergie et en matières, qu’un réseau fait
pour accommoder les voitures et les camions.
Si l’on considère l’infrastructure routière comme ayant trois tiers,
nationale, régionale et locale, le local se révise en chemin muletier,
vélo et pédestre, le régional devient muletier, véhicule léger, le
national s’entretient pour les véhicules semi-lourds, semi-vites, de
tous nos lendemains.
L’argument que ces propositions sont des mesures de l’« écologie
punitive » est à côté de la plaque. Les raisons pour adopter de
telles stratégies peuvent tout simplement venir d’une pénurie de
ressources, de minerais ou de monnaie, pour faire fonctionner une
infrastructure intensément énergivore, qui dans cette seule dimension
paraît déjà surannée. Elles sont donc d’entre les mesures adaptatives à
une telle réalité, qui rend cette réalité plus et non pas moins vivable
pour nous, humains. L’écologie est punitive dans le sens qu’elle nous
contraint à nous adapter à sa réalité et non l’inverse.
Nous avons beaucoup plus d’intérêt à adapter notre usage du vivant à son
bon fonctionnement, plutôt que de suborner le vivant aux exigences
d’une science de mécanisation et d’ordre industriel et non pas
« naturel » ou « biologique ». Nous continuons de
faire d’énormes progrès dans les bio-sciences, dans ces sciences du
vivant,de son histoire et avenir.